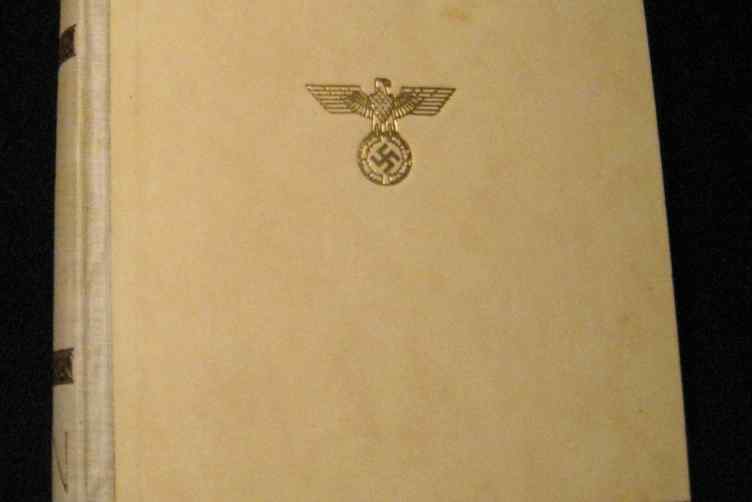Nous lisions, allongés côte à côte dans le lit. Nous lisions tous deux le cycle romanesque de Karl Ove
Knausgård. Nous l’avions commencé en même temps, nous le lisions en parallèle ; parfois, elle
posait son livre et se tournait vers moi; tu as lu ça? me demandait-elle? Comment peut-il avoir le
courage, c’est incroyable, il doit être fou disait-elle.
Puis, nous continuions notre lecture.
Jusqu’au moment où je posais mon livre et metournais vers elle; tu as lu ça? lui demandais-je.
Comment peut-il avoir le courage, c’est incroyable, il s’autodétruit, disais-je.
Tomas Espedal1.
En 2009, Karl Ove Knausgård publie La mort d’un père, premier tome de la série Min kamp (Mon combat en français). Déjà reconnu en Scandinavie pour ses deux premiers romans, Ute av verden (1998, Out of the World) et En tid for atl (2004, A Time for Everything), il surprend son lectorat avec la publication de ce « roman » qui abolit la distance entre auteur et narrateur et qui marque le début d’un projet d’écriture en série qui carbure au dévoilement de soi et de l’autre. Dans ce premier tome, l’auteur raconte le décès de son père des suites de l’alcoolisme, retrace son enfance et son adolescence avec précision et livre un commentaire détaillé sur sa vie quotidienne, où son désir d’écrire se heurte à la contingence des diverses des tâches ménagères et des couches à changer. Quelques semaines après la publication du premier tome, quatorze membres de la famille de Knausgård l’accusent d’avoir produit une « littérature de Judas [Judaslitteratur] » (Andersen, 2016). Cette prise de parole publique, qui vise à rétablir une vérité sur les faits, notamment sur les circonstances entourant la mort du père, aura cependant un tout autre résultat que celui de freiner Knausgård dans son écriture. Non seulement cinq autres tomes allaient paraître entre 2009 et 20112, totalisant plus de 3 600 pages dans lesquelles l’auteur raconte sa vie et celle des personnes gravitant autour de lui à une époque ou à une autre, mais la série Min kamp allait devenir un bestseller international, lauréat de plusieurs prix littéraires3 et en cours de traduction dans vingt-deux langues. D’une certaine manière, en tentant de disqualifier La mort d’un père en tant qu’œuvre calomnieuse, la famille de Knausgård a été à la racine de la controverse qu’elle tentait justement d’éviter.
Bien que la littérature norvégienne connaisse un succès croissant à l’étranger depuis les années 90, qu’on pense notamment au roman Le monde de Sophie [Sofies verden] (1991) de Jostein Gaarder, qui faisait partie de la liste des livres les plus vendus au monde en 1995, ou à Pas facile de voler des chevaux [Ut og stjæle hester] (2003) de Per Petterson, vendu dans 42 pays, peu d’œuvres ont connu une telle médiatisation par le biais du scandale4. En 2010, alors que seuls les trois premiers tomes sont publiés dans leur langue originale, on peut lire dans le Courrier International : « en Norvège, l’œuvre est débattue comme aucune autre dans l’histoire de la littérature récente de ce pays, notamment du fait qu’une grande partie de sa famille lui a tourné le dos après qu’il eut décrit en détail la vie avec son père alcoolique et la mort de ce dernier. » (Korsgaard, 2010.) Avant même que Min kamp ne soit disponible en traduction, c’est entouré de cette aura de scandale que se construit l’horizon d’attente des romans du « polémiste norvégien » (Perreault, 2015).
Dès lors, les discours sur la portée scandaleuse de Min kamp accompagnent sa réception, formant une masse indistincte à laquelle s’ajoutent les paroles de Knausgård et des journalistes. Comme le remarquent Arnaud Schmitt et Stefan Kjerkegaard, la vague médiatique « has led to the peculiar but not unusual situation where information about a book from another part of the world, another context, reaches readers before they have read or even opened the book » (2016: 553). Pourtant, quiconque entame la lecture de Min kamp dans le but de découvrir un récit injurieux ou obscène risque fort d’être insatisfait. Le projet de Knausgård est d’abord et avant tout d’écrire la vie dans toute sa banalité : entre les descriptions des tâches ménagères, des joies et des peines d’être parent, de ses problèmes d’éjaculation précoce ou de ses beuveries, l’auteur tente de tracer « a realistic depiction of a man, forty, from Norway » (Knausgård cité par Barron, 2013) et de reprendre le fil des événements qui l’ont conditionné et continuent de le déterminer en tant qu’individu.
Devant une œuvre qui, si elle convoque différents enjeux éthiques liés à la mise en récit de personnes réelles, ne semble pas d’emblée porteuse d’infamie, on peut se demander si le scandale n’est pas en partie « créé » par le discours médiatique. Évidemment, l’un n’existerait pas sans l’autre : la publication de La mort d’un père a généré une controverse que les médias ont amplifiée jusqu’à faire du roman et de son auteur les icônes d’une littérature « sans compromis », image récupérée par Knausgård en entrevue et dans l’écriture des tomes subséquents. Dans cet article, je me propose de survoler le discours médiatique qui accompagne les principales controverses, celle de la reprise d’un titre aux fortes intrications politiques et celle qui découle de l’accusation familiale, afin de voir comment les médias reprennent et transforment ces éléments5. À partir du dépouillement d’articles de journaux grand public publiés entre 2009 et 2017, en anglais, français et norvégien, il sera possible de voir comment les journalistes puisent à même les entrevues accordées par Knausgård pour interpréter le texte — notamment l’essai consacré à Hitler dans le sixième tome auquel ils n’ont pas encore accès. Ce sera également la transgression par les journalistes des limites de la vie privée qui sera abordée, car, pour ajouter au débat, ces derniers n’hésiteront pas à importuner les personnes réelles, sans faire de distinction avec leur statut de personnages.
Un titre problématique
Dès l’annonce de sa parution, le titre de la série Min kamp suscite les débats6. Calqué sur le Mein Kampf hitlérien, la provocation n’échappe en effet à personne. La zone délicate dans laquelle Knausgård s’est hasardé sera d’emblée soulignée par les journalistes, l’antisémitisme et le nazisme sont évidemment des sujets brûlants à aborder publiquement et plusieurs se demandent ce qui motive la réactivation d’un titre aux si lourdes connotations. À la lecture, Min kamp ne s’apparente cependant pas au pamphlet idéologique et haineux que la référence à l’autobiographie d’Hitler évoque. Le récit est tourné vers Knausgård et ses expériences dans une « tentation autobiographique » (Gasparini, 2013: 18) somme toute classique, par opposition au Mein kampf d’Hitler qui inclut le lecteur dans un « nous » vindicatif. On peut par ailleurs identifier plusieurs combats littéraires et existentiels qui sous-tendent l’écriture de Min kamp, que ce soit une opposition à la fiction et au « beau » style, un combat contre soi-même pour atteindre une authenticité par la révélation des épisodes honteux de sa vie ou encore une lutte pour s’extirper de la banalité de la vie quotidienne, combats qui justifieraient peu ou prou le choix du titre coiffant la série. En entrevue, l’auteur norvégien soutient que le renvoi à la « bible nazie » serait une « manière de dire “fuck you” au lecteur7 » (Hughes, 2014b), un pied de nez qui reflèterait son refus de penser à sa famille et à ses amis durant la rédaction ou de plaire à ses éventuels lecteurs. Cette explication omet toutefois de mentionner que l’intitulé est une garantie de lecture : aucun doute qu’un livre qui recycle un symbole du totalitarisme, même dans le but de le détourner, obtiendra un écho dans les médias. Récemment, Knausgård a affirmé qu’à l’origine du titre, il y avait cette idée que « [s]on combat à [lui] [allait] éliminer celui d’Hitler » (Liger, 2017: 43). Difficile de juger s’il s’agit d’une relecture basée sur le succès de Min kamp ou de la mise à plat par l’auteur d’un discours visant à se disculper. Knausgård a effectivement soutenu à plusieurs occurrences son étonnement devant la popularité de ce qu’il concevait, au moment de l’écriture, comme une « expérimentation de prose réaliste, infiniment ennuyeuse et inintéressante pour autrui8 » (Knausgård, 2016c), un livre qui resterait dans l’oubli.
Dans le sixième et dernier tome, Knausgård consacre près de 700 pages au jeune Adolf Hitler, timide et ayant peu de succès auprès des femmes. Les parallèles que l’auteur trace avec le jeune Karl Ove sont multiples et lui permettent de questionner la ligne de démarcation entre le « monstre » et la personne humaine. Son argument, qui fait écho à ses réflexions sur l’affaire Breivik (2015b), est qu’Hitler était une personne parfaitement ordinaire, avec une enfance difficile comme en ont vécu bien d’autres et des tendances narcissiques qu’on retrouve chez une multitude d’individus — parmi lesquels Knausgård s’inclut —, mais qui s’est écarté des interdits sociaux afin d’être vu de tous. Selon l’auteur, le moment qui devrait nous intéresser socialement est cet instant d’effondrement intérieur où la personne devient une exception, où l’emprise des codes moraux est dissoute. Cette vision des faits a été dénoncée par plusieurs, en particulier l’écrivaine Maja Hagerman (2017) et l’historien Sten Reinhardt Helland (2016), comme étant une simplification de l’histoire teintée d’indulgence envers le nazisme. Hagerman reproche à Knausgård de reproduire ce qu’il a pu voir dans les films de propagande nazie lorsqu’il décrit la mystérieuse alliance entre les masses et leur führer (2017). Helland abonde dans le même sens en soulignant que Min kamp va trop loin dans sa normalisation du nazisme : en voulant montrer l’ordinaire d’Adolf Hitler, l’auteur n’éviterait pas de le magnifier. À l’heure où les mouvements néo-nazis reprennent des forces en Europe et aux États-Unis, Helland en appelle à une rigueur devant les faits historiques (2016). Cette dernière partie de la controverse sur le titre était, au moment de rédiger cet article, rapportée par les journalistes étrangers qui, n’ayant pas directement accès au débat, en répandent cependant les rumeurs dans des articles intitulés : « Why Name your Book After Hitler’s? » (Hughes, 2014a), « Me, Myself and Hitler » (Jensen, 2015), « Évidemment, le titre fait référence à Adolf Hitler » (Liger, 2014)9.
Deux manières de lire : les enjeux de la « fiction sans fiction »
Dans sa réponse adressée à Sten Reinhardt Helland, Knausgård écrit que l’historien « critique sans comprendre ce que c’est que de dire une chose dans un roman parce qu’il ne comprend pas ce qu’est la fiction10 » (2016b). Le roman serait un espace où la rectitude historique n’est pas nécessaire, puisqu’il serait le véhicule d’une position plus personnelle sur les faits et l’histoire. Or, à la base du projet d’écriture de Knausgård se trouve une volonté de refuser la fiction pour sortir du littéraire : « si je recréais un monde avec des éléments de celui-ci, ce ne serait que de la littérature, quelque chose d’inventé, donc sans valeur. » (2014a: 663.) La fiction, au sens où l’entend Dorritt Cohn, à savoir « un univers clos sur lui-même, gouverné par des structures formelles qui sont exclues de tous les autres types de discours » (2001: 7), forme le repoussoir de l’écriture de Knausgård. Retraçant la genèse de Min kamp, il écrit : « J’avais la nausée rien qu’à l’idée de fiction, à l’idée d’inventer une histoire et de mettre des personnages dedans. » (2014a: 663.) Incapable d’inventer, Knausgård délaisse la création de mondes possibles pour écrire un « roman » dont il est à la fois l’auteur et le personnage.
Dès les premières pages de La mort d’un père, un pacte autobiographique (Lejeune, 1975: 13-46) est scellé : « Aujourd’hui, nous sommes le 27 février 2008 et il est 23 h 43. C’est moi, Karl Ove Knausgård, né en décembre 1968 et donc dans ma trente-neuvième année, qui écris11. » (2012: 38.) Le refus du fictionnel passe non seulement par l’amoindrissement de la distance entre le texte et la « strate testimoniale » (Cohn, 2001: 177), mais aussi par le choix d’une écriture qui cherche à reproduire « la forme même de la vie ordinaire, laquelle est naturellement impure, multiple et contingente » (Formis, 2010: 241). Knausgård propose un récit de la banalité de l’existence, de « l’infra-ordinaire » (Perec, 1989: 11), dans lequel il porte attention aux détails superflus, dans de longues descriptions des actions du quotidien. En restant collé à la vie, aux sensations et aux émotions qui jaillissent de la répétition d’un quotidien, l’esthétique du texte correspond à ce que Dominique Viart nomme l’« effet de vécu », c’est-à-dire que « la question de la réalité historique du matériau ou de l’anecdote n’importe plus; seule importe la façon que le texte a de présenter ce matériau » (2001: 24).
En effet, bien que Min kamp se donne à lire comme un récit fidèle du passé, ce réalisme de l’ordinaire se conjugue à une construction narrative et esthétique étudiée. L’effet de vécu repose sur de nombreux procédés propres au roman, que ce soit la forme dialogique largement déployée tout au long des six tomes ou l’organisation du récit autour d’un point de rupture. Dans La mort d’un père, les deux parties sont construites autour d’une scène centrale, celle où le jeune Karl Ove voit pour la première fois de sa vie son père ivre qui se laisse aller à la nostalgie et à l’émotivité. Tout en développant une esthétique de la banalité dans laquelle le récit est subordonné à l’écriture du quotidien, Knausgård configure l’histoire de sa relation avec son père autour d’un moment de bascule. L’architecture travaillée du récit remet en cause la prétention de processus d’écriture spontanée dont il se réclame12. Les dialogues quant à eux donnent l’impression que l’auteur tenait allumé, à chaque moment de sa vie, un magnétophone pour enregistrer et ensuite retranscrire dans les moindres détails les conversations qu’il a eues, alors même qu’il affirme avoir « brûlé tous [s]es journaux et toutes [s]es notes, et [qu’] il ne rest[e] pour ainsi dire aucune trace de celui qu’[il] avai[t] été jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans » (2012: 466).
Olivier Caïra soutient que, dans le cas des « fictions ancrées dans le réel », ce qui importe est de ne rien écrire qui soit en « discordance » avec les faits attestés (2011: 110). C’est cette même idée d’authenticité et de vraisemblance qui se trouve au cœur de la démarche de Knausgård. Comme il le soutient à de maintes reprises, les souvenirs de sa jeunesse sont fragmentaires; ce ne sont que des « gouttes d’eau dans un océan d’événements » (2014a: 27). Par conséquent, l’auteur est moins à la recherche d’une vérité du souvenir que motivé par la volonté de tracer un portrait réaliste de sa personne et de celles qui l’entourent. Comme le soutient David Shields dans son manifeste pour un règne de la réalité en littérature :
Nonfiction writers imagine. Fiction writers invent. These are fundamentally different acts, performed to different ends. […] Fiction gives us a rhetorical question: What if this happened? (The best) nonfiction gives us a statement, something more complex: This may have happened. (2010: 60.)
Le projet d’écriture de Knausgård peut être compris à partir de cette distinction entre invention et imagination. En restaurant des épisodes du passé avec une pléthore de détails, tant au niveau des situations que des dialogues, l’auteur essaie de retracer des manières d’être et de penser. Min kamp peut ainsi être envisagé comme une expérience d’écriture qui utilise le matériel (auto)biographique pour tenter de dégager un récit de soi cohérent.
Dans son ouvrage Fiktionfri fiktion (2012), le Danois Hans Hauge analyse la tendance contemporaine de la littérature à assouplir les frontières entre les genres, mais surtout la répercussion de ces flous génériques sur nos pratiques de lecture. Les textes qu’il désigne comme des « fictions sans fiction13 » — parmi lesquels il inclut Min kamp —, auraient en commun de se situer « au-delà du roman et de l’autobiographie14 » (Hauge, 2012: 7). Selon lui,
nous lisons les romans comme des autobiographies. Nous ne croyons pas qu’ils sont des fictions. Et inversement. Nous lisons les autobiographies comme des fictions. Nous ne croyons pas qu’elles sont vraies15. (Hauge, 2012: 23.)
Par conséquent, l’indistinction entre les deux genres reposerait moins sur des composantes intrinsèques au texte que sur son actualisation par la lecture. Or, comme le remarque Arnaud Schmitt,
prendre des fils référentiels et les tisser avec des fils fictifs de manière extrêmement complexe et intriquée ne génère pas un nouveau genre, simplement un texte complexe qui met à mal les habitudes de lecture d’une communauté interprétative souvent bien ancrée dans ses certitudes. (2010: 56.)
Convenons que la fiction sans fiction, telle que la conçoit Hauge, offre la possibilité au lecteur de lire l’œuvre comme un roman, comme une autobiographie ou comme un texte situé à la jonction des deux. On voit ainsi se dessiner la prérogative de la fiction sans fiction en regard de la controverse : elle permet à l’auteur de pencher parfois vers un certain mode de lecture, parfois vers l’autre, d’affirmer une chose et son contraire sans toutefois réellement se contredire. En effet, tant pour se décharger des accusations de nazisme ou de celles d’atteinte à la vie privée, la stratégie de Knausgård sera la même : invoquer la forme romanesque et la fiction qu’elle impose, et ramener Min kamp à un regard subjectif sur le monde.
La controverse familiale
Avant que ne soit publié le premier tome, Knausgård a envoyé le manuscrit à la famille de son père. La réaction est unanime : on demande à ce que le livre ne paraisse pas, menaçant, le cas échéant, de poursuivre l’auteur pour diffamation et atteinte à la vie privée. Des avocats se pencheront sur le texte, certains passages seront retirés et quelques noms seront modifiés, afin que les accusations ne puissent être légalement défendables. Lorsque les membres de sa famille utiliseront la voie des médias pour faire entendre leur colère suite à la publication du premier tome, ils savent, tout comme Knausgård, qu’aucun procès ne sera intenté. C’est ce que souligne l’auteur en entrevue : « Ils ne m’ont finalement pas attaqué en justice parce qu’ils auraient sans doute perdu » (Caviglioli, 2014). Dans une lettre rendue publique en 2009 dans le journal Klassekampen, les quatorze membres de la famille de l’auteur écrivent : « This is confession literature and non fiction. Judas literature. This is a book full of insinuations, lies, erroneous characterizations of individuals and revealing acts that are obviously unlawful » (lettre traduite par Andersen, 2016: 564). On accuse Knausgård de trahison : en écrivant un texte de confessions, il a rompu l’omerta filial en révélant un secret de famille. Mais ce qu’on lui reproche peut-être plus encore est d’avoir mis en scène les membres de sa famille en tant que personnages de roman, de leur avoir mis des mots qu’ils n’ont jamais prononcés dans la bouche, de les avoir arrachés à leur existence somme toute anonyme. En un sens, Knausgård est désigné coupable d’avoir produit un texte qui oscille entre deux désignations génériques, une fiction sans fiction, qui, sous le couvert du roman invente et modifie des faits, tout en conservant un ancrage non fictionnel assumé.
Cette lettre sera l’élément déclencheur d’une vague d’entrevues dans lesquelles les journalistes demandent à l’auteur de se justifier face aux accusations de sa famille. Pour se dédouaner, Knausgård fera valoir parfois un mode de lecture, parfois un autre. Ainsi, il peut affirmer en entrevue que ses romans sont des objets littéraires éloignés de sa vie intime : « The books are books. They’re novels, I don’t feel there’s any interference, there’s no connection between me and the books. […] I am happy that they exist, I am, but it’s very separated from my own life. » (Buckley, 2014). Tandis qu’à d’autres moments il revendique l’aspect véridique — surtout en ce qui a trait à la représentation de l’alcoolisme de son père —, de son écriture : « I said it was true, they said I was lying » (Henley, 2012); « this is the last of the non-fake books » (Freeman, 2016). Du même geste, il reconnaît, tout en la niant, sa responsabilité à l’égard des individus qu’il a mis en scène. Par exemple, il affirme : « si j’avais su avant ce qui allait arriver, je ne l’aurais pas fait. Je n’en aurais pas été capable. Ce n’était pas mon but, mais j’ai fait du mal à beaucoup de gens. » (Caviglioli, 2014.) Knausgård publiera d’ailleurs un article de justification dans The Guardian (2016c), dans lequel il détaille les objectifs son projet d’écriture et où il s’étend longuement sur la honte et la culpabilité qui l’accablent. Il est intéressant de noter que ce discours sur l’aspect « immoral » (Caviglioli, 2014) de sa démarche a fait place, près de dix ans après la parution du premier livre, à un autre discours : « I don’t regret it. I think it was hard to see then, and easier to see now — people were hurt, and it was terrible for them when it was happening, but, still, it wasn’t the end of the world. » (Rothman, 2018.)
Cette déferlante médiatique aura également un impact sur la suite de l’écriture de la série Min kamp : désormais, Knausgård sait qu’il écrit sous le regard des autres. L’expérience d’écriture entamée avec les deux premiers tomes prend alors une visée performative. Non seulement l’auteur parle de son projet d’écriture dans les médias, mais il se sert de ce matériel pour écrire la suite de la série. Le fait d’écrire alors même que le scandale continue de faire rage positionne l’auteur dans un entre-deux : d’un côté, il tente de rendre manifeste l’aspect fictionnel du texte, en faisant ressortir les contradictions de sa parole et en consacrant de longues pages à la genèse de son projet d’écriture, de l’autre, il tente d’attester le factuel du récit. C’est notamment en ce qui a trait aux circonstances entourant la mort de son père que cette volonté de certifier le réel des événements transparaît. Par exemple, dans le quatrième tome, Knausgård s’appuie sur des archives telles que le journal tenu par son père, dont il cite des extraits afin de prouver que ce dernier était véritablement alcoolique : « Work. Survived the first three lessons. Had terrible diarrhea in lunch break and had to give the HK class a free. Home for repair — rum and coke. Incredible how it helps. » (2015a, 324.) Au-delà des stratégies mises en place par l’auteur pour répondre aux accusations de sa famille, c’est le débat médiatique qui fera l’objet de la suite de cette analyse. En effet, la réception de Min kamp offre un exemple probant de la sur-médiatisation contemporaine des œuvres et porte à se questionner sur le rôle des médias non seulement dans la « fabrication de l’universel » (Casanova, 2008: 190), mais aussi dans l’édification du scandale16.
La médiatisation des controverses
Marie Dollé constate que le scandale est de nos jours recherché, car « celui par qui le scandale arrive ne se trouve pas mis au ban de la société, mais au contraire acquiert un statut enviable : il se part de l’auréole des rebelles et des insoumis » (2006: 8). Cette position valorisée est consolidée par le relai médiatique : à chaque nouvel article, l’existence du scandale est réitéré comme une évidence. S’il appert que la controverse fait vendre, pour Pierre Jourde, elle est surtout un moyen que les journalistes utilisent pour se légitimer dans leur propre pratique (2006: 174). Dans les articles publiés sur Min kamp, les journalistes se citent les uns les autres, reprenant des extraits tirés d’entrevues ou utilisant le jugement d’un collègue pour déclarer ou infirmer l’importance de l’œuvre au sein de l’histoire littéraire. Certaines phrases et expressions deviennent quasiment des lieux communs pour parler de Min kamp : « [Zadie] Smith has said she needs his books “like crack”17 » (Deresiewicz, 2014; Glancy, 2015; Kachka, 2014; Kunzru, 2014; Lerner, 2014); Knausgård serait un « monstre » (Desmeules, 2017; Bursey, 2015), un « héros » (Lethem, 2014; Eyre, 2014), un « existentialiste du Nord » (Perreault, 2015; Assouline, 2014; Robson, 2014). Certains vont jusqu’à reprendre presque mot pour mot un article déjà paru, comme c’est le cas de Pierre Assouline (2014) avec l’article de William Deresiewicz (2014). Quand on lit que Min kamp est une « autobiographie sulfureuse », on en vient à se demander, à la suite de Pierre Bayard : « les critiques parlent-ils bien de la même œuvre? » (2002: 21). Plus encore, ont-ils même lu l’œuvre, ou ont-ils seulement lu les critiques de l’œuvre? On l’a vu avec l’essai consacré à Hitler dans le sixième tome de la série, de nombreuses mentions et explications de cet essai sont présents dans les articles sans que les journalistes n’aient pu avoir accès au texte qui fait scandale.
S’il existe évidemment des critiques de qualité, tant universitaires que grand public, on doit toutefois reconnaître qu’une grande partie du débat médiatique travaille à la « personnalisation de la littérature » (Jourde, 2006: 189), délaissant le texte pour parler de ce qui gravite autour de l’œuvre : l’auteur, les réactions familiales, mais surtout, ce que les autres en ont dit et ce que l’auteur lui-même en a dit. L’utilisation du discours de l’auteur comme grille interprétative n’est pas un phénomène nouveau, ni circonscrit à Min kamp18. Or, en ce qui concerne Knausgård, c’est le délai entre le bruit du scandale rapporté par les médias et l’accès aux traductions qui rend l’étude de ce cas hypermédiatisé intéressant. En effet, bien que la publication du premier tome et la polémique qui s’en est suivie remontent à plus de dix ans, rares sont les articles qui ne débutent pas par un rappel du « scandale » originel. Puisqu’à la lecture de Min kamp on peine à trouver l’aspect scandaleux ou polémique du texte, l’on est conduit à se questionner sur la responsabilité des journalistes vis-à-vis de la création et de l’amplification du scandale.
Des vies qui appartiennent au domaine public?
Pour Arnaud Schmitt et Stefan Kjerkegaard, Min kamp illustre la notion de « réciprocité » (2016: 555), à savoir l’interaction qui se crée entre l’auteur et le lecteur. En se dévoilant dans l’écriture, Knausgård « forces his intimacy on us in such a way that we feel drawn into an intersubjective relation with the author, one in which we cannot remain neutral » (2016: 569). Cette réciprocité, telle qu’ils la théorisent, pousse le lecteur de Min kamp à se demander : oserais-je faire la même chose? Or, la réciprocité semble être dissymétrique entre le lecteur qui a le sentiment de connaître Knausgård tandis que l’auteur ignore tout du lecteur (Heinich, 2012: 38). Relatant sa rencontre avec l’auteur, David Caviglioli témoigne de ce fait :
Je lui dis que le voir en vrai est une expérience très étrange. Que j’ai l’impression de rencontrer un très vieil ami pour la première fois. Étonnamment, il semble ne pas comprendre. Je dois lui rappeler que je viens de passer un mois à lire les 1400 pages des deux premiers tomes de son cycle autobiographique, qui en compte six. Un mois d’immersion totale, pendant lequel sa vie a défilé devant mes yeux. (2014.)
Ce sentiment de connaître intimement une personne par ce qu’elle a révélé sur elle-même dans son écriture légitime les questions des journalistes, des plus banales, « Do you still smoke? » (Barron, 2013) aux plus intimes, « étiez-vous vraiment alcoolique à l’âge de dix-huit ans? » (Liger, 2017: 45), ou « can I ask how the novel has affected your marriage? » (Barron, 2013). En écrivant sur lui-même, c’est comme si Knausgård avait placé sa vie dans le domaine public, acte qui autoriserait implicitement les journalistes à poser des questions qui traitent de sa vie personnelle. Dans son Plaidoyer pour une presse décriée (2001), Philippe Bilger écrit :
[U]ne personne qui a décidé, par quelque mode que ce soit, de laisser publier des éléments de sa vie privée peut-elle ensuite se plaindre de les voir à nouveau repris et diffusés? N’a-t-elle pas spontanément mis en branle un processus dont les médias ne font, d’une certaine manière, que profiter sans l’avoir créé? (Bilger cité par Heinich, 2012: 333.)
Cependant, qu’en est-il quand les journalistes posent des questions du même type aux personnes mises en scène par Knausgård, personnes qui n’ont, en aucun cas, participé au processus de dévoilement public de leur vie? Après la publication de La mort d’un père, toutes les personnes figurant dans le récit deviennent sujet d’intérêt pour les journalistes qui se précipitent pour recueillir leurs impressions, comme le relate Knausgård lui-même :
Reporters were contacting everyone I had written about. They loitered outside the houses of my friends, waiting for them to emerge. They knocked on the door of my mother-in-law and scared the life out of her. They phoned her ex-husband, a man of more than 80 years living a secluded life in a forest, wanting to know his reactions to what Karl Ove had written about him. (2016c)
Cette frénésie médiatique accentue l’incursion dans la vie privée des « personnages » de Min kamp, qui se voient désormais obligés prendre position, soit en manifestant ouvertement leurs sentiments vis-à-vis de leur représentation littéraire ou en gardant le silence. Les répliques seront multiples, de l’ancienne femme de Knausgård, qui, dans une émission de radio intitulée « La version de Tonje » (Aursland, 2011), expose sa vision des faits, aux écrivains Jan Kjærstad et Tomas Espedal, présents dans le quatrième tome, et dont le dernier ira jusqu’à mettre à son tour Knausgård en scène dans son livre Bergeners (2013), y revisitant un épisode du cinquième tome pour en proposer une autre lecture.
Un exemple frappant du droit que s’octroient les journalistes à importuner les personnes réelles est l’entrevue que la femme actuelle de Knausgård, Linda Böstrom, a accordée au journaliste britannique William Leith en 2015. La parution de la série Min kamp, dans laquelle elle tient un rôle important, la fera plonger dans une dépression qui servira à son tour de matériel d’écriture lors du sixième tome. Le préambule de l’article de William Leith prouve que la parution de Min kamp grève le travail et l’image sociale de Böstrom : « It is one of the strangest stories I’ve read, but before I carry on I should mention that Boström Knausgård is the second wife of Karl Ove Knausgård, the scandalous Norwegian author. » (2015.) La pratique d’écriture de Böstrom est non seulement associée à son « scandaleux » mari, mais l’ensemble de sa personne semble désormais filtrée par la représentation que Knausgård trace d’elle, celle d’un être fragile et inapte à affronter l’existence. Alors que Leith la rencontre pour parler de son premier roman, The Helios Disaster (2015 [2013]), récemment traduit en anglais, c’est toutefois Min kamp qui est au cœur du propos. L’une des accroches de l’article — « Her bipolar disorder, a suicide attempt, the bad housekeeping : Linda Böstrom Knausgård’s famous husband told all. Now it’s her turn » (Leith, 2015) —, témoigne de l’indistinction entre la personne et le personnage; la représentation littéraire de Böstrom sort des strictes limites du texte et affecte son image sociale. Le journaliste a eu l’impression « d’espionner Böstrom19 » (Leith, 2015) lors de sa lecture et ce sentiment de la connaître intimement justifie, selon lui, les questions intimes qu’il lui pose, questions auxquelles Böstrom refuse de répondre, arguant que cela appartient au domaine privé : « This is very private. He has written about it, but when I retell it, it feels absolutely private. » (Böstrom citée par Leith, 2015.)
Doit-on alors parler d’une dérive des médias ou des dommages collatéraux d’une démarche autobiographique? Il apparaît désormais impossible de séparer les discours sur l’œuvre du texte lui-même, chaque discours se greffant au texte comme une plus-value. La question de la responsabilité est ainsi nécessairement brouillée : si Knausgård a franchi les limites de la vie privée en mettant en scène des personnes réelles, les journalistes ont poursuivi et poursuivent encore aujourd’hui cette intrusion. En portant attention aux lieux communs employés par la presse pour parler de Min kamp, et en observant l’intrusion des journalistes dans la vie des personnes mises en scène par Knausgård, on peut se demander si le discours médiatique n’est pas en quelque sort le prolongement de la fiction sans fiction. Alors même que les journalistes prétendent rapporter des faits, on constate qu’ils sont finalement en train d’imaginer ce qui se trouve en marge du texte. Comme l’exprime assez justement Knausgård dans un entretien accordé en 2014, en écrivant Min kamp, il a en quelque sorte « créé un monstre qu’il ne contrôle plus » (Caviglioli).
- 1. ESPEDAL, Tomas. 2015 [2011]. Contre la nature (les carnets), traduit du norvégien par Terje Sinding. Arles : Actes Sud, « Lettres scandinaves », p. 78.
- 2. Un homme amoureux (2009), partiellement écrit avant la parution du premier tome, aborde principalement la relation de l’auteur avec sa seconde femme, Linda Böstrom, tandis que Boyhood Island (2009) fait un retour sur sa jeunesse sur l’île de Tromøya, de sa naissance au départ de la famille pour Kristiansand treize ans plus tard. Puis, l’auteur s’intéresse à ses années de formation avec Dancing in the Dark (2010), qui se concentre sur l’année 1977-1978 alors que, âgé de dix-huit ans, il a enseigné dans une école primaire du Nord de la Norvège, et Some Rain Must Fall (2010), qui relate ses études en création littéraire à la Skrivekunstakademi de Bergen. Le dernier tome, quant à lui, revient sur les conséquences de la publication des volumes précédents, notamment la dépression de Böstrom, et clôture la série en 2011. À ce jour, cinq des six tomes sont traduits en français, et le sixième est paru en anglais à l’automne 2018.
- 3. Knausgård a reçu le prestigieux prix Brage pour La mort d’un père (2009), le prix littéraire du journal allemand Die Welt (2015), il a été finaliste pour le prix des Libraires québécois (2015), finaliste pour le Independant Fiction Award (2014) et était pressenti comme candidat pour le prix Nobel de littérature sur le site anglais Ladbrokes (Shepard, 2014).
- 4. On peut bien sûr penser à la pièce d’Henrik Ibsen, Une maison de poupées [Et Dukkehjem] (1879), qui avait scandalisé l’Angleterre et l’Allemagne pour sa critique des rôles traditionnels dévolus aux femmes, ou à La chanson du ruby rouge [Sangen om den røde rubin] (1956), bestseller de l’époque qui valut à Agnar Mykle une condamnation pour obscénité et le conduisit à la faillite personnelle une dizaine d’années plus tard. Pour un panorama intéressant des publications norvégiennes contemporaines (1978-2008), voir Ingunn Økland et Thomas Hylland Eriksen (2008).
- 5. Cet article est le prolongement d’une réflexion qu’on retrouve dans la revue Postures (Asselin, 2016), sur le rôle de la critique journalistique dans la consécration de Min kamp. Les articles analysés pour ce précédent article — 2009-2015 —, contribuaient d’ores et déjà à la construction d’un « mythe » autour de Knausgård. L’ajout des articles de 2016 et 2017 permet, dans le présent article, d’observer la réactivation et l’amplification du phénomène médiatique avec la parution de chaque tome en traduction. Depuis la rédaction de cet article en janvier 2018, le 6e tome de Min Kamp est paru en anglais (à l’automne). Il est intéressant de voir comment déjà en 2016 et 2017 les journalistes parlent de l’entièreté de la série alors même qu’ils n’y ont que partiellement accès, et que cela contribue à la construction du mythe Min kamp.
- 6. L’aspect choquant du titre sera tempéré par les choix éditoriaux de plusieurs traductions qui relèguent le titre de la série à la page de garde au profit de sous-titres, comme c’est le cas des versions françaises et américaines : A Death in the Family (La mort d’un père), A Man in Love (Un homme amoureux), Boyhood Island (Jeune homme), Dancing in the Dark (Aux confins du monde), Some Rain Must Fall. En Allemagne, la série de ne s’appelle pas Mein kampf, mais Sterben, signifiant « mourir ».
- 7. [Je traduis.]
- 8. [Je traduis.]
- 9. La parution du sixième et dernier tome en anglais à l’automne 2018 offre une nouvelle perspective sur cet enjeu, puisque désormais les journalistes ont accès au texte.
- 10. [Je traduis.]
- 11. Ce pacte est réitéré dans le quatrième tome : « I am forty now, as old as my father was then, I’m sitting in our flat in Malmö, my family is asleep around me. […] It is 25 November 2009. » (Knausgård, 2015a: 179.)
- 12. Knausgård affirme en entrevue avoir écrit entre 5 et 20 pages par jour et ne s’être jamais relu (Caviglioli, 2014), le tout dans un état quasi « autistique » (Henley, 2012). [Je traduis.]
- 13. [Je traduis.]
- 14. [Je traduis.]
- 15. [Je traduis.]
- 16. Pour une analyse du rôle des médias dans la consécration de l’œuvre de Knausgård, voir Soline Asselin (2016).
- 17. Deresiewicz : « Smith has said she needs his books “like crack” »; Glancy : « Smith has said she needs his books “like crack” »; Kachka : « Elsewhere, she said, “I need the next volume like crack” »; Kunzru : « Zadie Smith says she needs his books “like crack” »; Lerner : « “I need the next volume like crack,” Zadie Smith writes. »
- 18. On peut penser par exemple au cas de Michel Houellebecq, dont la « persona » médiatique contribue à une lecture de l’œuvre et à alimenter le discours médiatique, comme le montre bien Matthias de Jonghe (2017).
- 19. [Je traduis.]