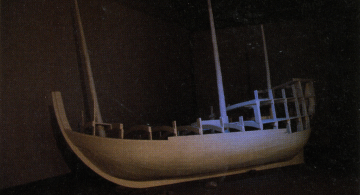L’équipage s’est rassemblé sur le pont. Jordens, le maître charpentier, est penché sur le pied de la barre de gouvernail, occupé jusque dans le bout de ses ongles à tenter de réparer le système de navigation. L’Amiral Van Roggen supervise la scène, solennel et digne. La tension est palpable; tous se demandent si Jordens parviendra aujourd’hui à réaliser cette prouesse qui nous rapprocherait de notre salut, alors que notre navire dérive depuis déjà plusieurs jours. Nous gardons le silence pour lui permettre de se concentrer. Je remarque certains tics qui se développent chez mes camarades. La plupart d’entre eux portent fréquemment le bout de leur langue à leurs lèvres craquelées avant de déglutir lentement. C’est un des comportements qui trahit chez eux la soif, un peu comme le claquement de la langue sur le palais aride. Ils ont beau vouloir cacher leur inconfort, l’homme de sciences en moi ne peut s’empêcher de noter ces détails, dont je me promets de faire l’inventaire dans mon almanach médical, dès que je retournerai dans ma cabine. Depuis la tempête, nous exhibons une volonté de demeurer inébranlables, mais les choses changent peu à peu. Le manque d’eau et l’embarras de Jordens font planer un soupçon d’impatience et de découragement sur l’équipage. Jordens, cependant, refuse de s’avouer vaincu et continue de s’acharner sur le gouvernail. L’Amiral Van Roggen semble percevoir le désespoir grandissant de ses hommes et déclare que, malgré tous nos efforts, la direction du navire ne répondra plus.
L’équipage trahit son angoisse en penchant le regard vers les planches moisies du pont. Seuls Merckens le timonier, le Second Hauser et l’Amiral restent droits, les yeux pointés sur l’horizon. Merckens me voit le regarder et sourit, comme pour me rassurer. Je me détourne à mon tour vers le plancher, mince couche de bois fatigué qui nous sépare de l’immense abîme. Entre mes pieds et la mer, dans le ventre du navire, j’entends des bruits de pas faire grincer le sol de la cale.
***
Quinze jours se sont maintenant écoulés depuis la tempête. Le Second Hauser s’est rapidement attribué le titre honorable de Gardien du temps. Tous les matins au réveil, lorsqu’il sort de sa cabine en uniforme complet, avec sa prestance de militaire, il s’avance vers le grand mât et d’un geste précis, dégaine son sabre pour y ajouter une nouvelle encoche, comme pour rappeler la terrible fatalité du temps qui passe. À bord, le moral diminue de jour en jour, et l’obstination de certains officiers, dont le Second Hauser, à maintenir l’ordre est reçue de manière mitigée par les membres d’équipage. La plupart y voient un bon moyen de ne pas sombrer dans la folie, alors que d’autres, dont notamment Spengler, notre vigie, suggèrent à mi-voix d’entailler le dos du Second Hauser au lieu du grand mât. Voyant à nouveau une tension s’installer chez ses hommes, l’Amiral Van Roggen a déclaré aujourd’hui que le maintien d’une barbe bien taillée se ferait désormais sur une base volontaire. Cette décision n’est pas pour me déplaire, car en tant que chirurgien, il est de mon devoir de raser les barbes les plus drues. Spengler semble satisfait de cette perspective de relâchement; il se contente alors de lancer au Second Hauser un regard triomphant. Toujours est-il que les réserves de vivres et d’eau douce diminuent dangereusement.
***
Ce matin, un soleil de plomb frappe le navire. La mer est immobile, plus calme qu’une montagne. Seuls Merckens et Hauser viennent me voir à ma cabine pour que je leur fasse la barbe. Le Second est encore vexé de sa défaite de la veille. Il se réfugie, bourru, sous la serviette humide et salée alors que je lui passe le rasoir dans le cou. Merckens, lui, semble apaisé. Je remarque toutefois que les traits de son visage sont tirés, et lui demande s’il ne souffre d’aucun inconfort.
– Non, docteur. Je vous remercie de votre sollicitude.
– C’est tout naturel. Venez me trouver si quelque chose vous embête.
Alors qu’il quitte la chaise, Merckens s’aide de sa main afin de soulever sa jambe droite, comme si elle était trop lourde pour bouger d’elle-même. Son pas légèrement boiteux m’alerte. Il s’agit d’autre chose que d’un simple engourdissement.
***
Aujourd’hui, le Second Hauser tente d’exposer à l’Amiral un plan d’action qui l’élèverait — selon lui du moins — au rang de héros national. La réunion privée entre officiers a lieu dans la cabine de l’Amiral, mais je devine à travers la vitre jaunie du hublot la profonde lassitude de Van Roggen, qui a d’autres soucis que les vaines ambitions de son Second.
***
Autour du grand mât, Jordens, Welter, Calkoen et Paets discutent de leurs épouses respectives, et l’échange se transforme rapidement en un débat animé à savoir laquelle des trois prépare le meilleur waterzooï. Afin de calmer les esprits, De Bruyn, le maître voilier qui parle presque aussi bien qu’il manie poulies et cordages, se lance dans une longue description des « verts pâturages gentiment broutés par des moutons aussi purs que la neige de nos hivers. » Je l’écoute à moitié, mon attention fixée sur l’océan qui nous entoure et qui ondule justement comme une plaine sous le vent.
Sous nos pieds, une voix fredonne gaiement, comme pour répondre à notre mélancolie. Le teint de Merckens est pâle, et je constate l’odeur âcre qui émane de lui, plus poignante encore que la puanteur habituelle de tous mes compagnons. Plus loin sur le pont, Spengler et ces deux idiots de Gülcher et d’Oudemans s’adonnent à des paris. Le perdant doit s’arracher lui-même une dent et la donner au vainqueur. Voilà une curieuse manière de s’amuser avec le scorbut. Et si les dents et les ongles tombent aisément, il en va autrement d’une jambe gangrenée.
***
La nuit est noire, sans étoiles. Tout est prêt. Le bateau tangue légèrement sur les vagues, plus fortes que la veille. Pas assez violentes cependant pour m’empêcher d’opérer avec précision. Lorsque j’ai informé l’Amiral qu’il fallait amputer Merckens de la jambe droite, il s’est contenté de pousser un léger soupir.
– Il ne reste que peu de temps avant que la gangrène n’atteigne les hanches, Amiral.
– Alors vous procéderez ce soir. Welter vous assistera.
Welter, le cuisinier, ne dispose pas des qualifications nécessaires pour m’assister dans l’opération, mais son habitude à voir le sang, sa familiarité avec les couteaux et surtout sa forte corpulence en font le seul candidat apte à retenir le pauvre Merckens.
***
J’ai écarté les papiers de ma table de travail afin d’y allonger le patient, avant de lui nouer solidement un garrot autour de la cuisse. Merckens ne semble pas m’en vouloir de le contraindre à cette opération. Il paraît résolu, mais le tremblement de ses doigts et les clignements de paupières trahissent une évidente nervosité. Je lui tends une bouteille d’armagnac; la toute dernière de ma réserve personnelle. Il la porte cérémonieusement à ses lèvres avant d’en siffler une bonne lampée. Je la lui extirpe doucement des mains, puis lui donne à mordre un morceau de tissu. Je jette un coup d’œil vers Welter qui comprend mon signal et vient déposer ses grosses mains sur les épaules de Merckens. La respiration du patient s’accélère tandis que j’appose le tranchant de la scie sur sa peau. Je pousse un long soupir, me concentre sur le rythme de la houle qui berce le navire, puis j’entame mon travail. Au bout de quelques secondes, Welter en a assez et détourne le regard, visiblement écœuré. Il faut des tripes autrement plus solides pour voir un homme se faire couper une jambe que pour saigner un cochon. Le corps de Merckens tressaute de plus en plus alors que le sang fumant s’écoule de la table jusqu’au plancher de la cabine. Ses hurlements étouffés se promènent au sein du navire, affectant au passage le sommeil et la raison des membres d’équipage, avant d’atteindre le fond de la cale. Le rire sinistre et lointain du prisonnier répond aux cris de douleur sourds de Merckens, tandis que les dents de ma scie craquellent en atteignant le fémur.
***
Je termine de faire la barbe du Second Hauser, qui persiste à venir me voir chaque jour pour sa tonte. Étrangement, cette coquetterie excessive ne me dérange pas. J’éprouve un certain calme à exécuter les mêmes gestes précis à tous les matins. Il me plaît tout particulièrement de sentir un cou sous la lame que je m’applique à manipuler méticuleusement. Couper une jambe à la scie demande un effort considérable. Trancher une jugulaire est beaucoup plus aisé; il suffirait d’un coup de poignet, et le sang frais de notre cher Second irait rejoindre celui de Merckens, séché, sur le plancher de ma cabine.
Hauser se relève et me salue avant de sortir sur le pont. Sans doute va-t-il retrouver l’Amiral pour tenter de le convaincre de sa stratégie. Sa volonté inébranlable me fascine. Alors que l’équipage entier affiche sans retenue son découragement, Hauser ne baisse jamais les bras. Ce garçon possède tout ce qu’il faut pour aller loin dans la marine. Alors que je nettoie mes instruments, trois grands coups secs retentissent à ma porte. Ces imbéciles de Spengler, Gülcher et Oudemans. J’imagine qu’ils ne viennent pas pour la barbe; ils exhibent tous trois un laisser-aller fort éloquent. Ils me demandent ce que j’ai fait avec la jambe de Merckens, leur regard ruisselant d’appétit. Je leur explique qu’il serait plutôt mal avisé de consommer de la viande gangrenée. À moins que l’objectif d’une telle entreprise ne soit de mettre fin à leur misérable existence. Mon ton incisif me surprend. Spengler éclate d’un rire forcé.
– Ça va, mon bon docteur, ça va. On disait ça pour rigoler. Vous faites du sacré bon boulot, vous savez? C’est dommage que ce pauvre Merckens se porte toujours aussi mal…
Il dit vrai. Depuis son amputation, Merckens est alité et combat de terribles accès de fièvre.
– Que voulez-vous, Spengler… Avec davantage d’eau fraîche et de nourriture, il serait déjà sur pied. Enfin, sur celui qui lui reste.
– Et qu’est-ce qu’on fait alors? On attend qu’il n’y ait plus rien du tout? Et après on crève comme des chiens?
– Si vous avez une idée brillante, je vous suggère d’aller la partager à l’Amiral, ou bien à votre ami Hauser.
Spengler soutient un moment mon regard, un air de défi dans l’œil. Puis il sort en ricanant, flanqué de ses deux acolytes. Voilà bien six jours que Merckens baigne dans sa sueur, cloué à son lit, et ses gémissements constants ne font rien pour alléger l’atmosphère.
Depuis l’opération et du moment qu’il ne dort pas, le prisonnier s’est mis dans la tête de siffloter sans cesse le même air agaçant. Au début il parlait, plaidait son innocence, mais le strict régime d’une chopine d’eau et d’un morceau de pain ranci par jour auquel l’Amiral l’a contraint a fini par lui faire perdre la langue. Maintenant il chantonne.
Le vent a recommencé de souffler. Les nuages d’un blanc terne s’amoncèlent peu à peu au-dessus nos têtes. Personne à bord ne sait où nous sommes, jusqu’où nous avons dérivé durant toutes ces semaines. Mais une chose est sûre : chaque jour il fait de plus en plus froid.
***
L’Amiral Van Roggen a convoqué l’équipage à la proue du navire. Il s’adresse à nous avec éloquence, le dos tourné à la mer qui s’agite tranquillement, comme des braises qui se ravivent sous le souffle d’un vent obstiné.
– Mes chers amis, l’heure est grave. Vous avez tous combattu avec honneur et au meilleur de vos capacités la tempête qui s’est abattue sur nous. Et depuis que nous errons impuissants sur cette mer impitoyable, vous êtes demeurés dignes, malgré la faim, la soif et la fatigue.
L’Amiral s’arrête quelque temps. Comme s’il voulait regarder chacun des survivants dans les yeux, avant de poursuivre son discours.
– Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Rien à manger, rien à boire. Nous avons terminé le dernier tonneau d’eau douce cette nuit, en tentant de ramener Merckens à nous. Dieu ait son âme et lui accorde le pardon pour ses péchés. Amen.
Nous répétons en chœur.
– Amen.
Le Second Hauser fait un signe de tête à Paets et De Bruyn, qui larguent le corps sans vie du timonier par-dessus bord, mettant ainsi fin aux funérailles maritimes. L’Amiral reprend.
– J’ai failli à nous sortir de la tempête sans dommage, et j’ai failli à empêcher la tragédie qui a suivi. Krantz croupit dans la cale, il est vrai, mais sa présence est devenue pour moi insupportable. Et en tant que commandant, je ne peux me laisser aller à mes plus bas instincts, qui me murmurent à toute heure d’égorger ce misérable. Alors je vous demande pardon, mes amis. Adieu.
Sur ce mot à peine murmuré, l’Amiral Van Roggen se jette à la suite de Merckens dans l’océan immense et glacé, s’abandonnant à l’ultime déshonneur pour un commandant maritime, celui de ne pas périr avec son navire. Les voix s’élèvent comme une seule sur le pont. Quelques camarades se précipitent pour voir l’eau bouillonner à l’endroit où Van Roggen a plongé, et déjà disparu vers la noirceur des abysses. Le Second Hauser tente d’élever sa voix au-dessus des autres.
– Restez calmes. Suivez mes ordres et nous nous en sortirons, camarades. Je vous le promets.
À peine a-t-il fini sa phrase qu’Oudemans et Gülcher s’emparent de lui, le saisissant chacun par un bras. Tandis que Hauser se débat du mieux qu’il peut, Spengler s’approche sournoisement de lui, puis lui assène un vif coup de pied au milieu du torse. Cela suffit à calmer l’ardeur du Second. Personne ne lève un doigt pour venir en aide à l’officier. L’équipage veut entendre ce que Spengler a à dire.
– Pourquoi on t’écouterait, gamin? T’as entendu l’Amiral, c’est fini. Y’a plus rien. Tu penses qu’ils vont te servir à quoi maintenant, tes gallons?
Spengler retire le chapeau de la tête de Hauser afin de s’en coiffer, puis envoie son poing sur la tempe du Second, qui n’a jamais paru aussi jeune qu’en ce moment où il s’affale sur le pont, tremblotant de douleur et de peur. Spengler se détourne de sa victime pour s’adresser à nous tous.
– Ceci est une mutinerie. Je ne cherche pas à prendre le contrôle du navire. Mais j’ai passé toute ma vie à suivre des ordres et franchement, j’en ai assez. Faites ce que vous voulez avec les forces qu’il vous reste. Moi j’ai envie d’un dernier repas.
***
L’équipage met un certain temps à saisir les propos du nouveau Second. Spengler, Oudemans et Gülcher se dirigent vers l’escalier qui mène à la cale. Ils sont vite suivis par Welter, puis ensuite par Calkoen et Paets. De Bruyn, Jordens et moi-même demeurons sur le pont avec Hauser, qui ne se relève toujours pas. D’un coup, je me décide. Je fonce vers ma cabine avec ce qu’il me reste de résolution afin d’y récupérer des instruments.
Je descends doucement les marches de la cale, sans faire de bruit. Au bout du corridor, la lumière d’une lanterne éclaire Oudemans et Gülcher, qui s’acharnent déjà sur la serrure de la cellule, frappant de toutes leurs forces le verrou à l’aide d’une hache et d’un marteau. De l’autre côté des barreaux, Krantz leur sourit en exhibant les quelques dents noircies qu’il lui reste. Il est rachitique, et ses yeux hagards signalent qu’il a déjà sombré depuis longtemps dans la folie. Tout indique que Welter a pris le temps de passer à sa cuisine, car il s’applique à affuter son couperet en salivant. Spengler observe la scène avec satisfaction. Il me fait dos. J’approche silencieusement, puis parviens à le surprendre par derrière. J’appuie la lame de mon rasoir sur son cou encrassé.
– Je sais que vous n’êtes plus familier avec cet outil, Spengler. Mais je vous assure, ça coupe.
Les deux gorilles cessent de cogner la serrure. Tous me regardent, immobiles et en silence. Jordens et De Bruyn apparaissent derrière moi. Je leur indique d’aller rejoindre les autres.
– Lâchez vos instruments, messieurs. Nous avons tous très faim, mais je préférerais ne pas nous voir sombrer dans l’anthropophagie. Surtout que cet homme est sans doute innocent.
Le silence persiste un instant. Puis Paets, le marin le moins loquace de l’équipage, s’avance d’un demi pas pour prendre la parole.
– Vous avez entendu l’Amiral comme nous, docteur. C’est Krantz qui partageait la cabine de Gustav. C’est lui qui était chargé de le surveiller.
– Il n’y a aucune preuve, aucune. Personne n’a vu Krantz sortir de sa cabine cette nuit-là. Personne n’a même entendu le corps de Gustav tomber à l’eau. Et puis le fils de l’Amiral était mort de peur depuis la tempête. Jamais il n’avait mis les pieds sur un navire auparavant. Sa raison ne tenait qu’à un fil. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne se jette à la mer de sa propre initiative.
Spengler ricane dans sa barbe hirsute. Son gloussement résonne dans sa poitrine creuse tandis que je respire son souffle chaud et nauséabond. Je m’assure qu’il n’oublie pas la lame froide sur sa peau.
– Pas si sûr docteur, pas si sûr … j’étais dans la cabine d’à côté cette nuit-là. Moi aussi j’entendais les pleurs incessants de ce trouillard. Ça durait depuis des jours. Assez pour rendre n’importe qui complètement fou. Vers minuit, j’ai entendu un coup sourd, puis plus de bruit. J’étais ravi que Krantz ait finalement décidé de faire taire le pleurnichard. Mais quand même : balancer le fils de l’Amiral par-dessus bord!
Dans sa cellule, Krantz éclate d’un rire à glacer le sang. Oudemans saisit la hache qui gisait sur le sol près de lui et, d’un coup décisif, fait sauter la serrure de la porte qui s’ouvre aussitôt en émettant un grincement sinistre. Au moment où je lâche Spengler pour tenter de m’interposer, une vague violente nous envoie tous choir sur le plancher de la cale. En me relevant, j’aperçois le Second Hauser qui se tient au-dessus de Spengler, toujours au sol. Le Second lui enfonce son épée dans le côté du crâne, bien plus profondément que lorsqu’il entaillait le grand mât pour compter les jours.
Hauser halète par-dessus sa victime, le regard égaré. L’équipage brandissant hache, marteau, poignard et couperet se rue alors sur Krantz qui continue de rire de toute l’ampleur que lui permet sa voix éraillée. Dehors, sur le pont, il n’y a plus personne. Le ciel s’assombrit. Les nuages s’épaississent. Le vent tourbillonne avec une ardeur renouvelée. Et des flocons de neige épars se mettent à tomber lentement. Une terre inconnue apparaît au loin, qu’aucun d’entre nous ne verra jamais. J’empoigne ma scie, celle qui a servi à amputer Merckens, puis je me joins à mes camarades.