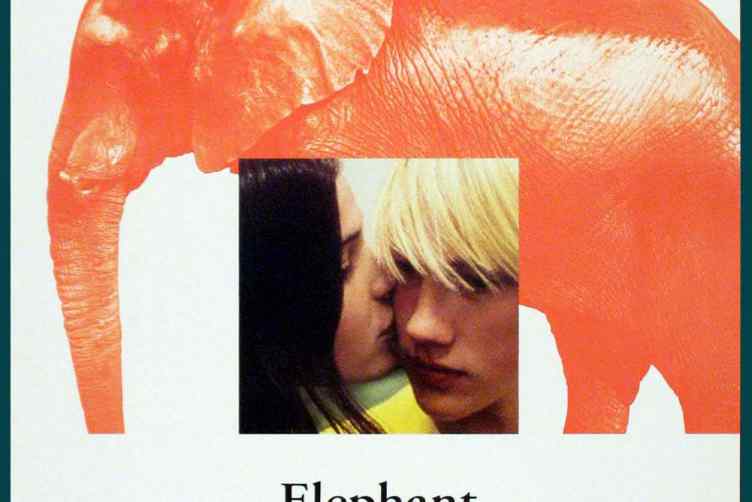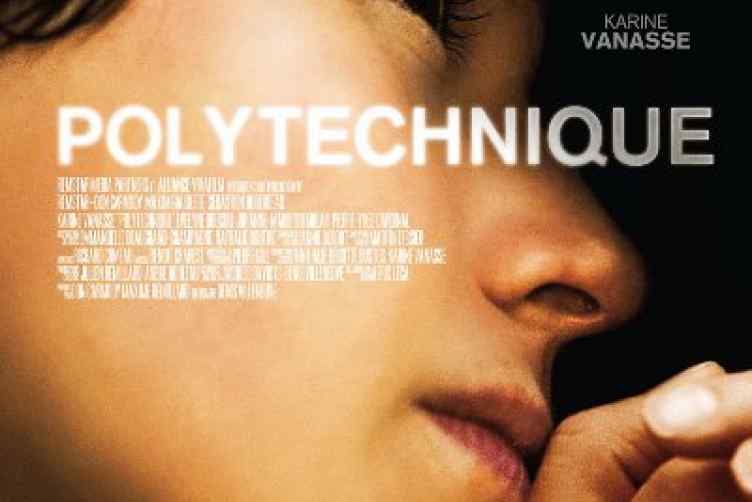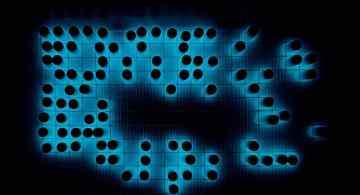À la fin de janvier 2013, le monde culturel québécois s’est enflammé autour du mini-scandale médiatique causé par la diffusion du premier épisode de la deuxième saison de la série télé 19-2. Le retour de la série policière du réalisateur québécois Podz était très attendu. La première saison, diffusée à Radio-Canada à l’hiver 2011, soit deux ans plus tôt, avait été saluée par la critique journalistique pour ses nombreuses qualités : entre autres le jeu des acteurs, la psychologie des personnages, la réalisation, le réalisme des situations et la justesse du portrait des policiers montréalais. Cette première saison avait aussi recueilli la faveur du public québécois en général. Les honneurs au gala des prix Gémeaux 2011 avaient suivi : 19-2 avait été finaliste dans la catégorie « Meilleure série dramatique » et l’avait emporté dans les catégories du « Meilleur texte » et de la « Meilleure réalisation » pour une série dramatique. Bref, pour dire les choses comme on aime les dire à la télé, le Québec entier avait suivi de près et avec intérêt les aventures de Nick Berrof et de Benoît Chartier, patrouilleurs affectés à la voiture numéro 2 du poste de quartier 19 du Service de police de la Ville de Montréal (un commissariat fictif1). Les dix épisodes d’un peu plus de quarante minutes chacun de cette fiction policière à la facture somme toute classique préconisaient moins de centrer l’attention sur les enquêtes à mener ou sur les crimes perpétrés que sur le quotidien des deux patrouilleurs. Le téléspectateur de 19-2 accompagne les protagonistes dans leur journée de travail : au poste de police, bien sûr, face à leurs supérieurs hiérarchiques, ou sur le « terrain », dans leur voiture… Mais il les voit aussi sans leur uniforme, au réveil chez eux le matin ou au bar fréquenté par le corps policier après le boulot. Règle générale, chaque épisode relate trois, quatre ou cinq interventions différentes : ce peut être une poursuite à pied, une arrestation musclée, un sauvetage in extremis, une contravention pour abus de vitesse et ainsi de suite.
En résumé, 19-2 raconte de l’intérieur la vie des deux policiers et de leurs collègues : celle-ci nous est montrée du point de vue qui est le leur. D’ailleurs, le téléspectateur les voit souvent de très près, grâce à de fréquents gros plans du visage de l’acteur, comme s’il était assez près du personnage pour lui parler, assez ami pour lui tapoter l’épaule familièrement. On a de plus accès à la psychologie intime des héros, grâce à la mise en place de ce que Stéphane Benassi appelle des « micro-récits analeptiques » (94), autrement connus sous le nom de « flash-backs », qui sont fournis par des plans rétrospectifs évoquant les souvenirs (souvent douloureux) des personnages. Ces micro-récits interrompant brièvement le fil de l’action sont signalés au téléspectateur par l’emploi voyant d’un filtre de couleur brun qui confère à l’image un aspect vieillot et chaleureux2, contrastant fort avec les blancs, les bleus pâles et les gris métalliques qui dominent les scènes montrant les policiers au travail. « Moi, je voulais du blanc très éclairé pour la vie au poste et plus d’ombre dans la vie privée des policiers », précise Claudine Sauvé (Petrowski, 2011), directrice photo de la série : façon de faire un clin d’œil, par la caméra, à la froideur et à l’imperturbabilité qui sont attendues et exigées de nos agents de la paix en toute circonstance. Plus remarquables encore sont les courts plans-séquences où les démons intérieurs, les fantômes qui habitent la psyché du personnage, surgissent et disparaissent sans recours à d’autres effets spéciaux qu’une habile chorégraphie de la caméra et des acteurs (cela suffit à créer l’illusion de la présence de l’individu auquel songe le personnage et à la dissiper aussitôt) : on voit notamment l’agent Berrof surprendre sa maîtresse avec un de ses collègues dans son propre lit, la caméra se détourne un moment des ébats, puis revient éventuellement à eux, mais les partenaires se sont volatilisés; de toute évidence Berrof rêvait éveillé (Podz, 2011, « Épisode 8 »: 3 min 45 s à 4 min 34 s).
Le premier épisode de la deuxième saison, celui qui a commotionné le Québec, s’inscrit pleinement dans cette veine (Podz, 2013, « Épisode 1 »: 43 min). Le récit reprend le fil des intrigues (policières et amoureuses) là où la première saison les avait laissées; un segment récapitulatif de deux minutes et demie vient rappeler les grandes lignes et les moments forts de la première saison3, puis on retrouve l’ensemble des principaux personnages au poste 19 du SPVM pour le rituel matinal du fall-in, où le sergent superviseur fait le bilan des dossiers à suivre pour son équipe, délègue les tâches du jour, établit les plages horaires de pause de chaque tandem. Rien d’extraordinaire : de semblables scènes jalonnent la première saison. On notera que l’action de cet épisode s’étend sur une journée complète dans la vie des constables Berrof et Chartier, et non sur quelques jours ou sur une semaine, comme c’est plus souvent le cas; cela dit, ce n’est pas la première fois, à ce stade de la série, qu’un épisode se centre sur un seul quart de travail des policiers4.
Le sang qui a fait voir rouge
Qu’est-ce, alors, qui distingue le premier épisode de la deuxième saison de 19-2 des dix premiers de la série? Ce qui a tant choqué l’opinion concerne d’abord et avant tout le sujet qui y est développé. Dès le 16 janvier 2013, suite au visionnement anticipé auquel les membres de la presse ont eu droit, un chroniqueur du Journal de Montréal déclarait être resté « bouche bée » devant l’audacieux début de la deuxième saison :
Un épisode dont je ne peux dire que du bien : superbement réalisé par Podz, scénarisé impeccablement par Danielle Dansereau et produit avec tout le professionnalisme dont sont capables Sphère Media Plus et sa productrice Sophie Pellerin. Il n’y a qu’un problème, mais il est de taille : le sujet! (Fournier.)
Il s’agit d’une tuerie dans une école secondaire, perpétrée par un adolescent de quinze ans. Voilà certes un sujet délicat à aborder, qui touche des cordes sensibles et des valeurs fondamentales de la société contemporaine : le caractère sacré de l’enfance et de l’innocence juvénile, la question épineuse de la criminalité infantile, le débat récurrent au Canada du contrôle des armes à feu, etc. Les fusillades en milieu scolaire sont, il faut le souligner, un fléau contemporain dont Montréal semble être une cible favorite, quand on pense aux attentats de l’École Polytechnique (6 décembre 1989), de l’Université Concordia (24 août 1992) et du Collège Dawson (13 septembre 2006). Une par décennie, glosent les plus alarmistes. En plus, la terrible tuerie de l’école primaire Sandy Hook à Newtown, au Connecticut, venait de se produire à peine un mois plus tôt, le 14 décembre 2012. Bien qu’il soit entièrement indépendant de la deuxième saison de 19-2, dont le tournage était bouclé avant la tragédie, ce fait aggravait, en janvier 2013, la sensibilité du public québécois à tout ce qui pouvait toucher aux fusillades — réelles ou fictives.
Cela dit, le sujet ne paraît pas beaucoup plus difficile à manier que d’autres ayant déjà été abordés de front par la série. Prenons, pour nous en tenir à une réalité avérée à Montréal, l’exemple du rapt des jeunes fugueuses par les réseaux de prostitution et de trafic de personnes, un problème lui aussi apparemment inexpugnable et lié, là encore, à l’insoutenable violence faite aux enfants. Il faut également rappeler que, du reste, des tueries en milieu scolaire avaient déjà été racontées par des cinéastes étrangers aussi bien que québécois. En 2003, Gus van Sant avait proposé Elephant; Denis Villeneuve six ans plus tard offrait Polytechnique, deux œuvres reçues favorablement par la critique journalistique et par le public québécois. Gus van Sant avait préconisé de présenter une tuerie inspirée de celle de Columbine, et de la donner à voir de manière très détachée, presque objective, en suivant les deux tueurs du début de leur journée jusqu’à la terrible fin, avec des prises de vue variées mais distantes et dispersées à travers les divers corridors et salles de l’école, façon qui mimait une forme d’omniscience et qui en même temps laissait entendre qu’on suivait les événements par les caméras de surveillance des lieux. Le pari relevé par Denis Villeneuve consistait, toujours au moyen d’une fiction de facture le plus réaliste possible, à mettre de l’avant le point de vue des victimes, pendant et après le massacre de Polytechnique. Quoi de plus logique, étant donné le profil de la série 19-2, que le téléspectateur suive, cette fois, non les tueurs ou les victimes, mais les policiers? Ne sont-ils pas des acteurs importants eux aussi, dans ce genre de drame5? À bien y penser, on cherche en quoi cet épisode-là spécifiquement, le premier de la deuxième saison de 19-2, a pu tant déranger l’opinion au Québec. Et, pour trouver réponse, au lieu de hasarder un éventail d’hypothèses à propos des spécificités de la société contemporaine en général ou de l’imaginaire social québécois en particulier, il peut convenir de procéder à un rapide survol des échos journalistiques qui ont retenti autour de cette tuerie fictive diffusée le 28 janvier 2013. Après tout, la tempête a surtout sévi dans et par les médias traditionnels.
C’est une célèbre chroniqueuse québécoise, elle-même écrivaine et scénariste à ses heures, qui a mis le feu aux poudres de l’indignation avec le plus de véhémence, dans une chronique intitulée « Un trop long bain de sang » (Petrowski, 2013). Son premier grief concernait — cela peut surprendre — le fait que l’attentat dépeint dans 19-2 était fictif et ne s’offrait pas comme la reconstitution transparente et exacte d’un drame particulier : aux yeux de la chroniqueuse, le film de Denis Villeneuve aurait aidé la société québécoise « en quelque sorte à exorciser [le] traumatisme » d’un souvenir douloureux quoique ancien, tandis que « [l]a tuerie dans 19-2 est une tuerie générique qui n’est pas liée à un événement précis et qui, par conséquent, ne nous libère de rien, mais nous enfonce dans le marécage trouble et confus de la violence gratuite et de la folie meurtrière d’un jeune détraqué » (4). Sur ce point spécieux, il faut souligner qu’elle reste à faire, la démonstration qui prouverait qu’une fiction librement inspirée d’un amalgame de faits avérés est moins efficace, et surtout moins salutaire en termes cathartiques, qu’une fiction inspirée d’un événement unique et identifiable. Mais passons, car voici que nous touchons au point le plus sensible de l’argumentaire déployé dans ce billet, dont je devrai citer encore deux longs extraits, pour qu’on saisisse bien de quoi il retourne :
Je ne suis pas sans savoir que le concept même de 19-2 consiste à faire vivre aux téléspectateurs le quotidien glauque et éprouvant des policiers patrouilleurs. Je peux même concevoir qu’une fusillade dans une école soit l’événement le plus traumatisant du vécu d’un policier et qu’à Montréal, en 2013, cet événement est tout à fait plausible et probable. Mais pourquoi le téléspectateur devrait-il vivre cette épreuve seconde par seconde pendant 35 longues minutes? Quelle est l’utilité sociale visée? Quelle leçon de vie cherche-t-on à nous communiquer? Que c’est dur d’être policier? Après une saison complète de 19-2, je pense qu’on avait compris. (Petrowski, 2013: 4.)
Utilité sociale de l’art, leçon de vie que l’auteur veut transmettre, morale de l’œuvre… Sommes-nous au milieu du XIXe siècle? On pourrait le croire, car ces reproches sont exactement ceux qu’adressa Sainte-Beuve, le grand critique littéraire, à Gustave Flaubert pour sa Madame Bovary en 18576. La comparaison est peut-être flatteuse pour Podz et pour les scénaristes de 19-2; ce n’est point le lieu ici d’en juger (la postérité s’en chargera). Il reste que le rapprochement est instructif. Curieusement — faut-il pourtant s’en étonner? — les acquis désormais séculaires de l’art pour l’art semblent s’évanouir lorsqu’une production culturelle (qu’elle soit œuvre d’art ou de divertissement importe peu sur ce plan) atteint un public assez large et soudain ébranle celui-ci en l’amenant hors de sa zone de confort.
Le réalisme brut, toujours trop noir
Si les spécialistes des séries télé sont nombreux à avoir souligné, comme le faisait Stéphane Benassi il y a déjà quinze ans, que « la fiction sérielle […] est l’héritière sémiotique et narratologique (parfois même diégétique) du roman-feuilleton populaire du XIXe siècle » (28), le cas qui nous intéresse donne visiblement à penser qu’elle est également l’héritière de la grande littérature de ce siècle-là, dont le roman réaliste, avec sa narration omnisciente si caractéristique, est l’emblème classique entre tous. D’ailleurs, l’objection première de ceux qui se formalisèrent de voir une tuerie fictive être diffusée à heure de grande écoute si peu de temps après les événements de Newtown tenait justement au fait qu’il leur semblait irresponsable de présenter « [u]n épisode d’un tel réalisme et d’une pareille violence » (Fournier).
Il n’est pas superflu, par conséquent, de revenir sur cette notion capitale qu’est le « réalisme ». Le vocable peut prêter à confusion, tant son champ d’application semble étendu dans la vulgate critique d’aujourd’hui, notamment au sein des médias de masse, lesquels parlent autant du réalisme d’une représentation artistique au rendu particulièrement réussi (quelle qu’elle soit : visuelle, textuelle, auditive, etc.) que de celui d’un buteur de football qui sait mieux que les autres envoyer le ballon rond au fond des filets quand l’occasion se présente (le réalisme devient ainsi synonyme d’opportunisme; et le but marqué, une réalisation n’ayant rien à voir avec celle d’un réalisateur comme Podz). Rappeler ici des éléments qui paraîtront peut-être évidents au spécialiste du roman français du XIXe siècle replacera 19-2 dans l’histoire des représentations et fournira une brève mise au point théorique à ceux qui pourraient sourciller de me voir appliquer ce terme technique — caractérisant une pratique artistique et littéraire instituée depuis 150 ans — à une production télévisuelle toute récente, fermement ancrée dans notre nouveau millénaire (Glevarec). Dans son acception artistique la plus large, la notion de réalisme englobe toute œuvre prétendant reproduire scrupuleusement la réalité. En cela, comme le signale la spécialiste Éléonore Reverzy dans un essai récent, le réalisme constitue « une notion essentielle et récurrente dans l’art occidental, déjà sensible dans le Satiricon de Pétrone au Ier siècle de notre ère ou dans les romans du XVIIe siècle » (7). Néanmoins, le terme de réalisme, lui, ne s’est imposé qu’à partir des années 1850 en France, autour de la revendication anticonformiste d’un art figuratif dépouillé des enjolivements mensongers de l’idéalisme et libéré des interdits moraux de la religion. Le peintre Gustave Courbet, qualifié dès 1853 de « chef de l’école du laid7 », organisa en 1855, parallèlement à l’Exposition universelle (haut-lieu du bon goût officiel et des sujets académiques prisés par l’esprit bourgeois du Second Empire), une exposition qu’il intitula « Du réalisme », afin d’afficher librement son parti pris de peindre le réel tel quel, sans embellie; les sujets de ses toiles scandalisaient ses contemporains, parce qu’elles montraient des réalités que l’élite bienpensante refusait de voir. L’année d’après, son ami Edmond Duranty fonda la revue Réalisme, « protestation raisonnée de la sincérité et du travail contre le charlatanisme et la paresse » (Duranty: 1), tandis qu’un troisième comparse, Jules Champfleury, allait recueillir en 1857, sous le titre Le Réalisme, une série d’articles de critique journalistique dans un volume théorisant son engagement pour un art littéraire « affranch[i] du beau langage » et réclamant le droit de dépeindre avec précision et sans concession « jusqu’aux classes les plus basses » (Champfleury: 5-6), c’est-à-dire la vérité nue et toute entière, y compris ses côtés moins charmants. La même année, deux livres furent traduits en justice par l’État français pour « outrage à la moralité publique et religieuse et aux bonnes mœurs » : Madame Bovary de Flaubert et Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Dans chacun de ces procès, dont le retentissement dans la presse fit davantage pour attirer l’intérêt du public sur l’œuvre incriminée que pour l’en détourner, le réalisme était en cause; les autorités se proposaient de censurer, au nom de « la décence publique », la littérature qui peint « la haine, la vengeance, l’amour […] sans frein et sans mesure8 ». Tels sont les événements ayant présidé à la popularisation d’un mot-drapeau qui, jusque-là, avait été surtout employé dans la presse conservatrice pour dénigrer des œuvres choquantes, réputées scabreuses ou immorales — un mot ambivalent9 que d’ailleurs nombre des plus grands romanciers considérés de nos jours comme maîtres du genre, par exemple Balzac (mort trop tôt), Flaubert ou les frères Goncourt (réfractaires à toute étiquette qu’on veuille leur apposer), n’acceptèrent pas de leur vivant.
En somme le réalisme, qu’on peut définir avec Éléonore Reverzy comme l’ambition de générer, par la littérature ou l’art, « une représentation du monde délibérément anti-idéaliste, qui veut dénoncer les illusions trompeuses » (8), réunit sous sa vaste bannière, si l’on sonde les cinq ou six derniers siècles, une population hétéroclite de penseurs, d’écrivains, d’artistes aux tempéraments, aux méthodes et aux convictions fort différentes — tous enclins à répondre, devant les grimaces de leurs contemporains dégoûtés, que ce n’est pas leur œuvre qui est laide ou ignominieuse, mais bien la réalité qu’ils ont choisi de dépeindre. Ils se caractérisent par leur propension à puiser l’inspiration dans les faits caractéristiques de leur époque, à représenter le réel qui les entoure, le monde moderne, par « mimésis » (Auerbach), au lieu d’imaginer des ailleurs différents (utopiques, fantaisistes, passés ou futuristes). Partant de la conviction qu’aucun pan du réel n’est irrecevable dans l’univers artistique, ce qui revient à dire que tout mérite potentiellement d’être décrit, l’écrivain réaliste en France au XIXe siècle, en quête de trouver le « détail vrai10 » apte à générer « l’effet de réel » que Barthes allait théoriser au siècle suivant, préférait s’attarder aux facettes qu’il estimait délaissées par l’art conventionnel de son époque, en particulier celles qui dérangent, gênent ou choquent l’opinion, pour les examiner de fond en comble, les prendre à bras le corps et les exposer au grand jour, avec l’objectivité, la froideur et la rigueur de l’anatomiste et du physiologiste11, censés examiner l’humain sans s’émouvoir, celles du greffier, qui sans sourciller enregistre les paroles et les données impartialement et exhaustivement, ou encore celles du patrouilleur, qui au nom de la paix collective doit analyser avec discernement le fil des événements et réagir avec sang-froid à des situations tendues.
Nombreux sont les policiers québécois à avoir été sondés par la presse écrite dans la foulée de la diffusion du premier épisode de la deuxième saison de 19-2; on cherchait à connaître leur opinion sur la justesse de la représentation proposée. La très grande majorité de ces gens de métier ont insisté, précisément, sur le « réalisme » de la fusillade orchestrée par Podz et son équipe (Parent; Blanchard; Deschênes) : à les entendre, la fiction de l’épisode collerait de très près à la vérité des tueries en milieu scolaire12. Tel est bien, du reste, l’objectif poursuivi par les principaux artisans de 19-2. En entrevue, ceux-ci attestent l’ambition délibérée de rendre compte le plus fidèlement possible du vécu réel des policiers et des intervenants impliqués13, et de se documenter adéquatement en engageant régulièrement des policiers à titre de consultants, par un scrupule communément partagé d’adhérer à « un grand souci de réalisme » (Guy), réitéré encore tout récemment par la directrice photo de la série.
De fait, c’est le caractère brut du réalisme de Podz qui a dérangé les journalistes en janvier 2013 : « On a dit et répété que le long plan-séquence de l’épisode inaugural de la nouvelle saison de 19-2 accentuait l’impression de réalisme. Comme si une caméra de reportage se promenait en direct sur la scène. D’où l’argument […] voulant que cette série, ou en tout cas cette scène, célèbre le mal même malgré elle », constate Stéphane Baillargeon du Devoir (2013a), faisant écho, le matin de la diffusion de l’épisode litigieux, aux réactions suscitées par le visionnement anticipé. Le tollé — émergeant non du public, mais des journalistes conviés à l’avant-première qui l’anticipent et le créent tout à la fois — relevait d’un reproche qui a toujours été au cœur des blâmes adressés à la représentation réaliste du réel en art : le sensationnalisme des images très « cliniques », livrées à « froid » (Petrowski, 2013: 4), montrées « sans affect », de manière « crue et insistante » (Cassivi). J’ai repris à dessein les formules des chroniqueurs de La Presse, parce qu’elles appartiennent au même registre que celles qu’avait utilisées Sainte-Beuve pour décrire l’art de Flaubert, lequel tenait selon lui « la plume comme d’autres le scalpel » (1444). Cela m’amène au deuxième long extrait à citer de cette chronique réactionnaire où le réalisateur de 19-2 est critiqué pour avoir « film[é] sans retenue, sans filtre et parfois avec un peu trop d’insistance le sang, la violence, et la traque folle et aveugle des policiers lancés aux trousses du tireur » (Petrowski, 2013: 4). C’est un véritable procès d’intention échafaudé contre le réalisateur et les scénaristes de la série :
Pour raviver la flamme du public pour 19-2 et nous faire à nouveau aimer les flics, il fallait un premier épisode qui cogne fort et qui fasse jaser. Il fallait surtout un drame poignant où l’héroïsme policier pourrait se déployer dans toute sa splendeur. Dommage qu’on ait choisi ce trop long bain de sang pour y arriver. (Petrowski, 2013: 4.)
Le billet se termine sur ces mots. Certes, quelques collègues du même journal et de quotidiens concurrents ont veillé à tempérer la charge, parfois avec beaucoup de justesse14, sans toutefois se priver d’attiser le débat en choisissant pour leur propre article des titres tonitruants, comme « 19-2. Treize minutes de terreur » (Dumas), « Intense 19-2 » (Doré), « La SQ craint la scène de 19-2 » (Bergeron15), « 19-2. En plein cauchemar » (Therrien, 2013a) ou « Et que ça saigne! » (Baillargeon, 2013a).
Le « graphique » et ses lourdeurs
Si les claviers se sont embrasés, c’est donc surtout à cause de la « manière16 » dont Podz et son équipe ont traité le sujet. Pour le dire avec une formule usitée, qui est à la fois un anglicisme, un pléonasme et un euphémisme élégant, on en a eu contre la nature graphique des images diffusées. Il n’y avait pourtant là rien de neuf, à l’échelle de la série 19-2, qui souvent montre le sang gicler, le corps tuméfié, etc. Ce n’était pas nouveau à l’échelle de la carrière de Podz non plus, dont le style est réputé « un brin heavy » (Dumas: 4)17. Il n’en demeure pas moins que les critiques de La Presse ont souligné, à propos du premier épisode de la deuxième saison, son « approche cinématographique […] brutale » (Dumas: 4), ou encore « sa maîtrise technique [mise] au service de la reproduction — et rien que la reproduction, pure et exacte — d’une abomination » (Petrowski, 2013: 4). Marc-André Lemieux du Journal de Montréal prévenait ses lecteurs contre un épisode « d’une rare intensité dramatique, prenant et violent ». Stéphane Baillargeon au Devoir, quelques mois plus tard, dénigrerait « les excès stylistiques de 19-2 » (2013b), allusion nette à l’épisode diffusé le 28 janvier 2013. Des travailleurs sociaux, des enseignants, des pères de famille s’en sont mêlés : qui pour prévenir très sérieusement les lecteurs du Devoir que « lundi soir prochain […] plusieurs enfants ainsi que leurs parents vivront un traumatisme psychologique par le biais du petit écran » (Straehl), qui pour s’inquiéter dans La Tribune « de la banalisation de la violence » (Pion), qui pour déplorer dans La Presse « un manque d’éthique » de la part des auteurs et du diffuseur sur la base que « [l]aisser le public imaginer aurait été préférable » (Pilon). On en est venu à se demander, par un magnifique retournement de l’information sur elle-même — le serpent médiatique dressé par l’homomédiaticus contemporain sait se manger la queue comme nul autre —, si les événements présentés dans le fameux épisode (très étroitement inspirés de faits réels survenus au Québec) pouvaient réellement se produire à peu près ainsi dans la Province : « Une tuerie dans nos écoles comme dans 19-2? », titre Karine Blanchard dans La Voix de l’Est, démontrant par l’exemple que Jean-Marie Schaeffer ne se trompait pas quand il a affirmé qu’« il arrive que la vie imite l’art (mimétique), mais elle n’en imite que ce qui dans celui-là imite (déjà) la vie » (40).
D’aucuns dans leur indignation ont même parlé d’un « parti pris esthétique ultra réaliste » (Cassivi)18, voire d’une approche « hyperréaliste » (Dumas: 4; Roy; Straehl). Qu’on me permette une digression rapide à propos de ce mot, l’hyperréalisme. Je vois mal ce que ça pourrait bien être : plus réaliste que le réalisme? Mais alors le réalisme ne serait pas (ou pas assez) réaliste? Comment distinguer l’un de l’autre? Et faut-il, conséquemment, se demander s’il existe un hyporéalisme, qui serait moins réaliste encore que le réalisme tout court? Je laisse ces questions ouvertes19, et je referme la parenthèse, pour revenir à l’usage du mot réalisme, dont il faut nuancer l’emploi si on veut l’appliquer à qualifier le travail de Podz dans cet épisode. Car on est très loin de l’objectivité du regard omniscient qui montre tout sous tous les angles : la distance instaurée face aux événements représentés est non pas accrue par le jeu de la caméra du réalisateur de 19-2, mais réduite au minimum, de manière à impliquer le téléspectateur le plus possible dans la traque du tueur, afin de l’immerger en première personne dans l’action de la tuerie. D’ailleurs, le moment peut-être le plus angoissant de l’épisode est celui où la caméra délaisse ses « amis » les policiers et traverse seule, pendant trente-cinq secondes, la grande salle centrale de l’école, jonchée d’agonisants et de cadavres (Podz, 2013, « Épisode 1 »: de 16 min 10 s à 16 min 45 s). Aussi les commentaires des journalistes et chroniqueurs rendent-ils pleinement compte du côté poignant de la participation subjective suscitée par l’approche du réalisateur : Podz « pren[d] pour ainsi dire le téléspectateur en otage » (Cassivi), lui imposant « une scène extrêmement difficile à regarder » (Dumas: 4), et ainsi de suite.
En sorte qu’on peut s’interroger sur le bien-fondé de l’usage que la presse écrite, et moi après elle, avons fait du mot « réalisme », quand nous l’avons appliqué à décrire le premier épisode de la deuxième saison de 19-2. Si les formules « hyperréalisme » et « ultraréalisme » paraissent boiteuses, la notion de réalisme est certes, dans sa définition générale, assez vaste pour accueillir confortablement des représentations fictives comme celle qui ouvre la deuxième saison de la série. Toutefois, il serait peut-être plus juste, au lieu d’employer un terme aussi lourdement connoté historiquement (notre XXIe siècle n’est pas le XIXe de Flaubert, Zola et compagnie) et génériquement (une série télé diffère substantiellement d’un roman), d’emprunter à Jean-Pierre Esquenazi son concept de la « vérité fictionnelle20 », pour décrire la justesse de l’univers fictif créé par Podz. L’avantage d’un mot comme « réalisme », en revanche, tient à ce qu’il est largement répandu, usité d’assez longue date et universellement compris dans l’acception qui nous intéresse. C’est pourquoi il continue de s’imposer21.
La texture du temps réel et les longueurs de sa durée
Une chose est sûre, les chroniqueurs culturels des principaux quotidiens francophones du Québec s’entendaient, au début de 2013, pour souligner la question de la durée de la fusillade telle que présentée dans 19-2. L’une lamente « une douloureuse et interminable tuerie » (Petrowski, 2013: 1), l’autre applaudit un « véritable tour de force de réalisation » qui serait à la fois « d’une violence par moments insoutenable » et « une pièce d’anthologie télévisuelle » (Cassivi); un tiers apprécie que l’action se déroule « en temps réel » (Therrien, 2013a), tandis qu’un autre s’exclame « ça s’étire sur près de 35 minutes », arguant que « [c]’est intenable » (Dumas: 4) pour un épisode d’environ quarante-quatre minutes, soit plus des trois quarts.
On est en droit de s’étonner que la longueur de la tuerie soit le point de ralliement des doléances comme des enthousiasmes envers cet épisode. Ce qu’il faut comprendre, c’est que non seulement l’épisode est consacré tout entier à raconter la journée de la tuerie, un peu comme l’épisode 3 de la première saison l’avait été à dépeindre les affres d’un premier du mois, mais en plus les trente-cinq minutes de télé pendant lesquelles on suit l’action dans l’école secondaire comportent très peu d’ellipses temporelles; le téléspectateur peut même avoir l’impression qu’il n’y en a pas du tout, en sorte qu’il croit suivre la tuerie pas à pas, en temps réel, du début à la fin. Là se situait la nouveauté : jamais avait-on, dans l’univers de 19-2, suivi une même séquence d’action de manière continue sur plus d’un segment entrecoupés de publicités; jamais la contrefaçon du real time n’avait été maintenue aussi longtemps. Ce morceau de bravoure rendait palpable la volonté d’intensification de l’aspect dramatique de l’événement évoqué. Devenait manifeste l’ambition de frapper un grand coup avec cette première de la deuxième saison.
À cela s’ajoutait que le premier segment de la tuerie, ces fameuses « treize minutes de terreur » alléguées par le chroniqueur télé attitré de La Presse, étaient filmées d’un seul coup, caméra à l’épaule, dans un long plan-séquence chorégraphié avec précision, de manière à ce que l’œil de la caméra talonne les agents Berrof et Chartier, premiers rendus sur les lieux, comme si le téléspectateur les accompagnait à travers le dédale des couloirs en tant que troisième membre du tandem.
En cela aussi, on se trouvait devant du jamais-vu dans la série, bien que, il faut le rappeler, le premier épisode de la première saison comportait, lui aussi, un long plan-séquence. Certes beaucoup plus court, trois minutes contre treize, et surtout beaucoup moins percutant, ce premier long plan-séquence n’ouvrait pas à strictement parler, lui non plus, l’épisode; il constituait tout de même une prouesse technique qui intervenait au tout début de la saison, après quelques minutes à peine de visionnement, et qui donnait le ton à la saison entière, en plongeant le téléspectateur dans le milieu de travail des personnages, un matin au poste de police, juste avant le fall-in. Pour l’ouverture de la saison 2, c’est juste après le fall-in, et pendant de bien plus longues minutes, que le téléspectateur se trouve à faire partie de la brigade de policiers du 19, seconde par seconde.
Une série sortie de sa sérialité
Tout bien considéré, d’une saison à l’autre l’unité diégétique de la série télé 19-2 est préservée, la continuité des intrigues également. Il en va de même du point de vue adopté, du souci de faire vrai et de la volonté de ne rien escamoter malgré les éventuelles appréhensions ou récriminations des plus frileux d’entre nous. Un relevé exhaustif des invariants s’étendrait encore longtemps, et, à lire la protestation formulée par la chroniqueuse vedette du magazine Urbania à l’endroit de la troisième saison, qui vient clore 19-2, on est fondé à croire que la marche de la série n’a pas sensiblement dévié de son trajet initial : « en cas de doute, la réalisation se tournera vers le choix le plus scabreux possible. La subtilité en paiera malheureusement le prix. » (Lussier.) Pourtant, avec l’épisode de la fusillade, la sérialité de la série, au sens où l’entend Umberto Eco22, s’est trouvée précarisée, par l’adoption du « temps réel » sur un intervalle de temps beaucoup plus grand qu’à l’habitude (presque l’intégrale de l’épisode); la matrice sérielle de la série a été ébranlée encore davantage par ce long plan-séquence, qui est plus de quatre fois plus long que le plus long des plans-séquences auxquels avait eu droit le téléspectateur jusque-là. Pour le dire au moyen d’une image, la deuxième saison de la série 19-2, avec son premier épisode, danse sur le même pied et sur le même air qu’auparavant; toutefois, le rythme a complètement changé, il a ralenti. De ce fait la texture de la durée a gagné en rugosité, et la sensation de son passage s’est puissamment intensifiée; elle n’a retrouvé son allure « normale » que la semaine suivante. Or, on sait, grâce entre autres aux travaux de Jean-Pierre Esquenazi, que la régularité est la qualité formelle première des téléséries23. À bien y regarder, il semble que ce soit avant tout en raison de ce hiatus que cet épisode a tant dérangé et a paru constituer, aux yeux de certains, un infâme faux-pas télévisuel. D’ailleurs, la chroniqueuse outrée de La Presse mentionnait la chose d’entrée de jeu, dès les premières lignes de son billet; et, pour faire honneur à cette perspicacité, je la cite une dernière fois : « le premier épisode de la deuxième saison de la série policière 19-2 n’est pas un épisode comme les autres. Oh! que non », s’exclamait-elle (Petrowski, 2013: 1).
Revenir brièvement sur l’incartade perpétrée par 19-2 en janvier 2013 et dépouiller les réactions qu’elle a suscitées au sein de la presse écrite permet ainsi de constater l’inanité des distinguos entre réalisme et effet de réel que cherche à établir une certaine critique pour différencier les pratiques actuelles de la fiction de celles des siècles passés. On peut très bien poser l’hypothèse suivante en faisant fi de ce qu’est, de ce qu’a été et de ce que peut être le réalisme : « Tandis que le réalisme désigne un rapport de correspondance de la représentation avec le réel, l’effet de réel désigne, lui, un rapport d’insertion du réel dans la représentation, son point de contact. » (Glevarec: 222.) Le cas de 19-2 montre toutefois que l’opposition ainsi énoncée est inopérante, puisque ce qui a choqué l’opinion et suscité tant de réactions dans cette série est autant l’un que l’autre. Les théoriciens du nouveau millénaire voudraient qu’on appelle « effet de réel » précisément ce que le public persiste à nommer « réalisme », en phase avec les travaux que lui ont consacrés les études littéraires depuis quelques décennies. Il y a là un enseignement valable, celui de la polyvalence et de l’étendue transhistorique, transgénérique et transmédiatique du concept.
Qui plus est, l’analyse a fait ressortir que la controverse entourant l’épisode inaugural de la deuxième saison de 19-2, quoique formulée en des termes empruntant à un argumentaire moral disqualifié depuis plus de 150 ans par Baudelaire au sujet du réalisme de Madame Bovary de Flaubert, concerne un code davantage formel qu’éthique. Ce code prend habituellement le pas sur tout le reste, quand il s’agit de fictions à épisodes au petit écran : j’ai nommé les nécessités usuelles du « découpage saisonnier », pour reprendre la terminologie proposée par Stéphane Benassi (80).
En effet, il me paraît opportun de soulever, en guise d’apostille à ma réflexion, un élément demeuré inaperçu jusqu’ici et qui à certains pourra sembler un détail anecdotique dans cette affaire. Je me demande si l’onde de choc causée par 19-2 en janvier 2013 ne s’est pas trouvée aggravée du fait que la série s’écartait assez drastiquement des schémas sériels usités de l’univers télévisuel nord-américain. Car, normalement, c’est à la fin d’une saison, non au début, que le téléspectateur s’attend à être dérouté, voire défié par une série. Neuf fois sur dix, la prouesse technique, laquelle rompt forcément un peu avec les us observés rituellement dans les autres épisodes, intervient lors du dernier épisode de l’année. Qu’elle relève du scénario, des effets visuels, de la prise de vue, du format de l’épisode ou de tout autre domaine, la prouesse, le coup d’éclat, demeure règle générale assujettie aux impératifs commerciaux dictés par le découpage saisonnier, lesquels d’ordinaire veulent que, dans leur « souci permanent de fidélisation du téléspectateur » (Benassi: 28), les productions télévisuelles rendent l’ultime volet d’une saison « particulièrement haletant afin que les téléspectateurs soient massivement de retour en septembre pour la season premiere » (Petit: 19), c’est-à-dire l’épisode d’ouverture de la saison suivante.
Sous cet angle, le « faux-pas » de 19-2, ce serait d’avoir voulu mettre toute la gomme dès le départ et d’avoir pilé non pas en plein dessus, mais à côté. On peut bien sourciller si on veut, il n’y a pas réellement eu de dégât : seulement une pirouette très réussie, dont on se souviendra encore longtemps.
- 1. Si le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) compte 33 postes de quartier (PDQ), numérotés d’ouest en est de 1 à 49, il n’existe pas à l’heure actuelle de poste numéro 19, pas plus qu’il n’existe, par exemple, de poste 17, 18, 25 ou 2. Toutefois, on remarquera que la plus grande part de l’action de la série de Podz se déroule dans les quartiers Ville-Marie (PDQ 20 et 21), Centre-Sud (PDQ 22), Hochelaga-Maisonneuve (PDQ 23) et Plateau Mont-Royal (PDQ 38), ou dans des quartiers fictifs directement inspirés de ceux-ci. Le choix d’inventer, pour les besoins de la fiction, le poste de quartier montréalais numéro 19 se veut une invitation à le considérer comme s’insérant de manière cohérente dans la numérotation de ces PDQ réels.
- 2. Voir par exemple le tout premier épisode de la série, de 16 min 18 s à 16 min 49 s (Podz, 2011, « Épisode 1 »).
- 3. C’est tout de même une minute et demie, voire une minute trois quarts, de plus que les segments récapitulatifs qui de semaine en semaine intervenaient au début des épisodes de la première saison (le laps de temps s’étant écoulé entre épisodes n’est pas le même non plus : sept jours contre près de deux ans).
- 4. Pensons au désopilant épisode 3 de la saison 1, qui fait coïncider la pleine lune avec un premier du mois, lorsque les assistés sociaux reçoivent leur chèque mensuel (Podz, 2011, « Épisode 3 »: 43 min 37 s).
- 5. On remarquera, à cet égard, que le réalisateur, lors d’une entrevue publiée dans Le Journal de Montréal deux jours avant la diffusion de l’épisode controversé, se félicitait d’avoir proposé un traitement novateur de ce sujet : « le point de vue des policiers n’avait jamais été montré », plaidait-il (Plante: 65).
- 6. « Tout en me rendant bien compte du parti pris qui est la méthode même et qui constitue l’art poétique de l’auteur, un reproche que je fais à son livre, c’est que le bien est trop absent; pas un personnage ne le représente. […] [L]’office de l’art est-il de ne vouloir pas consoler, de ne vouloir admettre aucun élément de clémence et de douceur, sous couleur d’être plus vrai? » (Sainte-Beuve: 1443.) La célèbre réplique de Baudelaire à Sainte-Beuve, publiée quelques mois plus tard, mérite d’être citée : « Plusieurs critiques avaient dit : cette œuvre, vraiment belle par la minutie et la vivacité des descriptions, ne contient pas un seul personnage qui représente la morale, qui parle la conscience de l’auteur. Où est-il, le personnage proverbial et légendaire, chargé d’expliquer la fable et de diriger l’intelligence du lecteur? En d’autres termes, où est le réquisitoire? / Absurdité! Éternelle et incorrigible confusion des fonctions et des genres! – Une véritable œuvre d’art n’a pas besoin de réquisitoire. La logique de l’œuvre suffit à toutes les postulations de la morale, et c’est au lecteur à tirer les conclusions de la conclusion. » (Baudelaire: 81-82.)
- 7. Ce quolibet célèbre est dû à un certain J. du Pays, dans un article de L’Illustration du 18 juin 1853.
- 8. Ces formules sont tirées des phrases conclusives du réquisitoire que l’avocat impérial Ernest Pinard a dressé contre Madame Bovary lors du procès (490).
- 9. Champfleury l’affirmait lui-même : « Le mot réalisme […] est un de ces termes équivoques qui se prêtent à toutes sortes d’emplois et peuvent servir à la fois de couronne de lauriers ou de couronne de choux. » (5.)
- 10. « J’ai l’hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l’observation exacte », écrit Zola à son ami Henry Céard en 1885, dans une lettre devenue célèbre (249).
- 11. « Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout! », glosait Sainte-Beuve en clôture de son analyse de Madame Bovary, lui qui voyait en ces hommes de science des figures résumant l’attitude de la prochaine génération d’écrivains appelée à prendre le dessus du pavé en cette seconde moitié du XIXe siècle : « en bien des endroits, et sous des formes diverses, je crois reconnaître des signes littéraires nouveaux : science, esprit d’observation, maturité, force, un peu de dureté. Ce sont les caractères que semblent affecter les chefs de file des générations nouvelles. » (1444.)
- 12. Quelques voix discordantes s’élèvent tout de même au sein du corps policier parmi le concert d’éloges adressé à 19-2 : un policier demeuré anonyme juge notamment que « le scénario manque de réalisme à certains moments », entre autres dans la scène de l’auditorium, où les policiers fictifs perdent la tête et tirent « sans trop savoir où » (Desplanques).
- 13. Il s’agit plus que tout de « montrer les choses comme elles sont », affirme Podz, à l’occasion d’un entretien avec Richard Therrien (2013b). Sur ce point, voir également l’entrevue accordée à Tanya Lapointe par Claude Legault (acteur et scénariste), diffusée au Téléjournal de Radio-Canada le 3 octobre 2014; voir aussi la série de huit brefs épisodes montrant les stars de 19-2 formées par des policiers du SPVM, aux fins de les préparer au tournage de la première saison, mini-série réalisée par le sergent Ian Lafrenière et Robert St-Onge, Formation des comédiens. Au service de police de la ville de Montréal (Podz, 2011: disque 5).
- 14. Hugo Dumas le même jour sur la même page du même quotidien y allait de ce commentaire : « Il ne faut pas voir dans le premier épisode de 19-2 une opération de relations publiques pour redorer le blason de la police, qui s’est passablement terni avec le dernier printemps érable. Il s’agit plutôt d’un regard sans complaisance sur ce qui peut se passer de pire dans la vie d’un patrouilleur. Et comme l’histoire se charge de nous le rappeler, le pire arrive trop souvent. Malheureusement. » (4.) Dans Le Journal de Montréal, Marc-André Lemieux célébrait « une réalisation sobre qui montre toute l’horreur du drame (la caméra demeure collée sur les policiers) et des textes exacerbant un climat de tension ». Richard Therrien dans Le Soleil saluait quant à lui la dimension haletante d’une proposition visuelle osée et risquée, mais réussie : « Encore une fois, Podz, le réalisateur, a fait des miracles, et le résultat est saisissant de vérité. Le téléspectateur vit donc la scène […] du point de vue des policiers qui avancent dans l’inconnu, sous le tonnerre des tirs nourris du jeune tueur, au risque de finir dans une mare de sang. » (2013a.) Emmanuelle Plante du Journal de Montréal allait renchérir une semaine plus tard : « Podz et son équipe font de la haute voltige en nous rendant avec justesse et intensité une catastrophe inqualifiable qui laisse des traces. » (64.) Puis, Stéphane Baillargeon mettrait de l’avant l’idée qu’une représentation artistique procurait toujours, grâce à l’esthétisation, un certain recul salutaire : « En manipulant les rouages de sa mécanique esthétique, le réalisateur Podz met en scène le mal et il expose en même temps cette mise en scène. Il place la violence à distance, il la spectacularise, il l’édite, la filtre, la malaxe et l’abstrait. »
- 15. Ce bref article se borne essentiellement à rapporter que les autorités policières s’attendaient à ce que la diffusion de l’épisode de 19-2 occasionne une hausse du nombre d’appels téléphoniques de citoyens inquiets à propos d’une éventuelle attaque en milieu scolaire.
- 16. Nathalie Petrowski elle-même signalait que le problème, à ses yeux, se posait « tant sur le plan de la manière, du média que de l’événement en tant que tel » (2013: 4).
- 17. La filmographie du réalisateur québécois inclut Les Sept jours du Talion (2010) et 10 ½ (2010); la série télévisée Minuit, le soir (2005-2007) annonce elle aussi par certains côtés les duretés de 19-2.
- 18. Le vocable semble coller à l’épisode du 28 janvier 2013 : il resurgit à l’hiver 2015, au moment de lancer la dernière saison de la série : « La scène ultraréaliste de la tuerie qui a ouvert la deuxième saison de 19-2 a semé l’émoi, même si on ne compte plus le nombre de chaînes de nouvelles qui présentent des tueries réelles en direct. » (Desloges.)
- 19. Je ne suis pas le premier à m’interroger sur la popularité actuelle de ce vocable. Voir notamment Hervé Glevarec (2010: 216).
- 20. « Le jugement de vérité fictionnelle considère le récit comme une paraphrase et l’univers comme une exemplification […] d’une partie du monde réel du destinataire tel que ce dernier le conçoit. Et elle consiste en l’affirmation de la justesse de l’univers fictionnel dans sa représentation implicite de cette partie de la réalité. » (Esquenazi, 2009: 174.)
- 21. Il paraît malaisé de souscrire à l’analyse d’Hervé Glevarec, qui, s’inspirant des commentaires d’amateurs de téléséries du nouveau millénaire, conçoit l’« hyper-réalisme » comme un « réalisme poussé à l’extrême », c’est-à-dire « un au-delà du “réalisme” » à désigner non par le vocable traditionnel, mais par une locution, « l’effet de réel », proposée par Roland Barthes en 1968 et ayant fait date à l’apogée du structuralisme (Glevarec: 216). On comprend mal le besoin de reprendre une locution déjà vieillie, pour rebaptiser un concept à l’acception aussi vaste et reconnue que celle du réalisme, lequel d’ailleurs a été — et continue d’être — abondamment étudié par la critique spécialisée? Effectivement, la définition qu’Hervé Gelvarec propose pour son concept d’« effet de réel » spécifiquement appliqué aux réalités propres aux fictions télévisuelles correspond très précisément à l’une des définitions qu’on donnait du « réalisme » il y a 150 ans, lorsque la notion s’est mise en place : « L’effet de réel est ni plus ni moins qu’un trouble dans la représentation. Le spectateur ne dispose plus d’un code conventionnel […] pour comprendre ce qu’il a devant les yeux. » (Glevarec: 220.) Il suffit de remplacer le mot « spectateur » dans cette définition par ceux de « lecteur » ou d’« amateur de peinture entré au Pavillon du réalisme en 1855 » pour constater que la distinction posée par Hervé Glevarec entre réalisme et effet de réel n’apporte rien. Depuis longtemps la critique littéraire a montré que Barthes se trompait quand il affirmait que « le baromètre de Flaubert, la petite porte de Michelet ne disent rien d’autre que ceci : nous sommes le réel » (89); ces détails vrais du texte réaliste, bien entendu, disent beaucoup plus que cela, ne serait-ce que sur le plan de la symbolique. Sauf à garder une vision délibérément réductrice, étroite et passéiste du réalisme, opposer à celui-ci la notion d’effet de réel n’améliore pas, pour quiconque déterminé à rester de bonne foi, l’appréhension des fictions des années 2000, ni celles du XIXe siècle.
- 22. « La série fonctionne sur une situation fixe et un nombre restreint de personnages centraux immuables, autour desquels gravitent des personnages secondaires qui varient. Ces personnages secondaires doivent donner l’impression que la nouvelle histoire diffère des précédentes, alors qu’en fait, la trame narrative ne change pas. […] / Avec une série, on croit jouir de la nouveauté de l’histoire (qui est toujours la même) alors qu’en réalité, on apprécie la récurrence d’une trame narrative qui reste constante. » (Eco.)
- 23. « Si toute la télévision ludique ou informative semble possédée par une manie du geste cérémoniel […], le seul genre fictionnel capable d’entretenir la régularité téléspectatorielle est la série. Elle est même conçue afin de s’inscrire dans la ritualité réceptive : sa programmation obéit à la loi du retour du même, chaque épisode constituant une promesse faite aux téléspectateurs d’obéir exactement et sans état d’âme à une formule narrative toujours parfaitement respectée. » (Esquenazi, 2010: 24.)