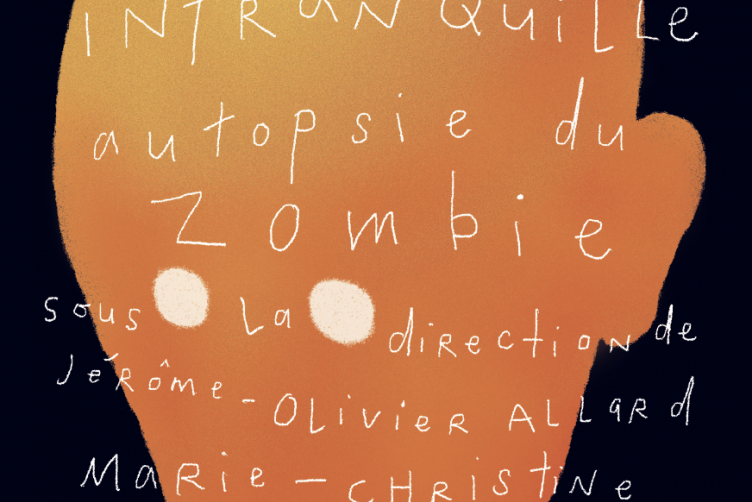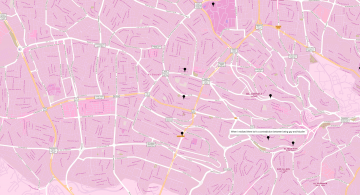Le samedi 19 octobre 2013, j’ai occupé ma matinée à déchirer mes vêtements, à les tremper de faux sang et de saleté. Mon visage, mes bras et mes jambes se sont colorés de bleu, de violet, de vert et de rouge. Tout était pensé pour simuler la pourriture du cadavre réanimé, pour suggérer les épreuves que ma carcasse aurait vécues une fois revenue à la vie, motivée par la consommation de chair humaine. C’était une journée très spéciale : j’allais participer à ma première marche de zombie au centre-ville de Montréal — la troisième édition de l’événement avait lieu cette année-là. Malgré mes efforts, mon costume faisait pâle figure en comparaison des chefs-d’œuvre d’abjection présents dans la foule. N’empêche que j’ai gémi, grogné, reniflé, boité avec les milliers d’autres « zombies » (les organisateurs de l’événement estimaient qu’environ 10 000 morts-vivants s’étaient emparés des rues de la ville). La marche a aussi ramené à ma mémoire des souvenirs de l’année précédente, 2012, l’année de la grève des carrés rouges. Le rapprochement n’était pas anodin. Quelques mois plus tôt, j’assistais au colloque « Invasion Montréal » au Cœur des sciences de l’UQAM1. C’est à ce moment que j’ai pris conscience de la portée symbolique et politique de cette envahissante figure. Le zombie évoque la masse anonyme qui menace de faire s’effondrer l’ordre social, la peur du soulèvement contre les élites. Et j’étais là, au milieu d’une foule gémissante, repoussante, titubante, sans revendication particulière, mais porteuse, malgré tout, de cet ensemble de significations.
La contamination était déjà bien entamée, elle avait touché les cercles académiques autant que les œuvres de la culture populaire. Les représentations et les réflexions sur le zombie n’ont pas tari sept ans plus tard, comme en témoigne la parution de l’ouvrage collectif La mort intranquille. Autopsie du zombie (Presses de l’Université Laval, 2019), qui fait suite au colloque pancanadien du même nom qui s’est tenu à Montréal les 10 et 11 mai 2012 (en pleine grève étudiante!). Les textes rassemblés par Jérôme-Olivier Allard, Marie-Christine Lambert-Perreault et Simon Harel étonnent par leur éclectisme apparent — à l’image de la florissante discipline des zombie studies. On y couvre toutes les manifestations médiatiques du zombie (cinéma, littérature, bande dessinée, télévision et jeu vidéo); chaque analyse mobilise un cadre théorique et adopte une approche différente d’une œuvre (ou d’un corpus) afin de démontrer la portée symbolique, historique, mythologique, politique ou philosophique de cette figure.
Pour ses directeurs et sa directrice, chaque texte du collectif témoigne du potentiel du mort-vivant en tant que « clé de lecture pour comprendre l’imaginaire contemporain » (14), et la compréhension de la figure du zombie passe nécessairement par l’observation de ses mutations et de ses interprétations au fil du temps. Pour Fabienne Claire Caland, le zombie est devenu, dans sa migration au grand écran étatsunien, une « figure entièrement creuse » (29) dans laquelle les critiques peuvent, avec raison, lire « tout et parfois n’importe quoi » (28). Dans l’imaginaire vaudou, d’où il tire son origine, le zombie est la victime d’un maître le réduisant en esclavage et le corps zombifié est un corps dépossédé, dépouillé d’agentivité et dépersonnalisé. C’est à travers la lentille du cinéaste George A. Romero, dans les années 1960, qu’il se « laïcise », pour reprendre le terme de Fabienne Claire Caland (28), et se multiplie. Les films Night of the Living Dead (1968), Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985) et plusieurs autres mettent en scène des hordes indifférenciées de morts-vivants, à la différence du zombie unique d’inspiration vaudou. Ces hordes ont désormais le pouvoir de renverser les institutions sociales (déjà fragilisées) et de mener l’humanité à sa perte.
Les premiers textes du collectif mettent en perspective la figure dans son ensemble : ils reviennent sur ses origines historiques et culturelles (le zombie caribbeanus du vaudou haïtien, étudié par Sarah Juliet Lauro en préface) ainsi que sur les moments charnières dans l’évolution de ses représentations (le cinéma de Romero, les œuvres influencées par les événements du 11 septembre 2001, sa migration dans les jeux vidéo, entre autres). La mort intranquille témoigne d’une sédimentation de sens dans ce « creux » propre au zombie : la coquille vide s’est remplie au fil de ses adaptations à de nombreux supports médiatiques qui ont, à leur tour, provoqué de nouvelles transformations. L’ouvrage collectif est en ce sens une mise au point sur l’évolution de la figure, qui porte autant de visages qu’une horde de morts-vivants.
Ces représentations se déploient au cœur des analyses selon deux thématiques principales : le temps et le contact. Les textes de Fabienne Claire Caland et d’Aurélie Chevanelle-Couture s’attardent respectivement à l’étude mythologique des récits de zombies et aux régimes d’historicités associés à la figure. On y distingue trois temps, correspondant à une évolution chronologique des représentations : le mort-vivant solitaire (héritier américanisé de la tradition vaudou); la horde, la multiplication; et la fin des temps, caractérisée par le présentisme (au sens de François Hartog) et l’imaginaire apocalyptique.
Nicholas Dion et Elaine Després se concentrent plutôt sur la représentation médiatisée du temps. Comment les enjeux temporels détaillés en début d’ouvrage se manifestent-ils dans le matériel sémiotique des œuvres? Pour Nicholas Dion, les ellipses temporelles propres aux récits épidémiques zombiesques ont tendance à évacuer la description des modes de contagion. Selon lui, ce type de représentations relève du fantasme de la fragilité des institutions sociales. Pour Elaine Després, ces mêmes subterfuges représentationnels, lorsqu’ils sont portés au cinéma, ouvrent la porte à l’épaisseur intertextuelle et symbolique du zombie (elle s’intéresse plus précisément au Resident Evil de Paul W. S. Anderson [2002]). Le contact, la rencontre avec la figure se manifeste alors à travers le travail de médiation. La littérature lovecraftienne (Marc Ross Gaudreault), les jeux vidéo zombiesques (Bernard Perron) et le cinéma de found footage (Aude Weber-Houle) visent, chacun à leur manière, la création de sensations fortes par le biais de représentations fictives. Chacune de ces instances nourrit et transforme la figure du zombie en jouant sur cette anticipation du contact.
Dans son ensemble, La mort intranquille prend exemple sur son objet d’étude puisque les « articles retenus privilégient des analyses formelles ou de corpus et abordent une pluralité d’enjeux par le truchement de la figure du zombie » (18). Au sein des œuvres, le mort-vivant est un prétexte qui permet d’exprimer une crise, une angoisse, une philosophie, etc. Et de la même manière, en tant qu’objet d’analyse, il devient prétexte pour l’étude d’autres phénomènes sociaux. Figure trou-noir, le zombie attire toutes les interprétations jusqu’à ce que nous nous approchions assez pour sentir l’impact de sa morsure, acte de contagion ultime.
Qu’en est-il des œuvres récentes qui le « ré-humanisent »? In the Flesh (Dominic Mitchell, 2013-2014), The Cured (David Freyne, 2018), Santa Clarita Diet (Victor Fresco, 2017-2019) et iZombie (David Thomas et Diane Ruggiero-Wright, 2015-2019) sont mentionnés en introduction (17), mais leur présence au sein de l’ouvrage reste superficielle. Dans ces œuvres, le zombie est le symbole des marginalisés, des mis à l’écart, autant au cœur de la fiction que dans les analyses académiques. Ils sont les protagonistes de ces récits, momentanément émancipés de leur rôle d’antagonistes. Ces zombies conscients de leur état, ni totalement vivants ni totalement morts, sont jugés par les directeurs et la directrice du collectif comme étant minoritaires et non représentatifs de la tendance générale. La plupart des cas étudiés au sein de l’ouvrage relèvent plutôt de la mise en récit de morts-vivants qui inspirent « la peur du contact, produite par l’anticipation d’un toucher, d’une morsure. Cette entité dégoûtante, impure, souillée, abjecte qu’est le zombie, il faut la rejeter et la maintenir à l’écart de soi. », pour reprendre les termes d’Aude Weber-Houde (175). Qu’arrive-t-il lorsque la contamination n’évoque plus la déshumanisation, mais plutôt une recatégorisation, une humanité autre? Et que signifie le plaisir de participer aux marches des zombies, de faire partie de la masse, de traverser le miroir et de célébrer ce passage symbolique de l’autre côté de la mort, une mort qui ne serait pas une finalité en soi? La multiplication de ces représentations alternatives tout comme le succès des marches de zombies ne sont pas anodins.
- 1. L’évènement, organisé par Samuel Archibald (UQAM), Antonio Dominguez Leiva (UQAM) et Bernard Perron (Université de Montréal), s’est déroulé du 5 au 7 juillet 2012.