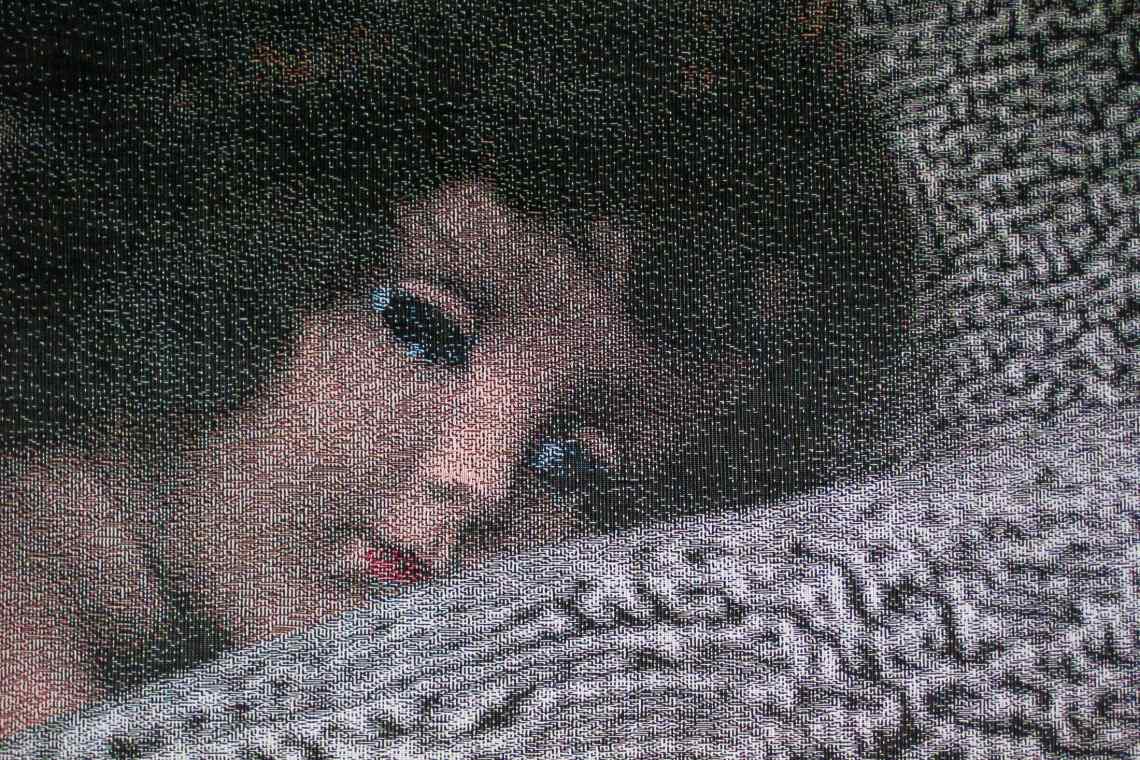En 2013, plusieurs milieux littéraires de la francophonie ont été traversés d’un grand vent d’excitation lorsque se vit confirmée la rumeur : un manuscrit inédit de l’écrivaine suisse Esther Montandon avait été retrouvé. Bien que peu connue outre-Atlantique, Montandon est, selon le site du Théâtre Trois P’tits Tours, « l’auteure romande la plus lue du XXe siècle » (AJAR, 2016). Née le 8 mai 1923 en Suisse, elle a grandi au Rwanda; de retour au pays natal à l’âge adulte, elle publie son premier roman, Le piano dans le noir, pour lequel elle obtient le prix Schiller en 1953. Malgré une carrière qui lui vaut une importante reconnaissance, elle tombera tranquillement dans l’oubli au cours des années qui précédent sa mort, en 1998.
Mais Esther Montandon, l’auteure romande la plus lue du XXe siècle suisse, demeure un mystère. Elle a publié peu, quatre livres seulement de son vivant, et son cas n’a cessé d’intriguer : après la mort de sa fille Louise en 1960, l’écrivaine aurait brûlé tous ses manuscrits, avant de disparaître complètement du paysage littéraire pendant de nombreuses années. La publication inattendue, en 1980, de courts récits librement inspirés de son enfance africaine et son refus catégorique de revenir sur les longues années de silence qui ont suivi la mort de sa fille ont donné naissance à bien des rumeurs. On peut dire que l’histoire d’Esther a tout pour inciter le mythe à devenir vivant.
Je fais partie des quelques personnes qui ont eu la chance d’entrer en contact avec l’œuvre de Montandon au cours de leur jeunesse. En effet, en 1996, je me suis inscrite à un séminaire d’été donné par le regretté Jean-Bertrand Lahaie, spécialiste de littérature suisse et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. C’est grâce à lui que j’ai pu plonger dans les textes de cette écrivaine à la plume fine et rigoureuse, discrète mais puissante. Agota Kristof, qui était la voisine de Montandon et son amie de longue date, confie dans son autobiographie que leur proximité venait sans doute de ce qu’elles partageaient une même attirance pour « la vérité du texte qui entrave la parole ».
Comme l’ensemble des gens qui se passionnent pour la littérature suisse romande, j’ai attendu avec impatience le moment où je mettrais la main sur le roman posthume de mon auteure préférée. C’est Vincent König, dépositaire du fonds Esther-Montandon, avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger quelques lettres lors de mes études de premier cycle, qui s’est chargé de mettre en forme les fragments retrouvés dans une pochette identifiée « factures », égarée quelque part dans un des cartons que lui avait confiés l’auteure. Ainsi a vu le jour Vivre près des tilleuls, publié aux éditions D’autre Part : une collection de fragments intimistes racontant la perte d’un enfant et la douleur du deuil, et puis la joie, discrète, qui revient doucement.
Le canular annoncé
Tout ce que j’ai dit sur Esther Montandon est vrai; mais on ne peut pas en dire autant de Vincent König. Ce dernier n’a jamais retrouvé d’inédit égaré dans les factures d’Esther Montandon. Plutôt, c’est un de ses amis qui lui a remis un texte surprenant, écrit par un collectif, l’Association des jeunes auteurs et auteures romandes, l’AJAR. « Comment ne pas se faire avoir? dira-t-il en entrevue. Je savais que c’était un faux, et à chaque instant, j’entendais Esther. J’entendais sa voix, j’entendais sa vision. »
Après avoir admis s’être fait prendre, König a décidé de jouer le jeu et d’attraper d’autres crédules; après tout, il est commun de voir les victimes se transformer en bourreaux pour effacer la douleur psychologique suivant l’abus de confiance. Je n’y ai pas échappé et j’ai réellement cru reconnaître, moi aussi, la voix de cette vieille amie. Mais une étudiante en lettres, dotée d’une capacité de lecture plus fine que la mienne, a remarqué un détail improbable dans le récit autobiographique de Vivre près des tilleuls : un fragment mettant en scène Esther conductrice d’une voiture, alors qu’elle n’a jamais passé le permis. C’était le fil qui dépassait, et en tirant dessus, la jeune femme a su détricoter l’affaire. Un court documentaire mettant au jour le canular a été produit avec la collaboration des complices, et le texte fut republié en 2014 chez Flammarion. Ses véritables auteurs et auteures sont maintenant identifiés sur la couverture. Stupéfiée, j’ai à mon tour ressenti la cruelle morsure de la honte; j’avais l’impression que c’était la littérature entière qui riait de ma naïveté.
Si l’histoire a fait couler beaucoup d’encre au pays des montres bien réglées et du fromage troué, c’est bien sûr en raison de la réussite du coup monté, mais pas seulement. La richesse du texte, l’unité de la voix et l’incroyable respect de l’esthétique montandienne en sont tout autant de raisons. Il va sans dire que le fait que l’œuvre résulte du travail d’un collectif a largement contribué au succès médiatique de l’affaire.
C’est donc en tant qu’objet littéraire complexe que ce roman m’intéresse dans le cadre de ce dossier sur la littérature non fiable. Esther Montandon devenue narratrice de sa vie fictionnalisée a été construite par l’AJAR comme un personnage qui porte efficacement l’opacité fondatrice du genre romanesque. Il est évident que le canular révélé place de facto le texte sous les auspices de la suspicion; mais le doute siège tout autant dans le projet éditorial qui sabote son authenticité que dans l’architecture magnifiquement fignolée de ce petit livre.
D’abord, en ce qui concerne le péritexte, remarquons qu’Esther Montandon est absente de la première de couverture (2014). D’une sobriété maximale, celle-ci annonce, l’un sous l’autre, les éléments suivants : l’AJAR, Vivre près des tilleuls, roman, Flammarion. Auteur, titre, genre, maison d’édition. C’est tout. Ensuite, la quatrième de couverture met en récit la découverte du manuscrit par König. L’intégration de cette découverte dans le résumé indique que cet événement ne se limite pas au canular extérieur à l’œuvre : il s’intègre au texte, il fait partie de l’univers narratif du roman. De Montandon elle-même, on ne dit rien du tout. Puis en page intérieure, les mêmes quatre éléments de la couverture sont repris : auteur, titre, genre, maison d’édition; cependant, le titre est devenu Vivre près des tilleuls par Esther Montandon. Voilà donc l’auteure supposée, la fausse auteure, qui fait son apparition, dans le titre.
Enfin, l’avant-propos, qui était présent dans la première édition, celle du canular où Esther Montandon figurait comme auteure dès la page de couverture, raconte la découverte du manuscrit par Vincent König. Mais avec la nouvelle édition, le lecteur, la lectrice sait, à moins de faire partie de cette race bienheureuse qui plonge dans les textes comme on traverse un lac l’été sans se soucier des avertissements météorologiques, le lecteur ou la lectrice sait que nous sommes en plein mensonge, et comprend les rouages de ce mensonge. En effet, comme l’écrit l’essayiste Valérie Raoul au sujet de ce subterfuge, « [l]’ironie d’une tentative de légitimation placée en tête d’un texte, qui vient, en première page, de se déclarer comme fiction, s’accentue jusqu’à friser la parodie. Au lieu de contribuer à la vraisemblance, ce procédé ne fait que souligner son artificialité […]. » (1999: 47.)
La table est mise pour que le lecteur, la lectrice sache exactement à quoi s’en tenir : on a entre les mains un livre qui « fait comme si », un roman qui fait comme s’il n’en était pas un : « Cela n’est pas un roman, pas même un ouvrage achevé, mais un recueil d’impressions, de faits, de pensées et de souvenirs. » (König dans AJAR, 2014: 9.) Ce sont des « écrits intimes », ajoute König (2014: 9). Mais je constate que ce dernier écarte par omission la possibilité qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, d’un projet de roman; il lui semble impossible que Montandon ait voulu fictionnaliser cet événement fort et tragique, la mort de sa fille.
Jouer sur la limite, ou se jouer des limites
La non-fiabilité de Vincent König ayant été établie, voyons ce que l’on peut attendre du texte lui-même, de ces fragments qui n’ont pas été écrits par Esther Montandon. Peut-on la croire lorsqu’elle raconte son deuil? Esther avoue bien un oubli de-ci de-là, elle confesse un mensonge inoffensif qu’elle fait à son mari. Mais tout dans l’écriture est admirablement ficelé; les quelques traces d’incertitude ne font que renforcer l’impression d’authenticité du récit, puisqu’on est en droit de s’attendre à au moins un peu d’inconstance ou de confusion de la part d’une mère vivant la pire des souffrances. Dans l’écriture pourtant, Esther analyse ses propres réactions et garde la tête froide. Ainsi, lorsqu’elle hallucine la tache de sang à l’endroit où est morte sa fille, elle notera :
Bien sûr que cela n’existait pas. Je ne pouvais pas poser mes yeux sur la tache, elle disparaissait — comme les étoiles (c’est en Afrique que j’en avais fait pour la première fois l’expérience : les astres qui n’existent qu’en vision périphérique, qui palpitent au coin de votre œil mais qui s’éteignent sitôt qu’on essaie de les fixer). Le sang de ma fille en étoile sur le trottoir palpitait dans le printemps, les tulipes sans doute en nourrissaient leur bulbe. Le sang de ma fille s’est éteint lorsque, de guerre lasse, je l’ai regardée droit dans les yeux. (AJAR, 2014: 72.)
Esther affronte la vérité des choses, quitte à les voir disparaître. D’ailleurs, l’écriture n’est-elle pas l’habitat naturel de ces choses qui ne peuvent exister « qu’à notre insu », pour reprendre l’expression de Suzanne Jacob, qui refusent de se laisser ignorer, mais ne nous appartiennent plus dès lors que nous nous en saisissons pour faire de l’histoire (2002: 24)?
Ces questions que l’on pose quand on devient des lecteurs professionnels, des lectrices professionnelles, nous mènent presque toujours à cette version simplifiée que j’ose en proposer : à qui appartient le texte? Qui en possède les clés? Vivre près des tilleuls joue bien entendu sur ce type de liminarité. La frontière identitaire se présente timidement au deuxième fragment, lorsque Esther enceinte demande : « Faut-il écrire l’enfant? Quoi d’autre? Mon enfant semble encore trop irréel, notre enfant trop officiel. » (AJAR, 2014: 13.) La parentalité s’ébauche dans l’indéterminé, dans l’incertitude de l’appartenance — comme, je me permets de le dire, dans l’incertitude du statut de l’auteure. Difficile de ne pas entendre les membres de l’AJAR fredonner : « Le livre? Mon livre? Notre livre? » Le parallèle est peut-être facile, mais je persiste tout de même : la naissance de l’enfant est marquée par une paradoxale solitude, où se crée pourtant une vie à deux qui pulvérise dès la première seconde la frontière entre créateur et créature :
Je sais avoir vu Jacques sourire, pleurer, je voulais l’inclure dans notre tableau balbutiant, mais je ne parvenais pas à le visualiser vraiment. […] Je créais notre nouvelle vie dans l’instant, dans la seconde, dans le souffle rapide de ce petit être, et je ne voulais l’aide de personne. (AJAR, 2014: 18.)
Les fragments 8 et 9 du roman confirment cette fusion, ou plutôt ce transfert d’être qui circule entre mère et enfant : Esther peint par touches précises et minimalistes le tableau de Louise qu’elle voit reproduire ses propres gestes avec la poupée Alice. « La mère et la fille sur le sofa du salon », annonce d’emblée le fragment 9, sans que l’on sache qui est la mère, qui est la fille (AJAR, 2014: 25). Ou alors, lorsque Louise raconte à sa poupée les souvenirs d’Esther : « Elle réinventait l’Afrique, la brousse, les lions affamés, les récits du Rwanda de mon enfance » (25); autrement dit, Louise écrit le prochain livre d’Esther, que König, dans son avant-propos, décrit comme « la gerbe de ses souvenirs d’enfance, magnifiquement nouée dans les fragments des Imperdables, [qui] offre dans un style épuré un aperçu poétique et documentaire du Rwanda et de la Suisse des années 1930 » (2014: 8). Ou encore, par un renversement complet des rôles, Louise met la table pour le thé « avec une minutie qui me faisait penser à maman » (2014: 25).
Même lorsque la mort est évoquée, il y a fusion. Esther se souvient très nettement, insiste-t-elle dans le fragment 34, avoir pensé, au moment de visiter l’appartement situé en hauteur, « qu’il ne fallait pas habiter ici par temps de grande détresse » (AJAR, 2014: 66). Le fait qu’elle insiste sur le souvenir attache ce moment au temps narratif, et donc le met en lien avec le deuil de Louise, qui tombera de la fenêtre des années après que sa mère a eu cette pensée. Mais la pensée elle-même et le moment où elle est survenue dénotent l’existence d’une pensée suicidaire avant le drame. La narratrice parle ici de mort conjointe, la sienne et celle de son enfant; en même temps, elle établit une chronologie inverse de celle qui place la détresse comme conséquence au drame. « Je ne reproche rien [à Jacques]. Qui aura fermé la fenêtre et qui l’aura laissée ouverte? Le résultat est le même. » (66) Pourtant le résultat n’est pas le même; Louise est morte, et Esther vit; le drame n’a pas mené à la détresse. Tout en parlant de mort, Montandon annonce ainsi sa survie.
Le deuil, parce qu’il est annoncé par le péritexte (König: 9) et par le contexte de production inventé, est partout dans l’esprit du lecteur, de la lectrice. Dès le premier fragment, on cherche la mort de l’enfant, qu’on suppose à l’origine à la fois du récit et du silence de l’auteure. On cherche à fabriquer de la suite, de l’avant et de l’après, du pourquoi. On cherche, avec notre instinct naturel de lecteur ou de lectrice, à construire de l’histoire, à se laisser guider pour oublier qu’en fait, on comble activement les trous. Les fragments pourraient tous être placés ailleurs, disposés autrement, ils pourraient tous avoir été écrits au moment même, ou rétrospectivement. La question demeure, cruelle : ce fragment, Esther l’a-t-elle écrit avant, ou fait-elle l’effort du souvenir, de l’écrit? Dans plusieurs cas, il est impossible de le dire. On en revient toujours à la fabrique d’histoires qui maintient la vie en vie. Au dernier fragment, Esther se dit assaillie d’images : celle d’un homme, debout devant une fenêtre, qui tient en main un livre, peut-être celui de sa fille écrivaine, qui vit à Neuchâtel (comme Agota Kristof) :
Cela pourrait donner quelque chose, un bref texte, à l’intrigue ténue mais dont l’intensité irait croissant. Il s’agirait moins de scènes que de tableaux. La lumière serait primordiale. Il faudrait savoir rester douce. Peut-être est-il temps de me remettre au roman. Cela n’engage à rien d’en caresser l’idée. (119.)
Peut-être, nous dit Esther avec une fausse innocence, est-il temps de commencer l’écriture du livre dont vous venez de terminer la lecture, un roman qui n’en est pas un, un roman à l’intrigue ténue mais dont l’intensité croît toujours vers plus d’écriture, un roman tout en fenêtres, lumière, tableaux furtifs et précis, imprégnés de l’odeur douce et âcre des tilleuls en fleurs.
Du « elle » au « je » : les marques de la fiction
Je désire finalement revenir à l’avant-propos : pourquoi le conserver tel quel dans cette édition, sinon pour contrôler le mensonge, pour orienter la lecture? König admet être intervenu sur le texte : « Les feuillets n’étant pas numérotés, ni datés, ils ont été distribués pour la présente édition dans un ordre étudié pour faciliter la lecture. » (9.) Or, le marquage du temps est un élément fondamental de la convention qui régit le journal intime. Ce que König indique ici, c’est que le texte se destinait inévitablement à un retravail, et donc, qu’il comporte bel et bien un aspect fictionnel, même au sein de la fiction qu’est le canular par lequel les jeunes auteurs et auteures ont ébranlé en 2016 le milieu littéraire suisse romand.
En fait, l’avant-propos est un ouvrage très fin qui tient à nous faire voir de quel fil blanc il est cousu. Le livre, tel qu’il est publié, oblige le lecteur, la lectrice à s’avouer responsable de sa naïveté, de son désir d’y croire, de se faire berner; impossible de prétendre ne pas savoir que le « je » d’Esther Montandon est, en réalité, un « elle » sans corps. Martine Maisani-Léonard explique que « [l]a fonction [d’un] préambule est de souligner le caractère clos [d’un] récit, et en même temps d’annoncer qu’il va se présenter comme un discours (passage du il au je) » (1976: 42, cité par Raoul, 1999: 48). Selon elle, la prise de conscience de ce passage oblige à une lecture à deux niveaux. Dans Vivre près des tilleuls, les niveaux se multiplient : avant d’être un « je », Montandon est la « elle » de König, qui lui est le « il » de tous les membres de l’AJAR, qui sont des « ils » et des « elles » les uns pour les autres. La fausse pureté du « je » éclate et révèle son artificialité. La magie littéraire opère : on assiste à la transfiguration d’un événement que König trouve « définitivement tragique et éternellement heureux » — résolument intime, ajouterai-je —, en « un souvenir [qui] s’inscrit désormais pleinement dans la littérature » (10), la littérature étant l’univers des êtres de papier qui permettent qu’on endosse un peu leur identité, comme on le ferait d’un costume. Le lecteur ou la lectrice est convié à suspendre son jugement, à lire en mettant de côté sa subjectivité face au statut de la vérité et du réel, pour que naisse cette voix qui n’appartient qu’au texte, et surtout pas à son auteur; il faut, pour entrer dans ce texte, consentir au mensonge vrai qu’est la littérature, et c’est ce que König nous oblige à faire en nous mentant sérieusement.
La malhonnêteté au cœur de la vérité littéraire
Mais un personnage inventé peut-il mentir?
Vincent König n’est pas réellement un menteur; Vincent König n’existe pas, il a été inventé par les membres de l’AJAR, qui ont trouvé un acteur pour donner dans leur faux documentaire une voix menteuse au mensonge de l’existence d’Esther Montandon. Car non seulement Esther Mondanton n’a pas écrit ce texte, mais en plus, elle n’a jamais vécu. Ni Louise, ni le Rwanda, ni les romans, ni le prix Schiller, ni le canular suisse, ni rien du tout. Esther Montandon est tout autant fictive que le sont ses textes. Je plaide coupable : je suis moi aussi une narratrice non fiable et je conçois qu’on ne puisse plus me faire confiance dans cette affaire. Je laisserai donc entre les mains d’une journaliste de La Presse la difficile tâche d’expliquer, grâce à une entrevue avec Noémi Schaub, membre de l’AJAR, la véritable histoire d’Esther Montandon :
Il y a deux ans, le festival Québec en toutes lettres avait comme thème Doubles et pseudos et rendait justement hommage à Romain Gary. « On s’est dit : “On est obligés d’y aller.” Ce thème-là, c’est pour nous. » Ainsi est né le personnage d’Esther Montandon, une fausse auteure suisse romande au cœur d’une exposition qui a été présentée pendant le festival, et à laquelle [les membres de l’AJAR] ont donné une date de naissance, de mort et une histoire. « On a cherché ce qui constitue une auteure et on a créé sa bio, des synopsis de ses livres, cherché des objets d’enfance, sa machine à écrire. On a aussi garanti sa présence sur internet avec une page Wikipédia. » Le résultat, dit Noémi Schaub, était totalement crédible. « Les gens ont vraiment marché. » (Lapointe, 2017.)
« On est toujours piégé dans un je », écrivait Romain Gary (1974: 128), auteur du canular le plus spectaculaire de l’histoire littéraire. Dans l’essai Pour Sganarelle, le romancier propose, pour se libérer de ce piège du « je », la création du picaro, un être fictif qui incarnerait à la fois l’auteur, le personnage et l’esprit romanesque; ainsi, la force de persuasion du roman proviendrait de « l’absence de démenti » (1965: 345) du réel, et du fait qu’il ébranle la validité de la stabilité identitaire. C’est dire que le roman joue nécessairement sur le mensonge, car le doute doit subsister pour tester la confiance du lecteur, de la lectrice. Tout projet littéraire comporte donc une part de malhonnêteté; Gary aura poussé l’expérience jusqu’à truffer sa biographie de mythes et d’imprécisions, avant de franchir une limite avec l’invention d’Émile Ajar. Mais même ce picaro littéraire devenu un être bien réel n’aura pas empêché Gary de tomber après s’être trop approché de l’idéal de la multiplicité identitaire; peut-être était-ce une vérité trop lourde à porter pour l’homme seul dont la fin tragique me rappelle celle d’Icare, ce héros de la mythologie grecque au nom étrangement proche de celui du modèle de Gary.
Quant à Esther Montandon, magnifique picara qui échappe jusqu’au bout à la prison du « je », rappelons enfin qu’elle n’est pas tombée de la fenêtre. Elle résiste à la chute et choisit de survivre. Même si elle est issue d’une entreprise quelque peu malhonnête, son existence demeure criante de vérité. À la lecture, on accorde volontiers notre consentement, on accepte de ne rien démentir face à cette romancière-personnage entièrement portée par le texte pour lequel elle est née, sous les nombreuses plumes incroyablement bien accordées de l’AJAR.