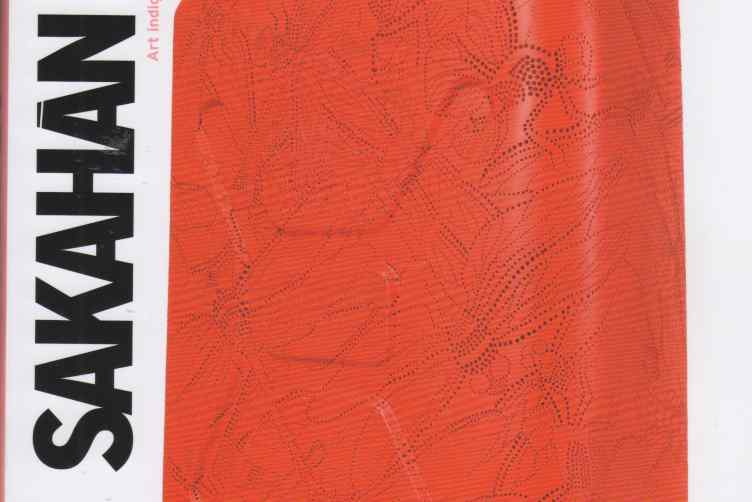C’est un fait désormais établi, les artistes autochtones sont de plus en plus visibles sur la scène des arts visuels contemporains et actuels en Amérique du Nord. Bien que l’on puisse attribuer ce phénomène au nombre croissant d’artistes autochtones professionnels actifs aux quatre coins du continent, il semble que l’engouement tienne encore davantage à lʼintérêt significativement accru des diffuseurs pour leur travail. La place et la reconnaissance que ces artistes réclament depuis des décennies commencent enfin à leur être accordées. Toutefois, face à cette visibilité accrue, certains débats sont inlassablement soulevés, et semblent même créer d’importants malaises dans le milieu des arts contemporains. Plusieurs se demandent : est-ce encore pertinent de maintenir une distinction particulière pour les arts autochtones? Ne serait-ce pas ainsi continuer d’opérer une forme de marginalisation, de ségrégation même, envers ces artistes? Et d’abord, qu’est-ce qui distingue encore les artistes autochtones des autres, dans une Amérique du Nord où le métissage, l’hybridation, les emprunts, les croisements en tous genres et le multiculturalisme sont si communs qu’il est presque suspect de réclamer une identité spécifique? Puisque ces questions sont effectivement complexes, notre article n’entend pas offrir des réponses définitives. Il souhaite plutôt suggérer des pistes de réflexion pour éclairer le débat, et ce, à la lumière de ce que des artistes et des théoriciens autochtones avancent eux-mêmes à ce sujet. Nous proposons ainsi, dans un premier temps, de discuter du fait qu’il existerait bel et bien, encore aujourd’hui, des arts proprement dits « autochtones » — une catégorie identifiable, aux contours traçables — puis d’interroger, dans un second temps, le fait que, pour diverses raisons, certains artistes s’insèrent volontairement dans cette catégorie par l’utilisation d’une stratégie claire : l’auto-identification. Des cas particuliers, comme ceux des artistes Rita Letendre, Raymond Dupuis, ou encore Jimmy Durham, seront soulevés pour éclairer le point de vue.
Identifier les arts autochtones
Déjà dans les années 90, l’historienne de l’art Kanien’kehá:ka (mohawk) Lee-Anne Martin soutenait que, « [a]u cours des vingt dernières années, les artistes autochtones ont mis en place une histoire activiste fondée sur des stratégies dʼautodétermination définies et lancées collectivement par les artistes eux-mêmes » (Martin citée par Trépanier, 2011: 36). Il apparaît en effet qu’à la suite du Pavillon des Indiens d’Expo 67, une nouvelle génération d’artistes autochtones est née au Canada, prête à prendre en main le futur de leurs communautés1. Ces artistes — Robert Houle, Domingo Cisneros, Carl Beam, Edward Poitras, Diane Robertson, Jane Ash Poitras ou Pierre Sioui — sont allés dans les écoles d’art « blanches », ont appris à combiner habilement les langages de l’art contemporain occidental avec des éléments de leurs cultures traditionnelles, et sont devenus les véritables porte-étendards des luttes et des revendications de leurs peuples. Bien que les arts autochtones existaient déjà depuis des millénaires 2, ils ont connu une véritable résurgence dans les années 70-80, un nouvel élan marqué par un désir de s’adresser cette fois aux non-autochtones en utilisant de nouveaux langages. Encore aujourd’hui, les artistes autochtones les plus en vue du pays — Nadia Myre, Rebecca Belmore, Sonny Assu, Kent Monkman — se considèrent les héritiers de cette génération pionnière qui a posé les bases d’un art profondément politique, une affirmation claire de souveraineté et d’autodétermination. Ainsi, il existerait une histoire de l’art proprement autochtone, différente des arts occidentaux. Les détails de cette histoire n’ont pas encore été écrits, mais ses grands jalons sont identifiables. Il s’agirait d’une histoire composée de parcours artistiques, d’œuvres, de manifestations publiques et d’expositions volontairement distinctes qui ont poursuivi et poursuivent encore bien souvent des objectifs précis et avoués. « Native artists assure that their culture is both integrated into that of the world at large and proudly separate from it », déclarait en 2016 Valerie K. Verzuh, la commissaire de l’exposition Into the Future. Culture Power in Native American Art, à Santa Fe (Verzuh citée par Baca, 2016).
Dans cette optique, des artistes inuit, métis et issus des Premières Nations, au Québec comme au Canada, emploient l’esthétique et les mediums pour affirmer leur présence ou leur survivance, exprimer leurs visions du monde, ou encore raconter leurs histoires.
Bien que ces artistes représentent une multitude d’identités culturelles, d’héritages spirituels et de territoires ancestraux, ils partagent néanmoins une histoire commune : une histoire d’annexion culturelle, de transgression spirituelle et d’appropriation territoriale. C’est à la fois un lien commun basé sur une souffrance collective faite d’humiliation et d’aliénation et aussi une particularité qui les arme de la volonté de continuer à se battre pour la reconnaissance du droit inhérent à l’autodétermination. (Houle, 1992: 69.)
C’est un art qui qui incarne, donc, la validité et la vigueur des cultures autochtones ainsi que leur place légitime dans le monde actuel. L’art contemporain offre aux Premiers Peuples la possibilité de nommer et d’affirmer leur culture, en plus de faire voler en éclats les images figées et romanesques longtemps créées et employées par le colonisateur. Ou comme l’écrit la commissaire tlingit Candice Hopkins :
[C]es artistes […] cherchent à prendre le contrepied des métarécits et, dans certains cas, à les renverser. Dénonçant les effets durables de l’impérialisme, ces œuvres émanent d’un besoin fermement ancré de résister à ce qu’on pourrait appeler l’amnésie historique, un oubli actif au fondement des discours nationaux de divers pays […]. (Hopkins: 22.)
Les arts contemporains autochtones offrent ainsi une variété de propositions artistiques originales, éclatées, parfois franchement innovantes, voire même à l’avant-garde, qui impliquent qu’on les aborde, pour mieux les saisir, en tenant compte à la fois du ou des contextes culturels dont elles sont issues et des préoccupations esthétiques qu’elles peuvent proposer. Contrairement aux arts allochtones, qui produisent bien souvent des œuvres indépendantes de tout contexte, et défendant une forme d’autonomie artistique, les créations autochtones nécessiteraient généralement qu’on fasse « le tour de l’arbre », pour reprendre l’expression de France Trépanier et Chris Creighton-Kelly (75). C’est dire qu’il faut prendre en compte différentes dimensions, comme celles, par exemple, de l’histoire personnelle de l’artiste, des savoirs et visions du monde autochtones ou encore de l’histoire coloniale et des contacts avec les Allochtones. Par exemple, pour bien saisir toute la richesse de la série Meditations on Red de Nadia Myre (2013), que l’on peut voir en partie au Musée de la civilisation de Québec et qui confronte justement des questions identitaires, il ne suffit pas de s’attarder aux éléments esthétiques; il importe de prendre en considération, entre autres, l’histoire que raconte l’artiste sur son passage aux douanes américaines et de méditer les questions sur son identité autochtone auxquelles elle a dû faire face, sans manquer de repenser à la pratique du perlage chez les femmes autochtones, en vigueur depuis des millénaires. En plus du patient travail manuel et méditatif choisi par l’artiste, l’idée d’hybridation présente derrière l’utilisation de perles de plastique ou de la photographie problématisent entre autres l’idée d’authenticité longtemps évoquée comme principe colonial pour départager les « vrais indiens » des « faux ». Ignorer ou négliger ces aspects dans l’analyse de la série rend impossible l’appréhension de sa complexité.
Ainsi, les arts autochtones pourraient être identifiés, compris, en fonction non seulement de leur histoire propre, distincte, mais aussi des visées politiques et esthétiques spécifiques des artistes autochtones. Sans servir de définition à une catégorie particulière, ces éléments permettraient de comprendre, cerner, pointer ce que seraient les arts autochtones, ce qui les différencierait des arts non-autochtones. Toutefois, ils ne sont qu’un début. Ils n’englobent pas tout, et risqueraient, si utilisés de façon draconienne, d’être contraignants et exclure certaines pratiques. Pour Ian McClean, auteur du livre Double Desire. Transculturation and Indigenous Contemporary Art (2014), la catégorie de l’art autochtone ne serait pas définie nécessairement, ou pas uniquement, par le contenu des œuvres, mais plutôt par la posture des artistes qui en font partie (McClean: 5-6). Pour lui, les arts contemporains autochtones proviendraient d’artistes dont la pratique est en partie façonnée par une culture et une communauté d’appartenance, tout en s’écartant des conventions traditionnelles de cette même communauté au profit d’une créativité personnelle et radicale propre à la notion d’artiste individuel et indépendant (5-6).
L’auto-identification comme critère premier et comme stratégie concrète
Il pourrait donc être essentiel de considérer la posture de l’artiste comme critère premier — si la notion de critère s’applique vraiment — pour identifier à la fois ce que sont véritablement les arts contemporains autochtones et qui sont les artistes les pratiquant. Bien que les éléments évoqués précédemment permettent de comprendre quelques caractéristiques propres aux arts autochtones, l’auto-identification des artistes pourrait être en fait le seul et unique critère définitoire, très inclusif, de l’art autochtone. C’est du moins ce qu’a fait valoir l’artiste Kanien’kehá:ka (mohawk) Skawennati Fragnito en 2002 dans l’essai Five Suggestions for Better Living : pour elle, les arts des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne sont pas autochtones parce qu’ils présentent des thématiques autochtones, mais bien parce que les artistes s’affirment comme tels. Ainsi, elle considère l’auto-identification comme un critère décisif, voire unique, pour départager les arts autochtones et allochtones (Fragnito: 230-231). En s’auto-identifiant explicitement d’abord comme artistes, mais aussi comme Autochtones, les artistes autochtones feraient ainsi la démonstration de l’existence encore pertinente et distincte d’une telle identité, d’une catégorie encore voulue et nécessaire. Car s’ils renonçaient à cette spécificité, ils auraient possiblement le sentiment d’assumer une certaine forme d’assimilation, d’avoir été « dilués » par le néocolonialisme dans un Canada dont « la souveraineté étatique, affirmée à partir du droit colonial, [n’est] aucunement remise en question » (Poirier, 2009: 332). Le maintien d’une telle identité pourrait alors apparaître comme un outil politique pour lutter contre le néocolonialisme actuel. Toutefois, ces artistes semblent s’entendre généralement aussi sur le fait que le terme « autochtone » constitue une nécessité seulement dans le cadre de cette condition néocoloniale; il s’agirait d’une forme d’« essentialisme stratégique », expression développée par la théoricienne de la littérature Gayatri C. Spivak (2006: 205) puis employée, entre autres, par l’artiste et théoricien métis David Garneau3, qui permettrait aux Autochtones d’affirmer une identité en opposition aux Euro-Canadiens, dans un contexte post-contact et post-réserve. L’autochtonie serait donc une identité politique et temporaire, mais une identité stratégique essentielle, conçue par une volonté collective et par une nécessité de résistance et de solidarité.
Il semble en outre que, par l’auto-identification, les artistes autochtones parviennent à contourner les critères coloniaux réducteurs qui, jusqu’à maintenant, déterminaient qui est « indien » et qui ne l’est pas, comme la Loi sur les Indiens au Canada. Englobante et inclusive, elle manifeste en effet la présence de plusieurs formes d’autochtonie au Canada et ailleurs dans le monde, d’identités plurielles, hétérogènes, métissées. Ainsi, ne serait pas Autochtone seulement celle ou celui qui parle couramment une langue traditionnelle, vit dans une réserve ou peut faire la preuve d’une filiation directe et indiscutable avec d’« authentiques » ancêtres autochtones. Un artiste autochtone peut aussi être urbain, parler seulement le français ou l’anglais, et se considérer partie prenante de différents types de communautés. « L’identité collective, pour ces artistes, peut inclure leur propre communauté [ou] une communauté autochtone nord-américaine plus large, mais peut aussi s’étendre de manière à englober la communauté mondiale, à l’intérieur de laquelle l’individu autochtone est aussi un participant4 », souligne la commissaire Karen Duffek (1989: 28). Puisqu’il existe une multiplicité de façons d’être autochtone aujourd’hui, et de manière à remettre cette question entre les mains des individus et des communautés, l’Organisation des Nations unies a statué en septembre 2007 dans le cadre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones que le critère premier pour être considéré autochtone doit être l’auto-identification ([s. a.], 2007). C’est pourquoi le Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa), en créant sa grande exposition d’art contemporain autochtone Sakahàn en 2013, affirmait à la fois la pertinence du maintien d’une telle catégorie d’art et l’emploi du critère de l’auto-identification comme élément premier pour déterminer quels artistes seraient exposés, tout en spécifiant que la notion d’autochtonie doit être un concept relationnel et inclusif : « Pour que le mot ‘‘autochtone’’ ait une fonction significative, il est essentiel qu’il renvoie aux notions de particularisme culturel, de dualité et d’hybridité, et qu’il offre la possibilité d’une auto-identification volontaire à une affiliation culturelle quelconque », écrivait Christine Lalonde en introduction du catalogue d’exposition (15).
Quelques cas
L’analyse de la posture adoptée par certains artistes en particulier éclaire la question de l’auto-identification. Rita Letendre, par exemple, connue au Québec depuis des décennies comme artiste majeure ayant fait partie du mouvement automatiste, et dont le travail d’abstraction a été exposé aux quatre coins de l’Amérique du Nord et de l’Europe, n’a jamais été associée aux arts autochtones. C’est un fait récent que ses origines waban-aki (abénaquises), du côté de sa mère, soient mises de l’avant. Bien que la Galerie Simon Blais, qui la représente, soutient qu’elle n’a jamais cherché à cacher son identité autochtone, cela ne semble en aucun cas avoir défini sa carrière artistique. Le conservateur Kanien’kehá:ka (mohawk) Steven Loft la décrit d’ailleurs comme étant « fully absorbed into mainstream Canadian art history, and she is seldom seen in relation to aboriginal art » (Loft cité par Tousley, 2011). On la retrouve tout de même exposant aux côtés d’autres artistes autochtones — une première, semble-t-il — lors de la biennale d’art contemporain autochtone Baliser le territoire, organisée par Art Mûr en 2012. La question n’est pas de savoir si elle y avait sa place ou non, mais plutôt de considérer qu’outre cette brève incursion dans le milieu des arts autochtones, le positionnement de l’artiste ne l’a jamais rapprochée de cette catégorie. Si toutefois Rita Letendre souhaite désormais mettre de l’avant cet aspect de son histoire personnelle et de son identité, pourquoi pas! De son côté, l’artiste Raymond Dupuis a renoué avec ses origines wolastoqiyik (malécites) à la fin des années 90 et dès ce moment a commencé à exposer aux côtés d’artistes autochtones et de s’affirmer comme tel, ce qui a semblé influencer directement sa démarche. Quoique sa longue carrière ait débuté dans les années 60, il est possible de considérer qu’il devient un artiste autochtone au tournant du nouveau millénaire, justement parce que l’auto-identification devient partie prenante de son identité personnelle et artistique. Ces deux exemples montrent à quel point l’auto-identification est un critère fondamental. Non seulement elle délimite certains contours de la catégorie de l’art contemporain autochtone sans recourir à des barèmes occidentaux, laissant tout pouvoir aux individus de s’y intégrer pour des raisons qui leurs sont propres, mais elle permet également d’éviter que des artistes possédant des origines autochtones et ne souhaitant pas nécessairement entrer dans la catégorie des arts autochtones n’y soient intégrés « de force ».
Toutefois, il n’est pas toujours si évident de tracer une ligne. Même le critère de l’auto-identification, aussi inclusif et flexible soit-il, soulève des questions, et parfois certaines controverses. Le cas de l’artiste cherokee Jimmie Durham est emblématique. En 1991, il déclarait haut et fort : « I am not an ‘Indian artist,’ in any sense. I am Cherokee but my work is simply contemporary art. My work does not speak for, about, or even to Indian people » (Durham cité par Cembalest, 1991). Cela veut-il dire que l’art de Durham doit être exclu de toutes expositions collectives d’art autochtone, ou ne jamais être associé à une quelconque forme d’art autochtone? Peut-être pas. Il importe de souligner que cette assertion survenait dans un contexte de débat sur la question de l’authenticité où beaucoup défendaient encore ce que Jackson Beardy avait déclaré en 1977 (Gray, 1993: 146), à l’effet qu’un « vrai » artiste autochtone était issu d’une communauté précise et personnellement responsable de la culture de celle-ci5. La compréhension des arts autochtones et la posture des artistes ont changé depuis le début des années 90. L’identité cherokee de Durham a par ailleurs été remise en question et suscité la controverse de nombreuses fois au cours de sa longue et prolifique carrière artistique. L’été dernier encore, avec l’ouverture de l’exposition rétrospective Jimmie Durham. At the Center of the World (2017), créée par le Hammer Museum de Los Angeles, des artistes, commissaires, avocats et leaders de conseils de bandes cherokee ont signé une lettre ouverte affirmant que Durham n’avait jamais été reconnu par l’une des trois communautés officielles des États-Unis, qu’il s’appropriait ainsi une identité qui n’était pas sienne, et causait grands torts aux peuples autochtones : « These false claims are harmful as they misrepresent Native people, undermine tribal sovereignty, and trivialize the important work by legitimate Native artists and cultural leaders. » (Watts, 2017) Les arguments avancés par les co-signataires de la lettre allèguent que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, en plus de mettre de l’avant l’élément de l’auto-identification, préconise aussi une reconnaissance de la part d’une communauté autochtone, de manière à tempérer le débat et éviter les glissements et autres risques d’usurpation. Face à ces critiques adressées à l’artiste mais aussi à la commissaire de l’exposition, Anne Ellegood, accusée de cautionner une telle « appropriation », une longue lettre a été publiée sur Artnet News. Signée par la commissaire, cette lettre insistait sur le fait que, même si Durham évoque parfois ses racines cherokee, il a surtout fait valoir une appartenance beaucoup plus large, loin des critères d’adhésion ou de rejet d’une nation précise : « His objection to the system of enrollment is rooted in a political conviction that Indigenous rights are better served by an international and pan-American approach, rather than a national one. » (Ellegood, 2017.) La commissaire soulevait en outre des lacunes dans les techniques employées par les trois communautés pour déterminer qui est Cherokee et qui ne l’est pas, et insistait sur les éléments pertinents qui autorisent Durham à croire qu’il possède des racines cherokee.
Cette controverse met en évidence ce que la Sioux Hilary Weaver évoquait déjà quelques années plus tôt dans son article « Indigenous Identity. What Is It, and Who Really Has It? » (2001), à savoir qu’un tel débat est contreproductif. Une vision trop étroite de la question de l’identité autochtone semble souvent mener à une forme de ségrégation ou de « colonialisme interne », comme le nomme Weaver (2001: 247), sous prétexte de préservation d’une certaine pureté de la race. Voilà pourquoi Weaver écrivait : « Searching for the “right” criteria is both counterproductive and damaging. » (247.) Ici encore, donc, l’auto-identification, étant englobante et inclusive, paraît promouvoir efficacement la décolonisation, rallier toutes les nations, les faire travailler pour la même cause et marcher dans la même direction.
L’auto-identification remet le pouvoir de choisir — une ou des identités, un discours, des façons d’être compris et de se nommer — entre les mains des individus. On peut alors s’inventer, loin des étiquettes et des stéréotypes. Ainsi, il existerait une catégorie d’art autochtone, parce que des artistes s’y associent volontairement par le biais de la stratégie de l’auto-identification. Ou, en d’autres termes, puisqu’il y a de nombreux artistes qui continuent de mettre de l’avant leur identité autochtone comme élément incontournable de leur démarche artistique, il reste pertinent de les comprendre et de les exposer comme tels. Cette catégorie d’art autochtone serait donc identifiable, sans toutefois posséder de définition spécifique. Elle demeurerait nécessaire pour aborder et comprendre les œuvres et les postures des artistes, et aussi pour assurer à ces derniers une meilleure intégration au sein de l’art contemporain, où ils restent encore largement sous-représentés. Une telle catégorie devrait toutefois ouvrir sans cesse à de nouvelles avenues, posséder des « frontières poreuses et mouvantes », pour citer ici le sociologue huron-wendat Guy Sioui Durand (7), s’adapter, permettre une multiplicité de pratiques et de discours. Elle restera sans doute pertinente et nécessaire tant que des artistes autochtones jugeront utile de s’y insérer volontairement et ouvertement, et estimeront qu’elle sert des intérêts communs spécifiques. Le jour où elle deviendra obsolète est peut-être proche, mais il appartient aux artistes eux-mêmes, aux commissaires, conservateurs et théoriciens autochtones d’en décider. D’ici là, le véritable enjeu n’est sans doute pas de savoir s’il faut ou non accoler une étiquette spécifique aux arts autochtones, mais plutôt d’exposer les arts autochtones de manière à respecter la posture et les discours des artistes, tout en établissant un véritable dialogue, riche et producteur de sens, entre arts autochtones et allochtones.
- 1. À Montréal, en 1967, le Canada célébrait le centenaire de sa confédération et accueillait l’Exposition universelle. Dans un tel contexte, les Premiers Peuples voulaient obtenir un espace pour donner leur vision du monde et leur version de l’histoire canadienne. Des leaders autochtones, notamment unis dans les années 60 sous la Fraternité nationale des Indiens et le Conseil des Autochtones canadiens, réclament donc un pavillon indépendant et parviennent à l’obtenir. Ce Pavillon des Indiens a surpris par sa contemporanéité, par le contenu acerbe qu’il est parvenu à présenter, ainsi que par les œuvres, créées par des artistes autochtones parmi les meilleurs du pays et exposées principalement sur les façades extérieures, qui possédaient des formes tantôt figuratives, tantôt abstraites et tantôt géométriques, alliant imageries traditionnelles, matériaux contemporains et style parfois très actuel. En tant que projet formateur qui a réuni les acteurs politiques, artistiques et activistes du milieu autochtone, le Pavillon des Indiens a sans contredit donné aux communautés autochtones plus de confiance et un sens des possibilités. (De Lacroix, 2017: 35-40.)
- 2. Plusieurs historiens de l’art et anthropologues le soulignent. Nous n’en citons ici que quelques-uns, par souci de concision : Janet Catherine Berlo et Ruth B. Phillips. Amérique du Nord, arts premiers. (Paris: Albin Michel, 2006); Olive Patricia Dickason. Indian Arts in Canada. (Ottawa: Information Canada, Department of Indian and Northern Affairs (DIAND), 1972); Viviane Gray, « Indian artist’s statements through time », dans In the shadow of the sun: perspectives on contemporary native art, sous la dir. de Gerald McMaster. (Hull: Musée canadien des civilisations, 1993).
- 3. Celui-ci emploie l’expression « necessary essentialism » (Garneau, 2011).
- 4. [Nous traduisons.]
- 5. Beardy avait affirmé : « I think there are two types of artists. The first are totally involved with their native culture and are personally responsible for that culture. They are merely tools of their tribes, responsible for producing work of the highest possible calibre. The second group are not responsible to their tribes. They sell their Indianness first. If you’re an Indian and an artist, you’re not necessarily an Indian artist. I belong to the first category. I can’t paint anything if I don’t have the background and the cultural knowledge to make it right. It wouldn’t be fair to my people and it wouldn’t be fair to the rest of Canada. » (Beardy cité par Gray: 148).