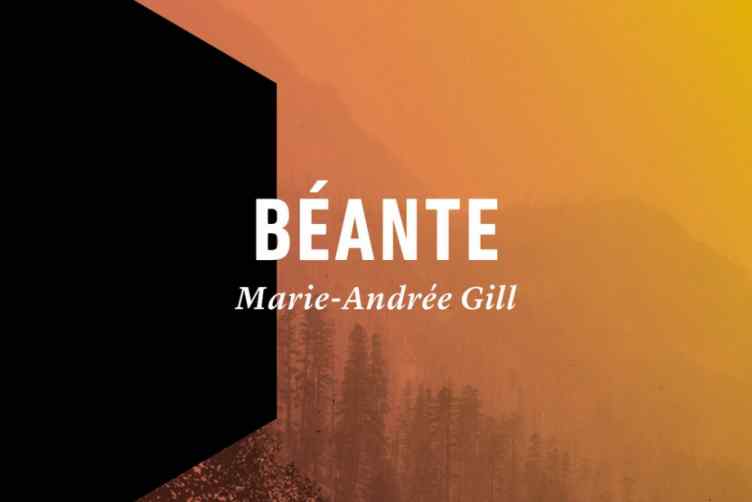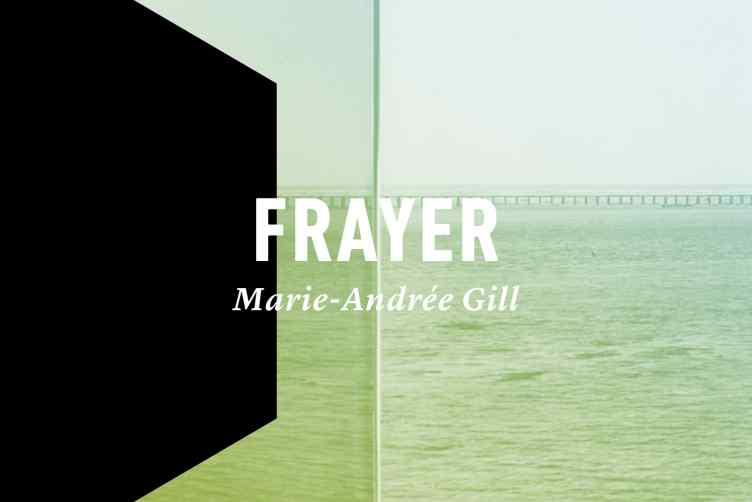Dans Être écrivain amérindien au Québec. Indianité et création littéraire (2006), Maurizio Gatti décrit de manière éloquente les enjeux auxquels sont confrontés les auteurs autochtones dès lors qu’ils entreprennent d’investir, à partir des années 70, la scène littéraire québécoise. Comment peut-on se réapproprier une parole déformée, détournée puis confisquée par le colonisateur? Comment exprimer sa différence dans la langue et les médiums culturels de l’Autre? Est-il possible, ou souhaitable, de parler d’autre chose que de son « autochtonie » cependant qu’elle est menacée encore de toute part? À ce dilemme shakespearien (être ou ne pas être engagé?), notre article voudrait proposer une solution possible par l’analyse rhétorique d’une posture singulière, annonçant une voie alternative.
Marie-Andrée Gill est une poète autochtone née à Mashteuiatsh au milieu des années 80. Son œuvre met en résonance les imaginaires québécois et ilnus, dépassant, voire sublimant, les stéréotypes de la crise identitaire : « Je suis ilnue, je suis québécoise, je suis une femme, une mère et je suis plein d’autres choses » (Gill, 2015 [2012]: 8), peut-on lire au seuil du recueil Béante, paru aux éditions La Peuplade. Dès le premier poème, elle demande : « combien de fêtes à épuiser / ouvrir la terre et y planter nos ombres » (21). Or la poète ne renie pas l’ombre de son être, de l’être des siens, mais puise sa lumière dans cet acte d’inlassable plantation. Ouvrir la terre, ce geste inaugure toute une série d’ouvertures, corporelles, amoureuses, poétiques, qui se risquent à chercher l’avenir au creux des cicatrices, pariant sur la vie, ses forces d’amour et de rire. Elle dira ainsi dans Frayer, publié par La Peuplade : « nous n’existons que pour rire de nous-mêmes et nous chercher la nuit » (Gill, 2015: 46). Il y a dans son écriture une harmonie, de même qu’un lâcher prise qui n’a rien à voir avec la résignation, mais qui procède plutôt d’une ouverture visant à expliciter la part de lumière qui existe au-delà de la dualité, à travers une démarche parfaitement assumée. Il s’agira de montrer, au prisme des lieux de l’invention, de quoi se compose cette lumière et comment la plénitude peut se jouer de toute béance.
D’abord, quelques précisions méthodologiques s’imposent. L’approche rhétorique sur laquelle se fonde notre analyse consiste à envisager toute forme discursive en fonction de sa situation d’énonciation; par la prise en compte du destinataire, des contraintes avec lesquelles le destinateur doit composer (que peut-il dire et ne pas dire?), de l’image de soi qu’il projette (son ethos), ces arguments pathémiques (pathos) qu’il déploie pour émouvoir son interlocuteur et, enfin, de la composante logique (logos), c’est-à-dire la dimension proprement argumentative du discours, qui procède d’un enchaînement stratégique d’arguments (Aristote, 1998: 22). Si, comme le remarque Joëlle Gardes Tamine (2007), « il peut sembler paradoxal de vouloir appliquer la rhétorique à la poésie, alors qu’elle semble se confondre avec l’argumentation et, que par ailleurs, la poésie revendique sa liberté à l’égard des contraintes », la rhétorique peut néanmoins s’avérer « un outil fécond d’analyse des textes poétiques », dans la mesure où elle permet d’expliciter des enjeux esthétiques aussi bien qu’idéologiques1, sans qu’il soit nécessaire « d’élaborer un nouveau langage critique » (Gatti, 2010: 12-13). L’analyse pourra porter sur le style (élocution), l’ordonnancement du discours (disposition) ou privilégier le plan des idées (invention), comme nous le ferons d’ailleurs ici, de manière à dégager les enjeux du discours, plutôt que l’intentionalité (trop incertaine) du locuteur — surtout lorsqu’il s’agit de poésie, forme polysémique par excellence. Une telle méthodologie exige de rester proche du texte, car c’est de lui qu’elle tire ses preuves et non de sources externes ou de projections herméneutiques.
Béante
Si un lecteur pressé s’avisait d’entreprendre Béante sans avoir lu la quatrième de couverture ou la préface de Jonathan Lamy, il ne manquerait pas d’être confronté à la question identitaire dès le premier mot qui ouvre le recueil : « Shashish » (Gill, 2015 [2012]: 17), dont le sens n’est pas donné avant la toute dernière page. Qu’il soit en mesure de reconnaître ou non la consonance autochtone du terme, il pourra présumer que les mots qui suivent en constituent la traduction : « Éclaboussures, carcasses, canicules » (17), mais il aura tôt fait de constater qu’il n’y pas d’équivalence synonymique entre ces évocations. En revanche, si notre lecteur est issu de la nation ilnue ou qu’il en connaît la langue, il reconnaîtra le mot « avant », lequel précède les termes français, comme pour lui donner préséance et affirmer l’allégeance première du locuteur (ou pour rappeler qu’avant le Français, il y avait l’Autochtone). Stratégie payante de double destination du propos, dans la mesure où elle flatte l’orgueil de l’un par la connivence, cependant qu’elle intrigue l’autre par l’exotisme.
Partant de ce premier titre, reçu comme un hommage ou une concession à sa culture, on imagine la suite à l’avenant, c’est-à-dire comme l’affirmation forte d’un sentiment d’appartenance, en dépit du recours à la langue de l’Autre, un acte de résistance face à l’acculturation… Pourtant les pages suivantes déploient une suite de poèmes aux accents lyriques universels, évoquant « les matins d’enfance au ventre déballé » (Gill, 2015 [2012]: 28) et « […] les paupières maudites du monde » (29), développant une adresse amoureuse, d’un « je » à un « tu » anonymes, prise dans une dialectique de l’ombre et de la lumière, entre « lune » et « marées noires » (33), de « nos ombres » (21) à « nos lumières » (38). La poète joue d’une double temporalité à la fois cosmique, entre « fil du temps » (21) et « éternité » (29), et prosaïque « c’est ton nom dans mes tripes / ou bien c’est juste un samedi / comme ça » (33) désamorçant avec malice la démesure lyrique. Le ton est donné : Marie-Andrée Gill n’entend pas être confinée dans une seule case et trompe les attentes qu’elle a elle-même suscitées, non seulement en déjouant toutes attentes identitaires par l’universalité du lyrisme, mais en déjouant ce lyrisme lui-même par un retour au calendrier terrestre des travaux et des jours, et à la trivialité de ses composantes: « le mascara le couteau et les bottes » (Gill, 2015 [2012]: 32). Et toutefois, au sein de ces apparentes contradictions, l’acte d’écriture est affirmé : « j’ai trouvé à t’écrire une fois pour toutes / même si rien n’est plus et que tout est là » (22). Dans cette partie inaugurale sont posées les bases d’un lyrisme fragile et sensible, cosmique et concret, dont les subtilités le préservent de tout figement.
Mais voilà que la poète enchaîne avec « Ilnu » et nous surprend encore avec une partie abordant de front les stéréotypes sur l’identité autochtone, à travers un argumentaire qui détonne en regard du lyrisme de la section précédente et qui participe du discours idéologique, de la parole engagée :
A. ce qu’il nous reste sous perfusion
dans la mémoire des hommes :
1. le chant des tambours
2. les temps superposés
3. les rivières électriques (Gill, 2015 [2012]: 46)
Culture sous perfusion, et donc vulnérable parce que malade ou moribonde, réduite à quelques traits caractéristiques, comme la rythmique du tambour (liée dans la culture au monde du rêve), une conception non linéaire du temps2 et le pouvoir convoité des rivières. Trois aspects sur lesquels plane la menace d’un occident culturellement eurocentré. Cependant, ce point « A » est suivi d’un point « B » :
B. ce que nous sommes
dans la concrétude des jours :
1. l’esprit sublimé
2. les livres d’histoire
3. vivants, là, pou-poum. (Gill, 2015 [2012]: 46.)
La poète joue à nouveau avec la catégorie du trivial, opérant une véritable « descente » dans la concrétude, allant de l’esprit aux livres, jusqu’au simple son de la présence « pou-poum ». S’il y a, bien sûr, dans cette onomatopée un écho du son des tambours autochtones, sa simplicité de battement cardiaque et vital transcende toute catégorie culturelle. Le concret permet ici une plongée dans l’évidence ontologique, désarçonnant un instant l’emprise des discours, de tout discours.
Après cette table rase quasi phénoménologique, la parole identitaire revient plus forte à la page suivante : « Nous sommes exotisme / Nous sommes millénaire » (Gill, 2015 [2012]: 47). Il y a ce que les autres retiennent de « nous », et puis il y ce que « nous sommes » au quotidien, échappant à tout effort de réduction ou tentative d’appropriation. Cette part intangible, insaisissable, inviolable de l’esprit sublimé, et la fierté d’être là, le cœur battant, toujours vivants, différents et moins nombreux, certes, mais enracinés ici depuis tellement longtemps que, même si « les territoires se décomposent » (48) et que « les temps changent disent-ils » (50), l’espoir subsiste de guérir la fêlure de l’être : « tu verras / nous ne mourrons plus dépolarisés » (50). Parce qu’arrive un jour « la fin de la nuit », et qu’il suffit d’« un seul regard pour lumière » (54). Ailleurs, dans la partie intitulée « Nanahteuau » (mirage), Marie-Andrée Gill ajoutera « nous sommes ce qui nous précède nous sommes / toujours là nous sommes » (64) et, même si l’on a mis « nos origines en boite avec le jouet dedans », allusion aux friandises américaines Cracker Jack et à la réification des cultures, elle constate que « même noyés nous pouvons respirer » (72).
Ce qui frappe le plus dans cette posture énonciative forte, c’est l’absence de ce mélange de haine et de honte caractéristique du discours victimaire, auquel la poésie de Marie-Andrée Gill n’est assimilable en rien. Si le pathos culpabilisant domine dans l’écriture militante d’une écrivaine comme An Antane Kapesh (1976), il n’y a pas de place pour le ressentiment et l’amertume ici, même si un sentiment d’incomplétude, de confusion, voire d’accablement trouve à s’exprimer parfois :
n’empêche
que je sois
une plasticine manquée
qu’on écrase d’une main sans démêler les couleurs
je te le dis […]
je renaîtrai trois quatre fois (Gill, 2015 [2012]: 85)
On aura beau la rouler en boule, l’aplatir, la remodeler, elle renaîtra trois ou quatre fois encore, sans jamais céder au désespoir. Ce motif de la réincarnation avait été évoqué plus tôt, mais concernait l’autre : « j’ai senti / Un courant d’air / Entre ta huitième / Et ta neuvième vie » (Gill, 2015 [2012]: 56). Sans présumer d’une profession de foi en la métempsychose, on constate cependant l’espérance de survivre à l’expérience du remodelage et aux mélanges des couleurs.
Il n’est pas question néanmoins d’oublier qui elle est et d’où elle vient : « je suis tous mes ancêtres en aléatoire » (Gill, 2015 [2012]: 93), et pourtant, même cette affirmation ne rejette pas la culture de l’Autre, évoquant le mode « lecture aléatoire » des baladeurs numériques. Cette identité composite est le fait du hasard et échappe à tout contrôle, parce qu’on ne saurait changer le passé. Ce sur quoi on peut agir, c’est sur l’histoire à venir, qu’il faut accueillir avec ouverture :
je vais
une épine
dans la bouche
faute de fleur exacte
pour dire le présage
je vais
béante (Gill, 2015 [2012]: 97)
Elle ne sait rien de ce qui l’attend, faute de moyens pour prédire le futur, mais elle se dit confiante : « au bout des déconstructions / Se tient planant / L’espace de tout ce que tu veux d’autre » (98). Cette confiance se trouve étayée par les citations de deux de ses fils, Aleksi et Hayden, en début de chaque chapitre. Marie-Andrée Gill ne cite pas le passé, mais l’avenir.
Lyrisme, concrétude, identité, le recueil entier se construit selon cette triade subtile qui refuse de s’enfermer dans l’une ou l’autre des avenues rhétoriques classiques qui lui seraient offertes. Privilégiant le dialogue entre première personne (du singulier et du pluriel) et un « tu » indéfini sinon par l’affection dont il est l’objet, selon la catégorie de l’adresse bienveillante, Marie-Andrée Gill devine un avenir humain au sens à la fois particulier de « Ilnu », signifiant « être humain », et général, désignant l’humanité universelle. Serait-ce forcer l’interprétation que de voir dans cette relation du « je-nous » au « tu » la possibilité d’une troisième voie, le « on », qui dans la langue française, langue coloniale, de par son caractère indéfini, peut autant signifier soi que l’autre tout en ne cessant, étymologiquement, de signifier « l’homme », autrement dit l’être humain, l’Ilnu?
Frayer
S’il est difficile pour une auteure autochtone de faire l’impasse sur son identité culturelle avec une première publication, a fortiori dans la langue de l’autre, la seconde peut être l’occasion de confirmer sa posture de « défense et illustration » ou, au contraire, d’aborder d’autres thématiques pour échapper à la ghettoïsation littéraire. Mais dans le contexte d’une littérature dont l’essor commence à peine, il est pratiquement impossible de se désolidariser des enjeux d’affirmation culturelle même si, dans l’idéal, ceux-ci n’auraient pas besoin d’être thématisés qu’elle se concrétise. Une telle littérature existe du moment que des Autochtones entreprennent d’écrire, et indépendamment des sujets ou des genres privilégiés. Cependant « exister » ne suffit pas pour Marie-Andrée Gill. Il lui faut se Frayer un chemin, « à même la cicatrice » (Gill, 2015: 9), pour remonter vers la lumière.
Si Béante s’amusait à tromper les attentes, cette fois le recueil ne tarde pas à évoquer le péril existentiel qui pèse sur la culture de l’auteur. Et l’on ne saurait se méprendre sur le sens des premiers mots formulés :
Nous autres les probables
les lendemains
les restes de cœur-muscle
et de terre noire
Nous autres en un mot :
territoire
On a appris à contourner les regards à devenir
beaux comme des cimetières d’avions
à sourire en carte de bingo gagnante
Frayer
à même la cicatrice
frayer (Gill, 2015: 7-9)
Ce « nous autres », c’est la posture identitaire assumée sans hostilité ni complaisance, même si les blessures infligées demeurent sensibles et que l’on pourrait à bon droit se plaindre de son agresseur, même si le regard de l’autre stigmatise encore et qu’il faut au surplus sourire pour les touristes, on se borne à constater cet état de fait sans blâmer personne, sans tomber dans le pathétisme outrancier. Toutefois, l’auteure ne manque pas de rappeler que « nous autres » trouve une équivalence dans le mot « Territoire », réaffirmant le registre éminemment politique de la rhétorique de l’affirmation autochtone. Simon Harel a raison de commenter la montée des littératures autochtones en ces termes : « Cette complication est donc forcément politique, et elle entraîne avec elle la question cruciale du territoire. Elle ravive la plaie, quand nous, les Québécois, avions bien cru en avoir fini avec le territoire. Le sol. La glèbe. L’appartenance. » (Harel, 2017: 22.) Dans l’imaginaire allochtone, le québécisme « nous autres » désigne en priorité des descendants de colons européens dont le territoire fantasmé serait un Québec indépendant. En reprenant l’expression du point de vue autochtone, Marie-Andrée Gill détourne la langue et l’imaginaire politique des colonisateurs au profit d’une pensée autochtone de l’histoire et du territoire. Cette reprise n’est ni une option ni un choix et encore moins une demande de reconnaissance, c’est un état de fait historique et politique, lequel il n’est plus possible d’ignorer.
La structure de Frayer s’articule autour d’une métaphore particulièrement féconde, d’emblée connotée par le titre. Car qui dit frayer, dit poisson, et l’on ne s’étonne guère de voir intervenir la ouananiche très tôt dans le recueil, assimilée de manière explicite à la figure de l’Autochtone :
Au lac, le poisson qu’on cherche c’est
la ouananiche. En ilnu ça signifie :
« Celui qui se trouve partout » ou
« Le petit égaré » (Gill, 2015: 11)
(nous sommes partout égarés) (Gill, 2015: 14)
La métaphore est ensuite reprise dans le chapitre « La réserve », pour développer l’analogie du peuple nomade et le motif du retour aux sources : « Au début de l’été, la ouananiche remonte / vers sa rivière natale, un affluent du lac où elle vit, / grand aux eaux froides et claires, à fond de roches. » (Gill, 2015: 21.) C’est l’occasion pour Gill d’évoquer son enfance à Mashteuiatsh, dans ce « village qui n’a pas eu le choix » (23), parce que la loi sur les Indiens a confiné de force ces peuples nomades à habiter dans des réserves. Suivra la partie « L’Adolescence », où l’on apprend ceci : « Presque toujours, la ouananiche / survit à la fraie. » (39.) Le salmonidé intervient encore dans « Piekuakami : le lac », où il symbolise le choix de quitter la réserve.
Les ouananiches adultes ont le choix :
retourner vers le lac ou hiverner
dans de grandes fosses de la rivière
pour redescendre au printemps. (Gill, 2015: 59.)
Le recueil se termine sur une dernière évocation :
La ouananiche demeure en lac, alors
que le saumon Atlantique migre en
mer pour une partie de son cycle
vital. Excepté cette différence, la
ouananiche et le saumon atlantique
sont la même espèce. (Gill, 2015: 77.)
Il est difficile d’y voir autre chose qu’une justification du départ de la réserve, souvent vécu comme une trahison par les communautés autochtones. Cependant, l’argumentaire déployé dans l’ensemble du recueil tend à démontrer que ce choix ne change en rien la nature du poisson.
Mais alors que s’affirme fièrement, à travers cette métaphore filée tout du long, l’identité autochtone de l’instance énonciative, d’autres figures expriment la fêlure de l’être face à : « la langue que je ne parle pas » (Gill, 2015: 24), puis le soulagement temporaire de « ce moment où personne ne me dit / à quoi je devrais ressembler » (27). Quelques expressions typiquement québécoises viennent émailler le texte : « les vraies affaires », « fourrer », « la vingt-quatre », « au gratteux », « seven-up dégazé ». L’éthos se dédouble une première fois et doit composer avec des enjeux identitaires multiples. Si devenir mère et avoir « le col ouvert à dix centimètres […] c’est arrêter de faire semblant » (70), c’est parce que la douleur ramène à la réalité et que, le reste du temps, on doit vivre avec le sentiment d’imposture : « (je ne fais qu’essayer de ressembler / à cette vieille eau dont je suis l’enfant) » (74). Or, il faut apprendre à se servir de cette douleur, de cet écartèlement de l’être, de tout ce qui peut faire obstacle à son épanouissement pour surmonter l’aliénation : « Au milieu de la trajectoire / du bleu-gris des yeux du lac presque calé / il y a notre rêve : une femme debout » (75). L’Autochtone, la Québécoise, la mère, la femme, quatre identités opprimées ou marginalisées chacune à leur manière et néanmoins réconciliées en une même personne qui n’aspire, au fond, qu’à se tenir debout.
Que la poète se montre fière de son appartenance à la nation Ilnue ne l’empêche pas de critiquer sans ménagement l’apathie des siens :
nous nous baignons dans le mal de vivre de
l’asphalte chaud
en attendant de trouver la parole habitable
ou de gagner quelque chose au gratteux
pour partir dans le bois pour toujours (Gill, 2015: 62)
Elle en a également contre « maisons toutes pareilles [où] les femmes brodent / ton futur sur des mocassins qu’elles vendent / aux touristes » (28), contre la dépendance à l’aide financière, « l’allocation du vingt » (25), contre la consommation de drogue, « une poffe à dix à essayer de se désamorcer la mort avec un boiler » (46), contre l’aspect kitsch et stéréotypé des lieux :
des bancs
des cèdres taillés
et là, géants
quatre tipis de béton
dessus, des gravures
un castor
des raquettes
un canot, un ours
gris ciment
gris évolution
l’histoire travée dans la fadeur (Gill, 2015: 15)
Comment « sortir de ces quinze kilomètres carrés », comment ne pas « chercher sans relâche / quoi faire de sa peau » (Gill, 2015: 32-33)? Heureusement qu’il y a le lac — « une chance, le lac » (25) — pour agrémenter le paysage : « Et la lumière est là » (28), elle aussi, heureusement.
On pourrait avoir le sentiment, en lisant ce qui précède, que l’autochtonie est l’enjeu dominant du recueil, voire le motif exclusif. En vérité, il est question de bien d’autres choses, et notamment d’amour, de sexualité, de jeux vidéo, de ce havre de paix que représente le bord du lac, de ce refuge incarné par le rempart :
la première plage
la baie des Boivin, le cran
le site communautaire
les escaliers du rempart
au bout des pics de roches
l’île aux Couleuvres (Gill, 2015: 26)
Certes, « toutes les plus belles plages sont payantes » (26), et on peut trouver à s’en désoler. Néanmoins, l’appartenance première semble associée au territoire de l’enfance et de l’adolescence, plutôt qu’à la nation, et ne se limite pas aux seules frontières de la réserve, mais également à celles, intérieures, des aspirations et des désirs. Frayer développe en effet quelque chose d’indéniablement adolescent chez Marie-Andrée Gill, se jouant souvent dans le rapport des « concrétudes » (Gill, 2015 [2012]: 46), pour reprendre le terme de la poète, dessinant l’expérience unique d’une subjectivité3. Par l’évocation d’une agression sexuelle, avec tout ce que cela comporte de révoltant et d’insoutenable, Gill dessine aussi l’expérience particulière d’un amour aveugle et naïf : « moi aussi j’ai hâte que tu sortes de ta famille d’accueil / même si l’autre fois je disais non et tu as pris mon cul / je t’aime pareil faut juste plus en parler pis ça va aller / love u 4-ever c’est écrit dans mon agenda c’est écrit sur / les bancs de ciment les arbres » (Gill, 2015 [2012]: 43.) C’est précisément la progression vers une contingence — contingente en regard de la gravité de l’événement —, anecdotique, celle des promesses d’amoureux, que se dessine inversement toute la profondeur de la voix unique d’une jeune fille. Le dessin de ces subjectivités ne se fait pas sans une certaine prise de recul humoristique débarrassant les êtres et les faits du masque d’un sérieux qui deviendrait autrement trop lourd à porter. Ainsi voit-on intervenir des images au décalage incongrus : « Je suis / dans le niveau sous l’eau d’un jeu vidéo au moment où / la petite musique de quand t’as pu d’air commence » (Gill, 2015: 31). Et on en vient à comprendre le principe à travers l’adéquation fournie par l’auteur elle-même « cette impression d’avoir trop ri : notre pouvoir » (34). Rire de tout, rire de rien, rire à s’en donner mal au ventre pour sublimer la crise existentielle, c’est un souverain remède et, pour une fois, quelque chose d’inaliénable.
L’ouverture comme dépassement
Dans la poésie de Marie-Andrée Gill, la lumière gît dans la béance et les soleils s’enfouissent dans les trous noirs (Gill, 2015 [2012]: 24). Trous, béances, cicatrices, déchirures, l’ouverture dans Béante et Frayer est à comprendre tant selon les réalités de la chair (« le col ouvert à dix centimètres » (2015: 70), que selon une conception plus métaphorique, jamais bien éloignée toutefois du paradigme corporel : « repasser l’extrait jusqu’à m’entrouvrir » (2015 [2012]: 34); « je te déchire encore / les mains brûlantes d’engelures » (2015 [2012]: 65); « quoi faire de sa peau : la tendre » (2015: 30). Or, ces démantèlements, s’ils remettent en cause l’intégrité ontologique de l’être, sont profondément féconds. Frayer, pour la ouananiche, c’est avoir trouvé le creux idéal dans le sable des alluvions et l’approfondir de ses flancs avant d’y déposer ses œufs; pour la poète, il s’agit non pas de forcer le trait, mais de forcer la plaie — « Frayer / à même la cicatrice / frayer » (Gill, 2015: 9) — pour y déposer l’avenir, aussi incertain soit-il : « […] faute de fleur exacte / pour dire le présage / je vais / béante » (2015 [2012]: 97).
Risque physique et ontologique, possibilité de devenir, l’ouverture comme béance est, chez Marie-Andrée Gill, érotique et amoureuse. Érotique au sens de Georges Bataille, en ce qu’elle recherche et assure les possibilités de l’existence au sein même de son manque : « De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort » (Bataille, 1987: 17). Amoureuse, car l’ouverture dans cette poésie se construit sentimentalement et sensuellement d’un « je » à un « tu » : « regarde en haut regarde bien / comme je t’aime à ciel ouvert » (Gill, 2015 [2012]: 39). Ou encore :
je te laisse
grand ouvert
sous la lampe
nos jambes s’entremêlent et ta tête s’émiette
soudain
en dix mille fourmis volantes […] (Gill, 2015 [2012]: 70)
Inversement, sans cette lumière amoureuse et sexuelle, « le p’tit cœur se referme comme un pissenlit à la noirceur » (Gill, 2015: 44), et la béance se résorbe en elle-même.
C’est précisément ce caractère érotique et amoureux de l’ouverture béante qui permet à la poésie de Marie-Andrée Gill de dépasser le dilemme de la création poétique autochtone, confrontée à une langue et une culture allochtones historiquement colonisatrices. Sexuelle et sentimentale, cette ouverture est à plusieurs reprises associée à l’adolescence : « je sais je suis encore / une petite adolescence » (2015 [2012]: 52). « L’Adolescence » est d’ailleurs le titre d’une des parties de Frayer, particulièrement érotique et amoureuse. Or, cette sexualité adolescente, chez Marie-Andrée Gill, relève à la fois d’une culture occidentale qui, aux flirts, aux premiers frenchs et premières fois, associe le règne d’une matérialité ludique et consumériste et d’une autre, autochtone, ancrée dans ses traditions :
Une chance le soir il y a l’aréna et se manger
les amygdales derrière le poste de police
il y a faire danser les aurores boréales au nintendo
les barils de poulet l’allocation du vingt
les joyeux festins de la fête à personne
il y a les fins de semaine dans le bois
et les perdrix à tordre
Et le lac, une chance, le lac. (Gill, 2015: 25.)
Cette ouverture réciproque et excitée d’une bouche à l’autre, ce baiser adolescent, est « une chance » au même titre que certains aspects de la présence colonisatrice allochtone — autorité de l’État, exutoire ludique, malbouffe, misère sociale —, au même titre également que les beautés et traditions du monde autochtone — aurores boréales, bois, chasse, lac. Or, dans Frayer, cet érotisme s’étend au monde puisqu’il s’agit de sentir l’orgasme de la terre (2015: 36) et de « boire la mouille de la glaise » (2015: 67). L’univers de la poète entre alors en résonance érotique avec l’ouverture amoureuse : « des fois le ciel met ses legging en étoiles / et crache sa chaleur de sperme dans la bouche du lac » (2015: 51). L’ouverture béante, adolescente, érotique et amoureuse, est assez grande, en réalité, pour absorber, réunir, et ainsi transcender dans le désir, le territoire, l’autochtonie et l’allochtonie :
Je veux l’Amérique comme elle te ressemble de la voix.
Je la veux de nos sangs bardassés,
nos sangs couleur pow-wow de la terre
qui tremble de la gorge
quand elle nous voit faire la file
devant les micro-ondes. (Gill, 2015: 35.)
Marie-Andrée Gill ne donne pas de réponse, mais chante le désir et ses promesses d’avenir au creux d’une cicatrice lumineuse.
Sortir de l’impasse
En somme, et malgré tout ce qui va de travers dans les réserves et dans la situation des Autochtones, la poésie de Marie-Andrée Gill est pleine d’espoir et suggère un moyen pour sortir de l’impasse : « Nos rêves sentent la boucane et dessinent / Un voilier d’oies blanches / Sur le plafond des possibles. » (Gill, 2015: 53.) Et encore : « Même si les mots nous manquent / Pour s’inventer / Nous sommes le monde / Mais nous le savons pas. » (2015: 47.) Il faut aux Autochtones des mots, des voix, et peut-être une littérature pour s’inventer, transcender la crise existentielle et prendre place dans le monde. La solution n’est pas dans le ressentiment, la révolte, le repli sur soi, la fuite; elle réside dans l’affirmation de son appartenance au monde. L’art, comme le rire, est un remède universel. Et si dans Frayer la poète dit que « les humains ont des couleurs de pas de bon sens » (50), Béante nous rappelle que, homme ou animal : « c’est fou en-dedans / on est tous de la même couleur (69). Blancs, Autochtones, hommes, femmes, pères, mères ou enfants, tous doivent apprendre à composer avec la souffrance : « Nous sommes / Des bêtes sauvages / Et la même lumière4 / Apprenant par cœur pêle-mêle / L’inhibition de la douleur » (Gill, 2015 [2012]: 72). Parce que nous sommes au fond de la même étoffe, faits de la même lumière. C’est en cette vérité première que réside la possibilité d’ouverture. S’il y a identité fondamentale, il y a possibilité d’union. Renversant le jeu des blessures et des souffrances, la cicatrice devient la brèche d’où provient la force d’accueillir l’Autre. L’insistance sur la concrétude des expériences, permet in fine d’en dévoiler les forces désirantes et leurs possibles révolutions érotiques impliquant la transgression des frontières physiques, culturelles, ontologiques, le risque de leur effondrement au profit d’une célébration de la vie et de l’avenir. Est-ce à dire pour autant qu’il faut renoncer à son autochtonie et que le métissage est l’avenir de l’homme? Le texte ne le dit pas et affirme au contraire la fierté d’être différente, mais surtout, d’être plurielle : « Je suis ilnue, je suis québécoise, je suis une femme, une mère et je suis plein d’autres choses. » (Gill, 2015 [2012]: 8.)
- 1. Si, pour Marc Dominicy, « il ne peut exister aucune rhétorique de la poésie » (Dominicy, 1988: 51), nous défendons au contraire la pertinence d’une telle approche pour éviter d’« interpréter les littératures autochtones en fonction des catégories utilisées en littérature canadienne ou québécoise » (Gatti, 2010: 12) et parce qu’il s’agit d’une méthode éminemment heuristique, dans le mesure où « c’est une manière d’ancrer l’analyse dans le discours, plutôt que de partir d’une théorie choisie d’avance et d’utiliser des textes pour la mettre à l’épreuve ou l’illustrer » (Eisenhart, 2012).
- 2. « Dans une telle conception du temps, les péripéties de l’histoire se rapportent les unes aux autres sans que leur antériorité ou leur postériorité ne constitue une clé d’explication ainsi qu’il en est dans la tradition occidentale » (Doran, 2008: 126).
- 3. Dans son article « Frayer. Une poésie des possibles », Elisabeth Lord souligne à quel point « la poésie de Gill traduit à merveille les revers et les travers de l’adolescence » (Lord, 2015) : « Accolant un langage adolescent cru et sexuel à des expressions beaucoup plus fragiles, mêlant la nature et les sentiments, Gill a su créer une atmosphère unique, comme si on était sans cesse déchirés entre le rêve et la triste réalité, entre les aspirations et les déceptions, entre ce qui se passe et ce qu’on imagine. » (Lord, 2015.)
- 4. [Nous soulignons.]