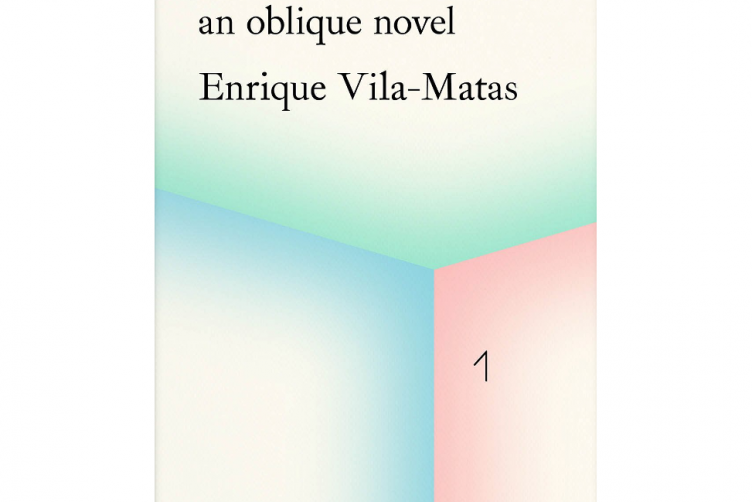Entretien portant sur l’exposition “la Caixa” Collection of Contemporary Art Selected by Enrique Vila-Matas, présentée du 17 janvier au 28 avril 2019 à la Whitechapel Gallery à Londres, réalisé le 2 octobre 2020.
Traduit de l’espagnol par David Martens, avec la collaboration de Laurie-Anne Laget.
Julie Bawin : Avant d’évoquer l’exposition en tant que telle, je souhaiterais en connaître davantage sur les circonstances de cette invitation et sur les conditions dans lesquelles vous avez opéré votre sélection. En d’autres termes, comment avez-vous considéré cette invitation et comment vous y êtes-vous pris? Avez-vous visité les collections de « la Caixa »? Saviez-vous déjà ce que vous vouliez montrer et sous quelle forme? Vous a-t-on imposé un nombre d’œuvres et une façon de travailler ou avez-vous eu carte blanche?
Enrique Vila-Matas : Cette proposition surprenante consistant à assurer le commissariat d’une exposition à la Whitechapel m’a été transmise par Mónica Martin et Txell Torrent, mes agents littéraires. La Fondation « la Caixa » s’était adressée à elles pour savoir si j’accepterais ce travail de commissaire et d’écrire un texte bref sur ma sélection. Trois autres écrivains prendraient part après moi à cette initiative, à raison d’un par an m’a-t-il été dit, et deux d’entre eux comptaient parmi mes dix contemporains préférés, puisqu’il s’agissait de Tom McCarthy et de Valeria Luiselli (laquelle ne participera finalement pas à cette programmation). J’ai accepté un tel projet en raison de la nouveauté qu’il représentait pour moi. J’ai procédé à une sélection d’œuvres de « la Caixa » en consultant trois épais catalogues que l’on m’a remis. Il y avait là plus de 200 artistes, les meilleurs. Une collection fabuleuse. L’espace disponible à la Whitechapel (100 mètres carrés) ne permettait d’accueillir que six œuvres. J’ai par conséquent décidé de passer en revue, à toute vitesse, les pages des catalogues et d’annoter uniquement les œuvres que j’ai pu instantanément identifier comme liées à ma propre œuvre littéraire. Un tel système de sélection m’a conduit à comprendre que j’allais finir par composer une brève, succincte biographie littéraire, pour utiliser le titre de Coleridge, qui mourut à Londres en 1834. Comme on le sait, sa Biographia Literaria était comme des mémoires littéraires où prédominaient la critique, des réflexions stylistiques, métriques, l’exposition de quelques idées de Hartley, une identification des caractéristiques de l’imagination et, surtout, beaucoup de choses à propos de Woodsworth et de sa poésie. Durant une heure et demie à la maison — j’avais, en effet, carte blanche —, j’ai décidé de ce que serait mon exposition et j’ai choisi six œuvres en adoptant un système qui consistait à rejeter à toute vitesse presque tout ce que je voyais dans les catalogues, ne retenant que ce qui me procurait une émotion spéciale pour des raisons biographico-littéraires. Tu n’imagines pas, Julie, le plaisir qui a été le mien de passer ainsi en revue des pages et des pages de catalogue et de mettre au rebut des « œuvres majeures ». De ma liste finale, un seul de mes choix a dû être changé, celui d’une peinture d’Anselm Kiefer, qui s’est avérée excessivement monumentale, et que Nimfa Bisbe et Lydia Yee m’ont proposé — j’ai accepté d’emblée — de remplacer par Theben West, d’Andreas Gursky, qui s’articulait très bien avec Une poignée de terre, de Miquel Barceló.
J. B. : Quel a été exactement le rôle des deux commissaires, Nimfa Bisbe et Lydia Yee? Avez-vous conçu seul la scénographie de votre exposition et quelles ont été les contraintes proprement expographiques?
E. V.-M. : Nimfa Bisbe et Lydia Yee sont intervenues dans le remplacement de cette peinture de Kiefer et se sont chargées de la distribution sur les murs des peintures exposées, de la vidéo de Dora García et du montage de l’installation Petite, de Dominique Gonzalez-Foerster (cette pièce donnait davantage de vie à l’exposition, car le public passait plus de temps à la regarder). Travailler avec Nimfa Bisbe et Lydia Yee fut agréable. Ce fut une bonne expérience, pour elles aussi, je crois. Elles sont parvenues à voir et à comprendre ce que j’avais tenté, comme en témoigne Nimfa Bisbe lorsqu’elle explique, dans le livre Cabinet d´amateur, que j’utilise l’autobiographie — y compris l’autobiographie littéraire — comme un instrument de fiction. À Paris, à l’occasion de la publication de mon roman Cette brume insensée, Didier García, critique du Matricule des Anges, a dit que, dans ce roman, plus que jamais, je réalise « un beau tour de passe-passe : je transforme la littérature en fiction » (2020). C'est une phrase drôle et plus belle encore que mon possible tour de passe-passe.
J. B. : Vous appelez votre exposition Cabinet d’amateur et, dans votre « livre oblique », vous écrivez que c’est là une référence à Perec. Pourriez-vous développer cet aspect des choses? Pourquoi parler d’un « cabinet d’amateur »?
E. V.-M. : Cabinet d´amateur est un hommage au livre de Perec et un clin d’œil à l’idée que moi, en tant que commissaire ayant à choisir des œuvres d’art, je ne suis qu’un aficionado, un amateur. Je ne prétends pas passer pour autre chose que ce que je suis. De fait, au dernier moment, j’ai bien tenté de changer le titre du texte inclus dans le livre de la Whitechapel Gallery pour ne conserver que l’idée de Una novela oblicua. Car, en fin de compte, ce que montrait mon Cabinet d’amateur était le squelette de ma biographie littéraire. À travers une trame en lambeaux, les six œuvres rassemblées à cette occasion expliquaient obliquement ma trajectoire littéraire. C’était comme si toute l’histoire de mon style pouvait être contée sans avoir à faire l’effort d’aller plus loin que les six œuvres exposées en ce lieu. Peut-être l’exposition annonçait-elle un type de roman qui, à l’avenir, serait fait d’une superposition de styles distincts, à la façon de Rem Koolhaas, par exemple, qui a construit la bibliothèque de Seattle en proposant une grande parodie architecturale de la construction chaotique de Manhattan. À ce propos, Nimfa Bisbe considère que, dans « Una novela oblicua », j’ai décrit ce que j’avais vu dans la réalité, mais avec une voix qui paraissait venir de l’au-delà. Hier, en relisant ces mots, j’ai vu qu’ils avaient pu influencer la voix narrative de mon dernier livre, Cette brume insensée, où celui qui raconte l’histoire semble parler en contemplant une lente aube du futur, alors qu’il se trouve hors de la Terre et qu’il est peut-être mort depuis déjà des années, ou bien qu’il vit entre la vie et la mort, dans une sorte de Bardo, dans des limbes habitées par des fantômes qui ignorent leur destin.
J. B. : Vous écrivez que l’association des six œuvres exposées est à mettre en lien avec votre biographie littéraire. Cela veut-il dire que l’exposition est à l’image de vos romans (de votre « style ») et que l’exposition elle-même donne naissance à une nouvelle expérience littéraire qui serait le roman oblique?
E. V.-M. : À l’évidence, « Una novela oblicua » est une expérience de « littérature élargie » (« literatura expandida1 »).
J. B. : Quel statut donnez-vous à votre « roman oblique »? En d’autres termes, que cherchez-vous à raconter dans ce texte découpé en 25 courts chapitres?
E. V.-M. : J’ai présenté à cette occasion le squelette d’un roman qui, avec le temps, pourrait tenter de s’aligner sur les meilleurs romans les plus novateurs. Je l’ai présenté sous la forme d’une exposition : une sorte de très brève poétique cryptée de mon œuvre, où la forme était le contenu, et le contenu la forme (comme cela se produit dans Finnegans Wake et comme cela se produira encore, je le suppose, dans quelques romans obliques du futur). Je me souviens que l’idée a été vivement célébrée par Pierre Assouline, qui trouvait génial d’écrire une autobiographie à partir d’une exposition succincte d’art contemporain. Aux antipodes se situerait Jonathan Jones, le critique du Guardian, qui, assurément, n’a rien compris, peut-être parce qu’il n’a même pas pris la peine de lire « Una novela oblicua » et en est arrivé à la conclusion suivante, pleine de stéréotypes sur la supposée cuisine espagnole : « This is the first in a series of small selections from the La Caixa collection at the Whitechapel curated by authors. It’s the croquetas, then a few squid, and let’s have some of those mushrooms in sherry. But what would be wrong with a nice big paella? The Whitechapel is becoming the tapas bar of contemporary galleries, and it leaves me hungry. » (Jones, 2019)
J. B. : Avez-vous cherché à faire du spectateur un « lecteur »? Autrement dit, comment avez-vous envisagé le rôle du public? L’exposition devait-elle se lire en parallèle avec votre roman oblique? Ou l’exposition était elle-même un récit à « regarder » et à « lire »?
E. V.-M. : Comme je te l’ai dit, l’exposition était pensée pour être vue pendant que le visiteur lisait — avant ou après l’avoir visitée, peu importe — « Una novela oblicua ». Je n’ai donc jamais envisagé la possibilité d’avoir un visiteur avec « des envies de paella ».
J. B. : Vous écrivez que la toile de Richter est l’œuvre autour de laquelle toute l’exposition tournait. Pourriez-vous vous exprimer davantage sur cette peinture et sur l’importance que vous lui avez donnée dans l’exposition?
E. V.-M. : L’importance de la toile de Richter tenait à deux raisons : 1) Je considère Richter comme le numéro un de la peinture mondiale et, dans la mesure où l’achat de ses toiles n’était pas à la portée de ma bourse, j’ai vu comme une expérience extraordinaire la possibilité de disposer pour l’exposition d’une de ses huiles. 2) Dans cette peinture, l’auteur nous invite à une réflexion sur la nature de l’art de la peinture, d’une façon qui semble liée aux obsessions et aux thèmes autour desquels tourne ma propre écriture, qui est en réalité, fondamentalement, un ensemble de réflexions autour de ce qu’est l’écriture. Je me souviens de la première fois que j’ai vu ce portrait de Richter. La première chose que j’ai pensée était que nous devrions disposer de tout le temps du monde pour pouvoir nous consacrer à rechercher les raisons cachées pour lesquelles une image — disons un regard sur un lac ou une femme qui nous tourne le dos — ne pouvait plus jamais s’effacer de notre mémoire. Pourquoi est-elle restée là, nimbée de mystère, à nous poser tant de questions? D’où vient-elle et pourquoi avons-nous un instant pensé qu’elle nous rappelait quelque chose d’oublié? Tout indique qu’il y a, derrière ces images qui nous frappent tant, un fil secret qui les relie au passé. Ce fut la première chose à laquelle j’ai pensé lorsque j’ai vu le tableau, comme si j’avais eu l’intuition que je n’oublierais jamais cette peinture. Depuis, j’ai regardé ce tableau avec davantage d’attention. Et j’ai vu le monde. Ou, pour le dire autrement, j’ai vu ce fond noir, le négatif ou le verso de la photographie générale du monde. Finalement, le fait que la femme portraiturée soit de dos m’a conduit à associer sa position avec une image de mon passé, une image liée à une session de jazz à laquelle j’ai assisté pendant mon adolescence. Je pense qu’à ce moment-là se sont soudainement combinés le souvenir assoupi de ma passion pour le négatif des images — ma passion de travailler sur le lent déchiffrement du revers de toute chose — et cette figure troublante qui m’a touché au plus profond de mon inconscient, me renvoyant aux origines de ma poétique, c’est-à-dire à L’Assassin illustré, un livre que j’ai écrit en tournant tellement le dos au lecteur que j’en venais à chercher à en finir avec lui. Parce que je voulais assassiner tous les lecteurs potentiels de mon premier livre.
J. B. : J’aimerais à présent vous poser des questions plus générales sur le domaine de l’exposition et savoir si, par exemple, votre curiosité pour l’art contemporain, votre intérêt pour Marcel Duchamp, vos liens avec Dominique Gonzalez-Foerster ou encore votre expérience à Kassel vous ont sensibilisé aux problématiques de l’exposition et aux développements apportés par nombres d’artistes et de commissaires?
E. V.-M. : Oui, bien sûr. Mais tout a commencé pour moi bien avant que je sache ce qu’est un écrivain-commissaire. Tout a commencé pour moi lorsque j’ai vu à Paris, au Musée des arts décoratifs, en 1976, l’exposition Les machines célibataires2 (selon la formule de Duchamp). Le titre de cette exposition m’a d’emblée beaucoup intrigué. Je n’imaginais pas que des expositions pouvaient se monter autour de « machines célibataires ». À cette époque, j’admirais déjà ce roman unique en son genre de Roussel, Locus Solus, et voir au Grand Palais — exposées sans la moindre difficulté — les machines inventées dans ce livre m’a beaucoup impressionné. Et j’étais encore plus excité de voir les machines compliquées de Roussel (que je pensais, à tort, irréalisables) à côté de celles de Kafka (celle de La Colonie pénitentiaire, par exemple), avec l’ombre de Duchamp en toile de fond — cette ombre m’a toujours accompagné, je pense, tout au long de ma vie —, l’ombre du joueur d’échecs et le discret inventeur des auvents de Cadaqués pour se protéger du soleil en été.
J. B. : Connaissez-vous d’autres expositions organisées spécifiquement par des écrivains? Que pensez-vous de la figure de l’écrivain-commissaire?
E. V.-M. : Le premier écrivain-commissaire que j’ai vu de ma vie fut Hans Ulrich Obrist, qui fut celui qui, sur la recommandation de Dominique Gonzalez-Foerster (qui ne me connaissait pas encore personnellement), m’invita à l’exposition Everstill à Grenade en 2007 : trente interventions de trente artistes dans la maison de campagne de García Lorca (aujourd’hui devenue un musée). J’ai ultérieurement rendu visite à Obrist à la Serpentine Gallery de Londres, qu’il dirige, et j’ai suivi sa recherche permanente de rôles nouveaux : il y a désormais, à la Serpentine, un régisseur, une figure qui manque dans la plupart des musées, mais ils ont aussi un conservateur civique, chargé de faire pénétrer l’art dans la société, et un chargé des questions écologiques. En tant que laboratoire, ils ne cessent de penser au futur. Je trouve la figure de l’écrivain-commissaire séduisante, peut-être en raison de l’impression que me fit Obrist, le premier commissaire que j’ai connu : il ne s’arrête jamais de travailler, même s’il est à la terrasse d’un café avec des amis, il ne cesse de poser des questions et prend note de tout dans des carnets. C’est un personnage fascinant. Lorsqu’on m’a posé la question, j’ai toujours dit que je ne souhaitais pas poursuivre mon travail de commissaire commencé à la Whitechapel. Pourquoi? Ce qui me plaît réellement en matière d’art est d’être assis devant mon ordinateur et d’écrire. C’est pourquoi j’ai même fui les entretiens sur Zoom, si en vogue en ce moment…
J. B. : Quelle serait finalement l’exposition de vos rêves?
E. V.-M. : Une exposition qui serait en quête des artistes qui sont réellement contemporains et de ceux qui ne le sont pas. Elle partirait de la prémisse que ceux qui coïncident avec leur temps et lui correspondent en tout point ne sont pas des contemporains, précisément parce qu’ils lui correspondent à un point tel qu’ils n’arrivent pas à le voir, qu’ils ne peuvent pas conserver leur regard fixé sur lui. Dans l’exposition, il y aurait des connexions avec Robert Walser, Samuel Beckett, Maurice Blanchot, Marguerite Duras, Clarice Lispector, Jorge Luis Borges, Harry Mathews et d’autres écrivains du modernisme européen du siècle dernier, des auteurs que, entre autres choses, j’admire parce qu’ils ont su se rattacher à leur temps, en prenant toujours un recul prudent par rapport à toute chose, y compris par rapport à leur époque. Ces auteurs, dans une mesure plus ou moins considérable, ont, depuis des années, joué le rôle de guides sur mon chemin, car ce qui me fascine en eux c’est qu’ils n’oublient jamais que l’écriture est, précisément, l’un des seuls lieux où l’on peut à tout moment se permettre de n’être pas exactement contemporain, voire de n’être strictement contemporain que de l’être humain.