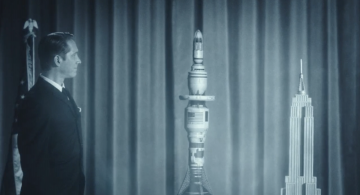Au printemps 1985, avec un groupe d’étudiants du doctorat en Histoire de la conscience (History of consciousness) de l’Université de Californie à Santa Cruz (UCSC), nous avons convaincu Louis Marin de retourner à Disneyland. Marin était à l’UCSC à l’invitation de Fredric Jameson, pour la session du printemps, et nous étions tous dans son séminaire.
Marin était allé à Disneyland, dans le comté d’Orange en Californie, une première fois douze ans plus tôt et il avait témoigné de sa visite dans un chapitre (le douzième) de son essai Utopiques. Jeux d’espaces (1973). Pour lui, le parc d’attractions était une « utopie dégénérée », fondée sur la représentation du rapport imaginaire que la société américaine entretenait avec son histoire et ses conditions réelles d’existence. La Nouvelle-Orléans (New Orleans Square), la Frontière (Frontierland), mais aussi l’urbanité américaine (Main Street, USA) et le monde de demain (Tomorrowland), dominé par une conception simplifiée du progrès, pouvaient être explorés une bouteille de Coca-Cola et une barbe à papa dans les mains. L’utopie disneyenne, écrivait-il, « est la projection fantastique de l’histoire de la nation américaine dans sa double instauration à l’égard de l’étranger et à l’égard du monde naturel, la métaphore déplacée de la représentation idéologique. » (1973: 298)
Le parc était un espace isolé, fermé sur lui-même, qui forçait ses visiteurs à abandonner leur véhicule au loin, dans un étonnant rite de passage. Et ce qui s’offrait à leurs yeux était une Amérique infantilisée où toutes les tensions étaient résolues une fois reproduites dans des saynètes et des vignettes édulcorées, éblouissantes tout autant qu’inoffensives.
*
Lors de ce voyage dans le sud de la Californie en minifourgonnette, nous nous sommes d’abord rendus au Westin Bonaventure Hotel à Los Angeles, observer de nos propres yeux cet immeuble représentatif du sublime postmoderne, que Fredric Jameson analysait dans son séminaire consacré à ce qui deviendrait son essai Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1990). Puis, nous avons pris la route vers le comté d’Orange.
L’objectif officiel de la visite était de vérifier avec Marin si après toutes ces années son analyse tenait toujours la route. La dimension dystopique du parc était-elle toujours aussi présente? Les dispositifs aliénants étaient-ils toujours efficaces? Disons, pour faire court, que l’historien de l’art n’était guère impressionné par le peu de changements apportés au parc. La gestion des foules était restée la même, la surcommercialisation d’un récit des origines simplifié était tout aussi irritante. Les lieux avaient seulement pris un coup de vieux… Il faut dire qu’une utopie ne se visite jamais deux fois! L’amusement initial se transforme vite en déception.
On souhaitait secrètement que Marin écrive une suite à son article, imaginant même qu’on pouvait y jouer un rôle, dans une mise en abyme à la manière d’une nouvelle de John Barth (« Lost in the Funhouse » [1968], par exemple). Mais il semblait peu motivé à faire dans l’autofiction. On a été bon pour une journée d’explorations et de franches rigolades. Juste avant de sortir, on a pris une photo de groupe au Polaroïd, afin d’immortaliser notre passage. Louis Marin est là, sur la droite, coiffé d’une casquette de Mickey Mouse comme nous tous. Il sourit, ses lunettes perchées sur le bout de son nez.